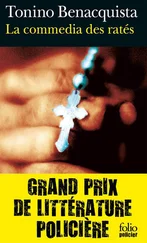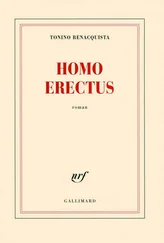En traversant une région montagneuse et très verte, elle se fit recruter avec d’autres saisonniers pour aider à la récolte d’une plante qu’elle ne connaissait pas, dont on tirait un breuvage âpre, parfumé, plus puissant que toutes les infusions qu’elle avait goûtées jusqu’alors. Tout le jour durant, elle remplissait des corbeilles entières de pousses de thé qui lui brunissaient les mains, lui irritaient les yeux et agaçaient ses narines. Le soir, une fois son bol de riz avalé, elle partageait un moment de détente avec sa communauté d’ouvriers. À cette femme blanche, aux yeux clairs et au long nez, peu bavarde mais bonne travailleuse, on demanda d’où elle venait. Avec les quelques mots qu’elle possédait, elle répondit : Je cherche mon mari . Ce qui déclencha l’hilarité de tous.
Croyant qu’elle aspirait au mariage, des jeunes gens s’approchèrent. Elle les détrompa vite : elle avait déjà un mari qui se trouvait au bout du monde, Dieu seul sait où . Ce qui, à nouveau, fit rire aux éclats et donna un regain d’énergie à ceux qui tombaient de sommeil. Quand on lui demanda si le cher homme avait fui avec une autre, plus jeune, plus riche ou plus belle, elle répondit : Je n’ai aucune nouvelle de lui depuis que nous sommes tombés du Ciel . Ce soir-là on oublia fatigue et courbatures, car si la plante de thé avait des vertus euphorisantes, la femme tombée du Ciel en avait tout autant. Elle se risqua à étoffer son récit de tournures plus habiles, on l’aida même à terminer ses phrases malgré leur caractère invraisemblable. Le public se délecta du passage où les époux avaient dû s’acquitter d’une taxe auprès du collecteur d’impôts afin qu’on leur fiche la paix, et plus encore de l’épisode où le roi en personne avait exigé d’eux qu’ils le guérissent. Quand on lui demanda comment ils s’étaient tirés de ce mauvais pas, elle répondit : Très mal, il nous a coupé la tête ! L’étrangère régala les ouvriers de ses raccourcis saisissants, et le lendemain, dans les plantations, un panier sur le dos, ils les répétèrent comme de bons mots. On se prit d’affection pour cette femme venue de si loin pour les distraire et, que l’on crût ou non à ses extravagances, on était touché par le tendre sentiment qui la liait à un époux qui n’existait que dans ses rêves.
Leur solde en poche une fois la moisson terminée, tous se fixèrent rendez-vous dans un an. Un jeune homme donna à la femme tombée du Ciel un précieux renseignement : à moins de dix jours de marche se trouvait la ville de Shingsao, d’où partaient les routes commerciales en direction de l’ouest. Il avait lui-même travaillé dans une propriété d’exportateurs de renom qui songeaient à embaucher une gouvernante occidentale. De là, en faisant preuve d’un peu de patience et d’astuce, l’étrangère saurait trouver un moyen, en empruntant une des routes de la Soie ou des Épices, pour rejoindre son pays.
Durant sa marche, elle apprit à jouer avec les trois pièces d’étoffe qui constituaient sa tenue, l’une couvrant ou découvrant ses jambes au gré des cours d’eau traversés, une autre lui enserrant la taille jusqu’à la poitrine, et une dernière qui tantôt lui recouvrait la tête, tantôt lui protégeait la nuque, tantôt lui masquait le visage. À la voir cheminer ainsi on aurait dit une gravure biblique, un saint apôtre, un prophète ouvrant la voie à son peuple.
*
L’Espagnol et le Français retrouvèrent la civilisation telle qu’ils l’avaient oubliée après de longs mois de captivité. Dans le port de Teyagueca, navires de guerre et de commerce se côtoyaient, leurs marins également, heureux de retrouver la terre ferme ou de la quitter. N’ayant rien à monnayer, les deux compères durent se défaire de leurs précieux médaillons huacanis chez un orfèvre qui les fit fondre pour les revendre à l’once. Une fois rasés, habillés et rassasiés, ils se mirent en quête d’une taverne qu’ils ne quitteraient que fin soûls.
Au premier verre de rhum ils crachèrent le feu mais leur gosier en réclama un deuxième. Au troisième ils oublièrent les mauvais traitements subis, l’emprisonnement, la jungle. Au quatrième ils oublièrent l’idée même d’adversité. Au cinquième, Alvaro, gagné par la nostalgie, se laissa aller à la confidence.
Il avoua avoir abandonné au pays une femme tendre et naïve qui, en se donnant à lui, avait perdu son honneur aux yeux de la bonne société. Au lieu de rendre sa dignité à cette Doña Leonor en demandant sa main, Alvaro avait préféré s’enrôler, non par soif d’aventure mais pour fuir sa propre lâcheté, honteux de s’être laissé convaincre de l’immoralité de sa jeune maîtresse. Des deux, lui seul avait perdu sa dignité : elle avait cédé à son embrasement, lui aux injonctions de la morale. Il pensait avoir oublié cet épisode peu glorieux, jusqu’à cette nuit de veille où, en traduisant le récit de son compagnon pour apitoyer des indigènes, il avait découvert comment celui-ci avait affronté le courroux des hommes au nom de sa bien-aimée.
Son ami, assez ivre pour partager sa peine, lui proposa de rentrer avec lui sur le Vieux Continent ; s’il se sentait aussi coupable, pourquoi ne pas tenter de réparer, moins aux yeux de la bonne société qu’à ceux de cette femme qui selon toute vraisemblance pensait à lui chaque jour, et en des termes moins infamants qu’il ne l’imaginait. Le Castillan l’en remercia mais refusa tout net ; son ancienne amante avait sans doute rencontré un mari qui avait su la consoler, et la débarrasser du triste sobriquet dont on l’affublait depuis son déshonneur : la Soltera , la célibataire, la vieille fille.
Alvaro se promit cependant de racheter sa faute en donnant ainsi un but à sa vie d’errance. Peut-être allait-il réparer une injustice, secourir une femme méprisée, ou combattre les préjugés de son époque : une véritable aventure s’offrait enfin à lui.
Le lendemain, l’esprit encore embrumé, ils se dirent adieu. L’un allait remonter vers le continent nord de cette Amérique à conquérir, tandis que son comparse allait traverser l’océan pour regagner le pays natal. Ils se souhaitèrent de trouver chacun une réponse à leurs vœux, s’embrassèrent comme des frères, puis l’un disparut en remontant le port, l’autre se dirigea vers le quai dévolu aux navires marchands. Il en découvrit un, sous pavillon français, prêt à lever l’ancre.
Le Sainte-Grâce , un galion à la coque ventrue, transportait le plus souvent du coton ou du tabac mais acceptait au prix fort une poignée de passagers, généralement des commerçants accompagnant leurs marchandises, ou des clercs de notaires chargés par leur étude de rédiger les actes de propriété des concessions outre-mer. Une cabine restait vacante, et le seul candidat assez pourvu pour y prétendre — le solde de son médaillon — se trouvait maintenant sur le pont. Mais le capitaine posa une condition avant de la lui octroyer :
Monsieur, les passagers déjà à bord m’ont tout l’air de tristes sires. Leurs bavardages d’huissiers ou de boutiquiers sont assommants, et plutôt qu’à ma table je préfère les savoir dans leur cabine, prêts à défaillir au premier grain. La traversée sera longue, et elle le sera plus encore si le soir venu je suis condamné à leur compagnie. Ayant navigué avec de grands explorateurs, ayant franchi des caps meurtriers, je me suis lassé de toutes les légendes qui courent les mers depuis l’arche de Noé, et je suis prêt à céder cette dernière place à celui qui saura me divertir de sa conversation, originale, et surtout récréative. À vous de me convaincre que vous êtes celui-là.
Читать дальше