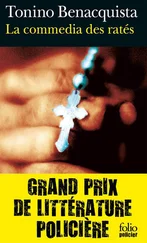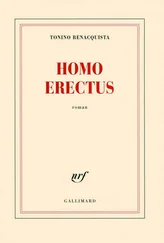*
Il se réveilla comme au sortir d’une nuit lourde de cauchemars. Encore dans les ténèbres, il se palpa le corps, en testa les rouages, et ouvrit enfin les yeux.
Le soleil naissant donnait des reflets laiteux à une nature exubérante, une forêt prise de folie qui aurait poussé en tous sens. À quelques pas de là dormaient sur des amas de feuilles des hommes à la peau rouge et tannée, à demi nus, leurs arcs et leurs lances à portée de main. Il s’éloigna à la hâte, craignant une confrontation dont il ne sortirait pas vainqueur. Il s’arrêta au bord d’une rivière, cristalline et fraîche, où il plongea pour se laver de sa sueur et calmer son angoisse. La mémoire lui revint enfin et, avec elle, une soudaine langueur. L’essentiel lui manquait, et son corps semblait l’avoir compris bien avant sa raison.
Le braconnier qu’il avait été se sentit vite impuissant dans cette nature hostile, incapable de dénicher les fils de crin pour dresser ses collets, de rabattre le gibier dans une jungle aux frondaisons épaisses comme des murailles. Il se retrouva devant un chat sauvage aux longues oreilles surmontées d’un épi, d’une rare férocité, impossible à affronter sans arme, et doté à l’évidence d’une chair immangeable sans qu’on la faisande. Il se risqua à mordre dans une racine grasse et oblongue échappée du sol mais la recracha aussitôt. Il se fixa le nord pour unique direction, et bientôt des trouées de ciel vinrent éclairer sa route, la végétation se fit moins dense, la brise remplaça la touffeur. Il discerna au loin le cri d’un goéland et, sous ses pieds, du sable se mêlait à la terre.
Un océan l’attendait.
Sa toute première pensée devant une si merveilleuse perspective fut pour celle qui, à n’en pas douter, se trouvait par-delà, sur un autre rivage. Lui qui était né dans les terres et qui jamais n’avait rencontré de marins, comprenait enfin la belle obsession des explorateurs pour les trésors du bout du monde ; désormais il en connaissait un qui méritait qu’on bravât les sept mers pour le découvrir.
En remontant la côte, il repéra dans une crique les restes d’un bivouac à l’ordonnancement militaire, dont les sacs de toile et la malle abandonnés là étaient frappés du sceau de quelque royaume lointain. Sans doute était-ce le même détachement qu’il aperçut deux jours plus tard, voguant sur une chaloupe chargée d’une dizaine d’hommes en uniforme blanc et rouge, issus de la même race que la sienne. Au lieu de leur faire signe il préféra se rabattre en forêt car il savait d’expérience éviter les troupes en opération, d’où qu’elles proviennent. Dans sa première vie, il avait croisé tant de soldats dont le bras armé semblait commandé par une même instance supérieure. Tantôt on avait tenté de l’enrôler de force, tantôt on l’avait déclaré ennemi et tiré à vue, et c’était grâce à sa bonne connaissance de la nature et des bois qu’il avait évité le sort des prisonniers, otages, et autres victimes civiles. Du reste, depuis qu’il était revenu sur Terre, combien celle-ci avait-elle connu de guerres, de croisades, d’invasions ? Combien de fois avait-on redessiné les frontières et redistribué les pouvoirs ? Combien de peuples jadis alliés étaient devenus adversaires sans savoir pourquoi ? Combien de pays avaient changé de nom, de langue, de gouvernance ? Qui étaient ces hommes en rouge et blanc, et que visaient-ils au bout de leur mousquet ? Tant qu’il n’aurait pas de réponse, il se tiendrait en bordure de la forêt tropicale.
Au fil de son exploration, il apprit à reconnaître les pousses comestibles, il réussit même à escalader des troncs immenses afin de dormir haut perché, hors de portée des bêtes. Ce fut pourtant en descendant d’un de ces arbres qu’il se vit attendu par une poignée de guerriers indigènes bien plus agressifs que n’importe quel fauve. Et pendant qu’on lui enserrait la gorge et les poignets dans une liane tressée, il se demanda lesquels, des hommes en uniforme ou des hommes en peintures de guerre, il avait le plus à craindre.
*
Après deux jours de marche elle aperçut une cahute de bambou, puis une autre, puis dix autres. Pressée par le besoin de voir et de toucher des humains, elle s’approcha d’un petit village parcouru de canaux où étaient amarrées des barques étroites à la coque en pointe. Devant chaque demeure se tenait une femme agenouillée qui découpait des herbes et des lamelles de viande sur un étroit billot. Elles communiquaient entre elles par de courtes exclamations rieuses qui lui rappelèrent les lavandières de son village natal. Leur langage, tout de voyelles sinueuses, semblait avoir été conçu pour dessiner sur les lèvres, en fin de phrase, un sourire. Le sourire vira à la grimace, puis au cri d’alarme, quand l’une d’elles aperçut l’intruse.
Une nuée de villageoises vint l’entourer, toucher sa chevelure, palper les étoffes de sa blouse et de sa jupe. La plus âgée d’entre elles l’entraîna à sa suite afin de la cacher dans un enclos où séchait la moisson. L’étrangère ne comprit que plus tard une telle urgence : les hommes, sur le point de rentrer des champs, allaient s’interroger sur sa présence et peut-être s’en irriter. D’autant qu’elle était peut-être issue de cette peuplade venue de l’ouest qui avait, par deux fois en dix ans, semé la désolation sur son passage.
Le lendemain on lui posa mille questions auxquelles elle ne put répondre, on la déshabilla pour voir comment elle était faite, on la revêtit d’une longue chemise écrue, on lui tressa un chapeau de feuilles à large bord. N’ayant nul autre choix, elle s’abandonnait aux mains de ces femmes qui parlaient toutes à la fois, qui toutes avaient les mêmes yeux en amande et la peau couleur miel. On lui enseigna les rudiments de la langue — elle apprit ainsi qu’elle se trouvait au « Royaume de Siam » —, puis on l’initia au travail en rizière afin qu’elle paye son écot. Mais l’étrangère comprit peu à peu son vrai rôle. Soustraite au regard des hommes, elle était devenue le secret de ces femmes, qui les consolait de l’autorité des pères et des époux. Sa présence clandestine était l’expression de leur solidarité, et peut-être leur tout premier acte d’indépendance.
Adoptée et choyée, la visiteuse , comme on l’appelait, se demandait si, à force de voir le monde à travers les yeux de ses nouvelles camarades, elle n’était pas elle-même dotée de leur regard en amande. Cependant le langage lui faisait défaut, non pour communiquer ou traduire sa gratitude, mais pour dire qui elle était, d’où elle venait, et combien lui manquait l’homme que chaque nuit elle retrouvait en rêve. En racontant l’histoire qui la liait à lui, elle leur aurait légué, avant de les quitter, un peu de son bonheur perdu.
Contre toute attente, l’occasion lui en fut donnée.
Un jour où elle passait devant la fenêtre d’un notable du village à qui l’on confiait l’établissement des actes de propriété, elle entrevit sur une natte en osier une liasse bien ordonnée de parchemins vierges, beige clair, de moindre largeur que ceux qu’elle avait connus mais au contour régulier et lisse. On lui offrit volontiers quelques feuilles de ce papier tiré de l’écorce de mûrier et, quand elle s’enquit d’une plume, on lui tendit un bâtonnet d’encre dont elle dut apprendre le maniement.
Du fond de sa grange, plusieurs heures par jour, ou même la nuit à la lueur d’une bougie, elle sollicitait sa mémoire, revivait les épisodes de sa vie passée, tentée de les faire tenir sur des lignes bien droites, car tous méritaient d’être évoqués, y compris les plus malheureux, telle était la vocation de ce document : consigner la vérité de leur histoire pour que d’autres s’en inspirent. Et peut-être avait-elle trouvé là le vrai sens de son apprentissage de l’écriture qui naguère lui avait valu tant de défiance.
Читать дальше