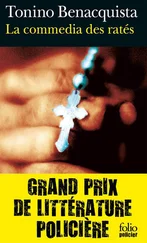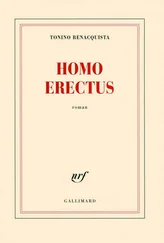Son ouvrage terminé, la visiteuse prépara son départ, chagrinée de devoir quitter ces femmes devenues ses sœurs. Elles l’avaient accueillie et cachée, elles l’avaient nourrie avec délicatesse afin que son corps s’habitue aux denrées locales, elles l’avaient habillée à leur mode afin que sa silhouette se fonde dans le paysage, elles lui avaient enseigné assez de mots pour qu’elle se débrouille seule et atteigne le premier port. En échange elle leur laissa un volume de la taille d’un petit grimoire, espérant qu’un jour quelque érudit parlant à la fois sa langue et la leur en fasse une lecture publique. Et ce jour-là, toutes découvriraient qui était cette étrangère, et toutes se féliciteraient de l’avoir recueillie.
*
Le prisonnier s’engouffrait dans la jungle, les poignets entravés, le dos piqué par des pointes de lances, entouré de six indigènes, fiers de leur prise de guerre. Enfin s’ouvrit devant eux un couloir formé de troncs alignés qui marquaient l’entrée d’un village. Au loin se profilait un temple en forme de pyramide, plus haut qu’une colline, constitué de pierres larges comme une nef d’église. En son milieu un escalier lancé jusqu’au ciel se perdait dans les nuages comme une invitation à rejoindre les dieux. À son pied, une myriade de modestes maisons issues de la même pierre abritait une population bruyante où femmes et hommes travaillaient aux mêmes tâches, où vieillards et enfants s’amusaient aux mêmes jeux. L’homme blanc, ficelé comme un gibier, épuisé de fatigue, s’agenouilla devant un puits comme s’il se fût agi d’une statue. On lui tendit une écuelle d’eau fraîche qu’il lampa bruyamment sous les rires des plus jeunes. Derrière le temple se dressait une cage en bambou, aux barreaux espacés de la largeur d’une main, conçue à hauteur d’homme, et qui eût pu en contenir dix, mais qui pour l’heure n’en contenait qu’un.
De race blanche, il était vêtu d’une tunique et d’une culotte usées et noires de crasse qui relevaient de la tenue militaire sans qu’on puisse désormais deviner ses couleurs. Sa barbe et ses cheveux mêlés, tombant sur sa poitrine, donnaient une idée du temps que le malheureux avait passé dans la cage. Il se dressa sur ses jambes pour accueillir ce nouveau locataire dont l’arrivée dissipait du même coup son ennui et sa détresse.
Né en Castille, soldat de métier, Alvaro Santander avait été de tous les conflits ayant agité le Vieux Continent, dont une tentative de destitution de Philippe d’Orléans, en 1718, ce qui expliquait son méchant français mâtiné d’un fort accent espagnol. Envoyé dans les colonies du Nouveau Monde, il avait déserté à peine le pied posé sur le rivage, espérant que ces Amériques soient assez vastes pour qu’on l’y oublie et qu’il y fasse fortune. Jusqu’à ce que la flèche de sa boussole ne croise celles des arcs huacanis, ces guerriers à la peau rouge qui semblaient lui en vouloir depuis des lustres, à lui personnellement, bien innocent des crimes de ses coreligionnaires. Le Français eut enfin les réponses aux questions qui le taraudaient depuis son retour ici-bas : il se trouvait sur le continent sud des Amériques, en l’an 1721.
À force d’être insulté par les hommes, moqué par les femmes, raillé par les enfants, Alvaro avait fini par comprendre et parler leur curieux idiome et, depuis, ses geôliers s’amusaient à lui prédire, en des termes raffinés, la pire des fins. Son codétenu lui demanda pourquoi les sauvages, malgré un tel ressentiment à son égard, l’avaient maintenu en vie si longtemps au lieu de l’exécuter sur-le-champ.
Pour avoir redouté mille morts depuis sa capture, le malheureux avait examiné cette question-là jusqu’à l’obsession. Au tout début, il s’était imaginé qu’on le réservait pour quelque rite sacrificiel. Ce jour-là n’arrivant jamais, il s’était dit que les indigènes voyaient en lui non plus un prisonnier mais une sorte d’animal exotique que l’on visite pour se distraire. Désormais, il détenait la vraie réponse : en l’épargnant, la tribu avait fait de lui une sorte de trophée diabolique, un vivant rappel de ces hordes venues d’au-delà des mers pour éteindre leur civilisation. Rendu inoffensif, le barbare devait être offert au regard de tous pour prouver sa vulnérabilité afin de moins le craindre, et de se préparer, d’abord par l’esprit, à le combattre. Un destin bien ironique pour celui qui, justement, avait fui son propre peuple pour se dispenser d’en combattre un autre.
Le Français s’étonna : s’ils incarnaient l’un comme l’autre l’effrayant colonisateur aux yeux du natif, l’un des deux n’était-il pas superflu ? À quoi bon nourrir un même spécimen en deux exemplaires ? N’y avait-il pas meilleur usage à faire du second ?
À peine eut-il posé la question qu’il trouva lui-même la réponse : quelle plus belle démonstration de la sauvagerie des diables blancs que de les voir s’entre-tuer, car c’était ce combat-là que tous attendaient et attisaient à leur manière.
*
Elle traversa plusieurs villages sans s’y attarder, puis gagna le port de Phonpaï, en mer de Chine. Parmi les navires amarrés, deux seulement semblaient assez puissants pour traverser les océans ; l’un d’eux, battant pavillon portugais, se préparait à rentrer au pays avant une dernière escale à la pointe sud des Indes. Ce fut là son premier choix.
La présence d’une femme sur la passerelle intrigua un matelot, qui alerta le lieutenant, qui se mit en quête d’un homme de son équipage parlant le français. Elle déclara vouloir rentrer en Europe et proposa, sans rien connaître des traversées au long cours, de payer son passage en s’acquittant de toutes sortes de tâches, briquer les ponts, nettoyer les cales, aider en cuisine, servir les officiers. Une fois son laïus traduit en portugais, une trentaine de matelots éclatèrent d’un rire qui créa presque un tangage.
Le lieutenant, tout en redingote, boutons dorés et perruque poudrée, félicita la demoiselle pour son grand courage qui n’avait d’égal que son étonnante naïveté : comment s’était-elle imaginé passer près d’une année en mer au milieu de cent matafs aux manières qu’il qualifia de rustres ? Par ailleurs, comment pouvait-elle ignorer que les marins interdisaient la présence d’une femme à bord parce qu’elle portait malheur ? Comme elle demandait d’où leur venait une aussi stupide superstition, il ne sut quoi répondre mais affirma qu’au moindre incident — attaque de pirates, scorbut, naufrage — elle en serait tenue pour responsable et personne n’hésiterait alors à la jeter à l’eau.
Quand elle eut annoncé vouloir tenter sa chance sur l’autre caravelle arrimée dans le port, le lieutenant cessa toute ironie : sur ce bateau-là on accepterait avec enthousiasme la présence d’une demoiselle. Ses hommes, les pires flibustiers ayant jamais écumé les mers, ne craignaient aucune superstition, pas plus qu’ils ne redoutaient les malheurs qu’une femme pouvait leur causer : c’était plutôt à elle de redouter tous les traitements que ces bandits de haute mer lui feraient subir.
De fait, s’approchant de leur navire, elle aperçut, chargeant des marchandises à bord, une poignée d’hommes si sales et mal accoutrés qu’elle les crut contrefaits. L’un d’eux lui lança de sinistres œillades, un autre vociféra un compliment dont elle comprit aisément la teneur. À les voir prendre à bras-le-corps des quartiers de viande et des tonneaux de rhum, elle comprit qu’en acceptant leur offre elle aussi servirait de ravitaillement, mais d’un autre ordre.
Elle se sentit comme échouée, rejetée par les flots, et il en serait ainsi dans tous les ports du monde. Elle reprit la route à pied, sans savoir qui, de la mer elle-même ou des hommes qui la sillonnaient, ne voulait pas d’elle.
Читать дальше