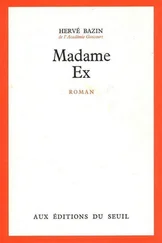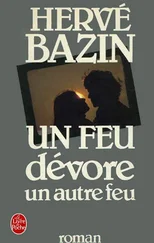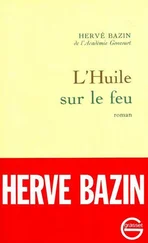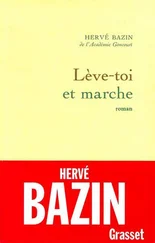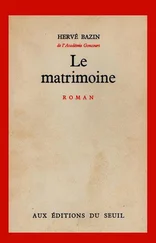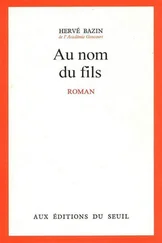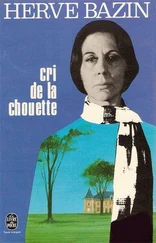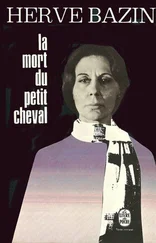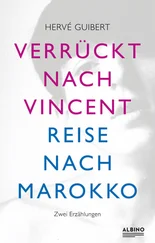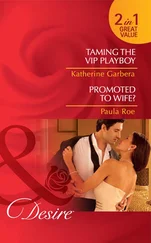Le hasard donc, le même hasard qui fait que l'on naît roi ou pomme de terre, que l'on tire une chance sur deux milliards à la loterie sociale, ce hasard a voulu que je naisse Rezeau, sur l'extrême branche d'un arbre généalogique épuisé, d'un olivier Stérile complanté dans les derniers jardins de la foi. Le hasard a voulu que j'aie une mère…
Mais n'anticipons pas. Sachez seulement qu'en 1913 Jacques Rezeau, mon père, docteur en droit, professeur à l'Université catholique (situation non lucrative, comme il sied), avait épousé la forte riche demoiselle Paule Pluvignec, petite-fille du banquier de ce nom, fille du sénateur du même nom, sœur du lieutenant de cuirassiers du même nom, mort depuis au champ d'honneur (ce qui lui permit de doubler « ses espérances »). Elle avait trois cent mille francs de dot. Trois cent mille francs-or. Elle avait été élevée, vacances comprises, dans un pensionnat de Vannes, d'où elle ne sortit que pour épouser le premier homme venu, du reste choisi par ses parents, trop répandus dans le monde et dans la politique pour s'occuper de cette enfant sournoise. Je ne sais rien d'autre de sa jeunesse, qui n'excuse pas la nôtre. Mon père, qui avait aimé une petite camarade protestante (mais René Rezeau veillait !), épousa cette dot qui lui permit de faire figure de nabab jusqu'à la dévaluation de M. Poincaré. De cette union, rendue indispensable par la pauvreté des Rezeau, devaient naître successivement Ferdinand, que vous nommerez Frédie ou Chiffe, Jean, c'est-à-dire moi-même, que vous appellerez comme vous voudrez, mais qui vous cassera la gueule si vous ressuscitez pour lui le sobriquet de Brasse-Bouillon, enfin Marcel, alias Cropette. Suivirent, m'a-t-on dit, quelques fausses couches involontaires, auxquelles je ne pense pas sans une certaine jalousie, car leurs produits ont eu la chance, eux, de ne pas dépasser le Stade de fœtus Rezeau.
En cet an de grâce 1922, où j'étouffais les vipères, nous étions, Frédie et moi, confiés à la garde de notre grand-mère. Confiés… le mot est un euphémisme ! L'intervention énergique de cette grand-mère, que nous n'avions pas le droit d'appeler mémé, mais qui avait le cœur de ce diminutif plébéien, nous avait sauvés de sévices inconnus, mais certainement graves. J'imagine les biberons additionnés d'eau sale, les couches pourries, les braillements jamais bercés… Je ne sais rien de précis. Mais on ne retire pas ses enfants à une jeune femme sans motifs graves.
Notre dernier frère, Marcel, ne faisait point partie du lot attribué à la belle-mère. Il était né en Chine, à Changhaï, où M. Rezeau s'était fait nommer professeur de Droit international à l'Université catholique de l'Aurore.
Ainsi séparés, nous vivions un bonheur provisoire, entrecoupé de privations de dessert, de fessées et de grands élans mystiques.
Car, je tiens à le dire, de quatre à huit ans, j'étais un saint. On ne vit pas impunément dans l'antichambre du ciel, entre un abbé réformé du service divin pour tuberculose pulmonaire, un écrivain spécialisé dans le style édifiant, une grand-mère adorablement sévère sur le chapitre de l'histoire sainte et des tas de cousins ou de tantes, plus ou moins membres de tiers ordres, nuls en math, mais prodigieusement calés dans la comptabilité en partie double des indulgences (reportons notre crédit d'invocations au débit des âmes du purgatoire, pour que ces nouveaux élus nous remboursent sous forme d'intercessions).
J'étais un saint ! Je me souviens d'une certaine ficelle… Tant pis pour moi ! Affrontons le ridicule. II faut bien que vous puissiez renifler l'odeur de ma sainteté, dans laquelle, toutefois, je ne suis pas mort.
Cette ficelle provenait d'une boîte de chocolats. Ces chocolats n'étaient pas empoisonnés, bien qu'ils eussent été envoyés par Mme Pluvignec — il paraît qu'il faut dire aussi « grand-mère » —, l'encore belle sénatrice du Morbihan. Ces chocolats faisaient partie du protocole sentimental de Mme Pluvignec et nous parvenaient régulièrement trois fois par an : le premier janvier, à Pâques et lors de l'anniversaire de chacun de nous. J'avais le droit d'en manger deux par jour, l'un le matin, l'autre le soir, après avoir fait le signe de croix réglementaire.
Je ne savais pas exactement quel fut mon forfait. Ai-je dépassé le compte permis en profitant de l'inattention de Mlle Ernestine ? Ai-je seulement commis, tant j'étais pressé, un de ces rapides chasse-mouches qui m'attiraient toujours cette remarque indignée :
— Mais c'est un singe de croix que vous faites là, Brasse-Bouillon !
…Je ne sais, mais je fus pénétré de remords et de contrition parfaite. Et le soir, dans ma chambre ( La Belle Angerie est si grande que nous en avions une pour chacun, dès l'âge le plus tendre… Ça fait bien. Et puis ça habitue les enfants à rester seuls dans le noir)… le soir, dans ma chambre, je résolus en parfait accord avec Baptiste (le bout de mon prénom, c'est-à-dire mon ange gardien, un peu valet comme il convient à l'ange gardien d'un Rezeau qui ne peut décemment pas porter seul les petits paquets de ses péchés)… le soir, dans ma chambre, je résolus de faire pénitence. La ficelle de la boîte de chocolats, qui portait l'inscription « A la Marquise », cette ficelle plate, un peu coupante, m'inspira le petit supplice certainement agréable à Dieu. Je me l'attachai autour de la taille et je tordis le nœud, lentement, jusqu'à ce que cela me fît raisonnablement mal. Je serrais, comme pour la vipère, avec beaucoup de conviction au début, avec moins d'enthousiasme au bout de trois minutes, avec regret finalement. Je n'ai jamais été douillet : on ne m'a pas appris à l'être. Mais il y a des limites à l'endurance d'un enfant, et elles sont assez étroites quand on a seulement soixante-douze mois d'expérience du dolorisme expérimental. Je cessai de serrer sous le prétexte que la ficelle, surmenée, pourrait bien casser. Il ne fallait pas détruire mon sacrifice.
Et surtout il ne fallait pas en détruire la trace. Car, enfin, sans aucun doute, Mademoiselle viendrait le lendemain matin me réveiller, comme tous les jours, en disant, comme tous les samedis :
— Allons ! dépêchez-vous, paresseux !… Remercions le bon Dieu qui nous donne encore cette journée pour le servir… C'est le jour de changer votre chemise, Brasse-Bouillon. Au nom du Père et du Fils … Tâchez de la garder propre. Quand on va aux waters, on s'essuie convenablement. Notre Père qui êtes aux cieux…, etc.
Glorieux samedi ! Elle verrait tout de suite la ficelle. Je m'endormis sans savoir que je venais de commettre, en toute naïveté, le péché d'orgueil sous sa forme la plus satanique : l'orgueil de l'esprit !
Mais, Mademoiselle, le lendemain matin, ne s'en douta point.
— Oh ! fit-elle, cet enfant est impossible.
Puis, se ravisant, avec une nuance de considération dans les yeux :
— Jean, Dieu ne permet pas que l'on joue avec sa santé. Je suis obligée d'en référer immédiatement à votre grand-mère.
J'écoutais ces paroles avec une grande satisfaction, mais je feignais, bien entendu, la pudeur et la désolation d'une âme violée. Cinq minutes plus tard, grand-mère, son châle à franges jeté sur sa robe de chambre, se penchait sur moi, m'accablant de reproches. Mais le ton n'y était pas. Le regard non plus, tout luisant de peureuse fierté. Et puis ce doigt, ce long doigt fin de romancière pour enfants de Marie (car elle écrivait un peu, elle aussi), comme il suivait complaisamment la ligne rouge, le stigmate éloquent qui me ceinturait encore !
— Il faut me promettre de ne pas faire de sacrifices sans me le dire. N'est-ce pas, mon petit Jean ?
On ne m'appelait point Brasse-Bouillon, ce matin-là ! Je promis. Grand-mère sortit, hochant la tête, sur le même rythme que Mademoiselle, toutes deux bien incapables de sévir contre un saint. J'eus l'oreille assez fine pour entendre cette recommandation, faite à mi-voix, derrière la porte :
Читать дальше