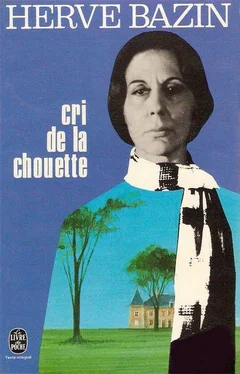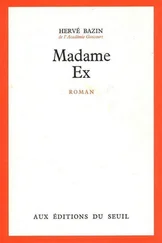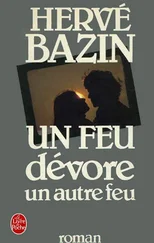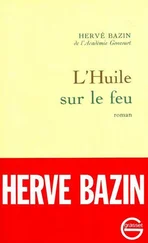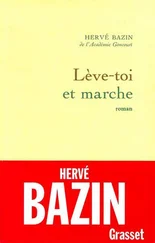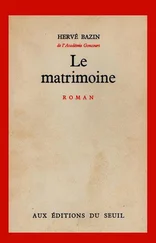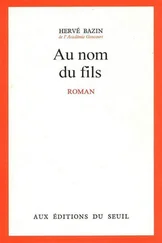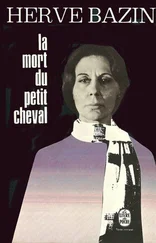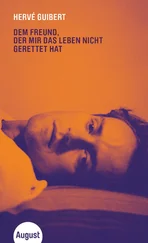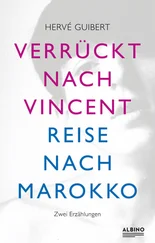D'où, chez moi, l'institution du conseil. Naïveté ? Je ne crois pas. Il ne suffit pas que la vie de famille soit quotidiennement discutable, par tous, compte non tenu des différences de taille (la parole tombe d'une bouche d'homme dans une oreille d'enfant et cette seule gravité fausse leurs rapports). Il faut de temps à autre, dans les cas importants, un décorum, une solennité à bon pouvoir de date, donnant à chacun l'occasion d'en appeler au droit de parole, comme de s'exercer à la citoyenneté, c'est-à-dire au débat, suivi de vote, puis d'obéissance à la loi du nombre. Pas de transformations de la maison, pas d'achat de meubles, pas de location de vacances sans l'avis de tous. Pas de gestion non plus : on ne se figure pas ce qu'ils sont moins exigeants, les gosses, qui ont établi avec vous votre déclaration de revenus. Quant aux punitions, elles gagnent toujours à être discutées et si possible consenties : j'ai vu Jeannet se voter quinze jours de privation de sortie pour un très mauvais carnet de notes, alors que j'en demandais huit. Il est vrai qu'il venait d'avoir douze ans : après cinq ans de voix consultative, il votait pour la première fois.
* * *
Voilà donc Bertille au centre de la table, entre Aubin et Jeannet, tous deux en survêtement rouge à bande blanche. Moi, en face, entre Blandine et Salomé, ma rousse et ma noire, l'une en robe de tricot vert pâle, l'autre en pantalon et chemisier de satin noir, toutes deux n'ayant de commun que leur maquillage. La grand-mère Daroux, grippée, n'occupait pas son bout de table. Mais Mme Rezeau occupait le sien… Elle était venue ! Remontée pour l'inventaire, elle m'avait téléphoné de chez Mélanie pour me demander d'aller la chercher. Elle nous observait sans rire, exploratrice curieuse des mœurs de la tribu :
— Ça marche mieux que l'autorité, vraiment, votre système ? avait-elle dit en s'asseyant. Si vous êtes mis en minorité, vous, parents, vous appliquez la décision ?
Et de tiquer, tout de même, quand, après avoir ouvert le livre de famille et noté les présents, Blandine, « secrétaire de séance », s'était mise à lire :
— Et d'abord une question affectueuse : Estimant qu'une fille de dix-huit ans est seule juge de se donner à l'essai, Maman demande à Salomé, qui a fait confiance à Gonzague, pourquoi elle n'en a pas prévenu ses parents ?
Le visage un peu crispé, mais empreint d'indulgence, Mme Rezeau écoutait Salomé, bien plus à l'aise qu'elle, répondre tranquillement :
— Je pensais vous l'avoir fait suffisamment comprendre et pour le reste je voulais vous éviter le détail.
— Mais, dit faiblement Mme Rezeau, ce n'est pas le silence qui est le plus…
Elle n'acheva pas. Frères et sœur déclenchaient un véritable tir de barrage :
— L'amour, disait Blandine, ce n'est pas une maladie dont la déclaration soit obligatoire.
— Je ne comprends pas, disait Jeannet — pour une fois dans le camp de Salomé. Vous ne me demandez pas le nom de mes amies. Vous préférez même ne pas le savoir. Pourquoi une attitude envers la fille et une autre envers le garçon ?
— Vous ne croyez pas, rétorquait Bertille, que ce qui risque d'allonger la famille la regarde un peu ?
Il y eut un certain flottement, puis la voix de Jeannet laissa tomber :
— Alors si tu nous fais encore un petit frère, préviens-nous par lettre recommandée. On pourrait ne pas être d'accord.
Et aussitôt, exploitant l'effet :
— Tu vois, ça n'a pas de sens.
Madame Mère ne bougeait plus. Elle était loin, loin, réfugiée dans je ne sais quelle époque. La main en cornet derrière l'oreille, elle feignait de mal entendre. Les Chinois aussi, elle les avait connus incroyables : Cette année-là les mandarins détrônèrent Tchou qui avait condamné vingt des leurs, en bonne justice, mais les avait fait empaler sur du bois et non sur de l'ivoire. Cependant mon regard croisait celui de Bertille qui me disait oui, d'un battement de paupières. Oui, n'insistons pas. Nous sommes de la génération de transition, qui se croyait dégagée des tabous, mais ne saurait comme certains membres de la nouvelle considérer l'amour, ci-devant dénommé fornication, comme l'expression même de l'innocence et de la liberté.
— Et toi, Papa, qu'en penses-tu ? disait Blandine.
— Je pense, fis-je doucement, que Salomé a voulu nous ménager. On ne ménage pas ceux qui vous aiment : ils se croient aussitôt mis sur la touche.
— Tu es un affreux ! dit Salomé, la larme à l'œil.
— Bon, dit Bertille, venons-en à la proposition de votre grand-mère. Faut-il racheter La Belle Angerie ?
* * *
Ma mère s'était soudain redressée. Ce n'est sûrement plus la même personne, m'avait téléphoné Paule : cela se confirmait de plus en plus. Malgré des préjugés massifs elle continuait à n'avoir d'yeux que pour la pécheresse. Habituée à manier l'allusion, elle acceptait un colloque où un gamin pouvait brutalement lui dire son fait. Jeannet déjà attaquait ferme :
— Il faudrait d'abord savoir ce que ça signifie, ce rachat, dit-il. Nous sommes des Rezeau débourgeoisés qui n'ont aucune envie de réintégrer la caste. D'accord ?
Point d'objection. Madame Mère jouait avec son double rang de perles, avec cet air double difficile à interpréter.
— Or La Belle Angerie, reprit Jeannet, reste le symbole de ce que nous refusons ; et puis le tas de pierres est trop gros. Vous connaissez mes idées là-dessus. On peut tolérer la propriété dans la limite du territoire nécessaire à tout animal : pour nous, une maison dans un jardin. Mais si le lot augmente, il contredit la nature, il devient…
— Pouce ! fit Aubin. Nous savons par cœur.
— Voilà de bons sentiments, Jeannet ! dit Mme Rezeau, goguenarde. Ton père n'a pas de fortune, mais ne paraît pas dénué de ressources. Il a eu quelques difficultés, durant un temps, mais tout de même en fait de vache enragée, tu n'en as mangé que le filet… Précisons que le tas de pierres ne vaut pas la moitié du prix d'une villa au bord de la mer.
— Excusez-nous, ma mère, dit Bertille. Nous sommes très directs, ici. Je vais l'être aussi et poser deux questions : Avons-nous envie de racheter cette propriété ? En avons-nous les moyens ?
— En avons-nous le droit ? ajoutai-je.
— Comment ça, le droit ? dit ma mère.
Il fallait bien la rappeler au souvenir de ses propres truquages :
— Excusez-moi, mais nous étions, nous sommes toujours trois frères. Un seul a hérité, qui vend. On peut considérer la chose comme une réparation, et, dans ce cas, Fred a son mot à dire.
— Jeannet a de qui tenir, reprit ma mère, mais dans un sens ta position se défend. Fred te donnera sa bénédiction ou, plutôt, il te la vendra.
— Nous n'avons pas fini de payer la maison de Gournay, dit Salomé. Comment nous en mettre une autre sur les bras ?
Déplaçant sa chaise à petits coups, Madame Mère s'était rapprochée d'elle :
— Tu portes mon bracelet, c'est gentil, fit-elle. Je te dirai quelque chose tout à l'heure entre quatre z'yeux… Comment payer ? C'est simple. Je peux faire à ton père une avance d'hoirie dont il n'aurait à me compter que les intérêts, le capital se trouvant automatiquement remboursé à ma mort. Après tout ce serait pour moi un placement comme un autre.
— Passons sur les intérêts et même sur l'entretien, dit Jeannet. Mais une maison sans eau, sans sanitaire et sans chauffage, nous ne l'habiterons que modernisée, au moins en partie. Et voilà une dépense trop lourde pour nous…
— L'objection est sérieuse, cette fois, dit Mme Rezeau. J'y ai pensé. Je rajoute la somme au prêt.
Читать дальше