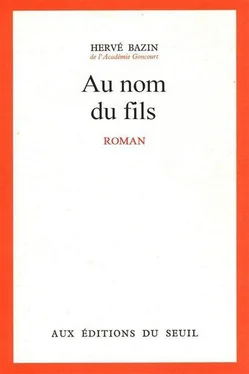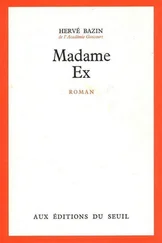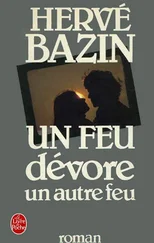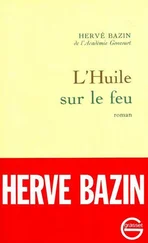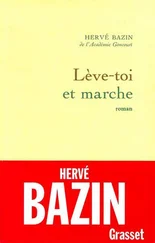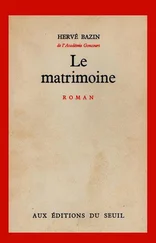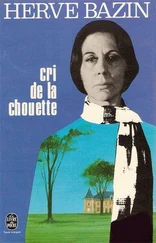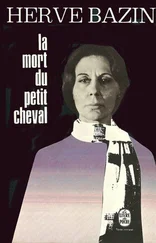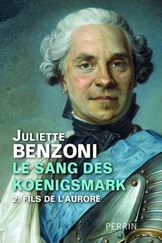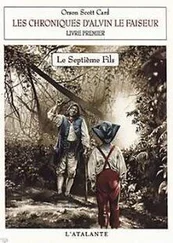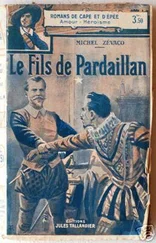« Vous êtes désespérément sage, Daniel, me souffla-t-elle à brûle-pourpoint. Nul n’a rien à vous reprocher, c’est sûr. Mais vraiment, est-ce que vous ne voyez pas que votre femme n’en peut plus, qu’elle s’ennuie à mourir ? »
Elle haussa carrément les épaules avant d’ajouter :
« Votre budget est un peu étroit. Laissez-la donc travailler. Vous aurez deux salaires pour faire un peu les fous. Laure ne demande qu’à s’occuper des petits, avec moi.
— Gisèle ne m’a rien demandé, murmurai-je.
— Elle me l’a demandé à moi. »
Froissé par ce manque de confiance, qui supposait de longs conciliabules, dans mon dos, désorienté, cherchant en vain ce qu’en une telle situation aurait fait ma mère, je résistai deux mois. Puis j’acquiesçai. Gisèle redevint secrétaire, auprès d’un homme politique, alors régnant sur le canton et durant un an sembla retrouver sa gaieté, sa vivacité perdues.
Mais dès l’année suivante les choses, de nouveau, se gâtèrent. Gisèle se mit, sous toutes sortes de prétextes, à rentrer tard. Elle s’absenta même le dimanche pour suivre en tournée ce patron dont j’entendais parler avec une admiration gênante. Elle eut d’autres silences, d’autres regards, qui n’étaient plus ceux de l’ennui, mais de l’angoisse, de la pitié. Elle eut aussi de ces retours, de ces gentillesses qui sentent l’effort et la contrition. Et je ne sais vraiment ce qu’il serait arrivé de notre ménage si le dénouement n’était pas venu, brusquement, de la guerre. Mobilisé, je partis pour l’Alsace où je fus aussitôt blessé, puis fait prisonnier dans une escarmouche de la « drôle de guerre » et c’est dans un stalag que j’appris que Gisèle attendait un nouvel enfant.
Elle était loyale. À mon retour elle m’aurait dit la vérité, à supposer que ce fût nécessaire. Mais je ne devais jamais la revoir. Évacuée sur Anetz, dans la Loire-Atlantique, où les Hombourg ont une bicoque de vacances, « L’Émeronce », au bord du fleuve, toute la famille fut prise dans un bombardement. Gisèle fut tuée dans le wagon, ainsi que son père. Ma belle-mère eut les deux jambes fracassées. Laure et les trois enfants s’en tirèrent indemnes. Je dis : les trois enfants, car entre-temps Gisèle avait accouché d’un fils : Bruno.
Quand je revins, en 1945, il avait cinq ans, Michel et Louise huit. À peine aidée par ma belle-mère, toujours braque, mais infirme, qui ne marchait plus qu’avec deux cannes et ne quittait guère son rez-de-chaussée, Laure, déjà plus femme que jeune fille, les élevait, au 27, côté mair, comme disent les enfants, pour l’opposer au 14, côté pair.
Je ne fis pas de remarques. On ne m’en fit pas non plus. Mais quand j’annonçai mon intention de reprendre les petits, je crus lire dans les yeux de ma belle-sœur une insupportable estime.
« Vous avez été très éprouvé, dit-elle. Si vous voulez, je continuerai à tenir votre ménage.
— Elle continuera, répéta M me Hombourg en me regardant de biais. J’espère pour vous qu’elle ne se mariera pas. »
Ainsi débuta la navette. Je ne parle pas de celle, commune à tous les banlieusards, qui les pousse chaque matin sur Paris pour les ramener entre sept et huit au dortoir. Mais de notre seule originalité : ce va et-vient de Laure, deux fois maîtresse de maison ou, plutôt, deux fois femme de journée, ballottée d’une cuisine à l’autre, sans cesse repartie pour une tisane, sans cesse revenue pour un coup de balai, jusqu’à la dernière traversée qui lui permettait enfin d’aller décemment se coucher chez sa mère.
Et la mécanique se remit à tourner. Un an, trois ans, cinq ans passèrent, presque à mon insu. J’étais redevenu M. Astin, pour trente élèves. Je fus nommé à Villemonble. Les enfants entrèrent à l’école, puis au lycée. Nous eûmes une chienne, un Frigidaire à absorption, un poste de télé. Des comptes bien tenus me permirent même de refaire le toit. La petite vie recommençait, en apparence acceptée par tous. Je n’attendais rien. Je n’espérais rien. Sauf les satisfactions ordinaires : la trêve courte du jeudi, la trêve longue des vacances à la maison d’Anetz, les cajoleries de Louise, la croix de Michel et un peu plus d’efforts de la part de Bruno, dont la paresse m’offensait et dont chacun voulait bien convenir — les paupières baissées — qu’il devenait un enfant difficile.
Il n’y a pas d’illuminations. Le plus bel éclair n’est, en nous, qu’une amorce. À peine nous a-t-il avertis, dénoncés que déjà il s’éteint, nous laissant à d’obscures routines. L’examen de conscience, qui suit, s’y débattra longtemps. Une chose est d’admettre, en gros, sa responsabilité ; une autre, d’entrer dans le détail.
Et puis on ergote. Du haut de mon perchoir, tandis que mes potaches grattaient de la copie, j’en ai passé des heures à revoir mes balances ! Cent fois je me suis accusé. Cent fois je me suis présenté ma défense : « Après tout, quoi, que manque-t-il à ce gosse ? Je le traite exactement comme son frère et sa sœur, je l’embrasse matin et soir, je ne le punis qu’à contrecœur. Il n’a jamais été privé de soins. Je ne lésine ni sur la nourriture ni sur les vêtements. Je lui donne même le superflu : il a un train électrique, une trentaine d’autos miniature, une grue, un vélo, tous ces jouets coûteux des enfants d’aujourd’hui, que je n’ai pas eus à son âge. Il peut gagner cinq cents francs pour une place de premier, deux cent cinquante pour une place de second et ce n’est pas ma faute s’il ne me fait pas, comme Michel, souvent mettre la main à ma poche. Pourtant Dieu sait si je m’occupe de ses devoirs ! Ce n’est pas assez de pionner ici toute la journée, il faut que je trouve encore un tapir à la maison, que je repionne le soir pour lui faire entrer quelque chose dans la tête. »
Une main se levait. Je grognais : « Quoi, Dubois ? Oui, allez-y, mais n’y restez pas un quart d’heure comme d’habitude. » Deux pupitres traîtreusement soulevés abritaient un conciliabule. Je criais : « Laurenti, Martelin, cent lignes ! » et je retombais, le menton dans la paume, les yeux tantôt baissés sur une copie, tantôt relevés sur la salle, mais ne regardant ni l’une ni l’autre. « Tu repionnes, dis-tu ? voilà un aveu. Ce que tu fais pour ton fils, tu en parles comme d’un effort. D’un effort consciencieux, comme le reste. Tu n’es pas homme à te mettre dans ton tort. Tu n’es même pas sévère, c’est vrai, mais ce n’est pas la question. Il y a des gens qui ont une conception très raide de l’éducation et qui n’en aiment pas moins leurs enfants. Ils ont seulement la tendresse dure. Toi, tu fais ton devoir, mécaniquement : recette connue pour y manquer. »
Et je me prenais la tête à deux mains, au risque d’un chahut, laissant dialoguer le professeur et le père. « Allons, allons, disait M. Astin, tu en remets. Tu as une peur bleue d’être mal jugé. Tu es prêt à faire plus que le nécessaire, c’est-à-dire trop, à être un peu moins ferme, c’est-à-dire un peu moins juste, pour en faire accroire. » Mais le père — qui ressemblait encore beaucoup à l’autre, qui ignorait la simplicité — lui répondait sur le même ton : « Le nécessaire ? La justice ? N’est-ce pas justement dans ce qui n’est pas nécessaire, dans ce qui n’a rien à voir avec le juste et l’injuste, qu’il faut chercher ? »
Car je « cherchais », soucieux d’être un père bien, un père convenable, un père qui réussit avec son fils, qui a la paix avec lui-même. La paix ! J’étais encore loin du compte. Et cet homme-là qui pensait à sa paix, plus tard, je le détesterais. Mais de l’indifférence à l’inquiétude, vers l’intérêt, vers l’émotion, vers ces hauteurs où le souffle se perd, où le cœur commence à vous cogner, il y a tout un escalier. Quand je songe à cette période obscure, imprécise — deux ans, trois ans, je ne saurais dire — j’ai l’impression en effet de me voir monter des marches ; et la mémoire aidant — entendez : m’aidant de sa complaisance ordinaire — j’en retiens seulement quelques scènes qui, après coup, semblent marquer un cheminement.
Читать дальше