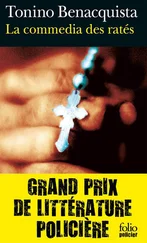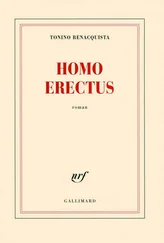– Qu'est-ce qu'il a?
– Tout et rien. Il sent que c'est l'heure. Les toubibs veulent le mettre à l'hôpital. Lui, à l'hôpital!
– Ils n'ont pas tous vu le film.
– Cette scène-là, tout le monde la connaît.
– Le travelling au milieu des draps blancs et des barreaux de lits. Le fils, à l'accueil, qui veut voir son père mourant.
– C'est la dernière chance qu'il a de lui parler…
– … L'infirmier lui dit que les visites sont terminées après neuf heures! Rien que d'en parler, ça me fout des palpitations. Cette scène, mon père me la racontait déjà quand j'étais môme.
– Moi aussi, je me sens toujours un peu gosse quand je repense à ses films. Même si j'en ai écrit certains avec lui.
– Tu te souviens du vieillard qui mange son plat de spaghettis? Juste un petit personnage en arrière-plan. Il fait des gestes incompréhensibles. Au début on rigole, et puis…
– Le bonheur et la nostalgie n'arrêtent pas de se chercher pendant tout le film. Il arrive même à faire passer une pointe de sensualité.
– Tout était splendide, dans ce film. Les rêves de l'idiot du village, la scène du déluge…
– … Et «La partition de l'amour»? Et le moment où Zagarolo se prend pour Dante!
– Il a toujours dit que de tous ses films, c'est celui qu'il aime le moins.
– On ne lui a pas donné la Palme d'Or parce qu'il l'avait eue l'année précédente.
La mémoire en feu, nous enchaînons Martini sur Martini.
– Je ne sais pas ce que je donnerais pour bosser avec un géant comme lui, rien qu'une petite heure.
– C'est une chance unique, mais c'est aussi un piège. Le Maestro n'a pas besoin qu'on lui trouve des histoires, il les a déjà en lui, dès la première séance. Il a seulement besoin d'un type assez fou pour descendre fouiller dans son univers et en ramener des blocs entiers. Parfois il faut y aller avec des bottes d'égoutier. Tu ne sera jamais qu'un pâle reflet de son imaginaire. Et tu seras sacrifie au bout du compte parce que ça restera son film, pour les siècles à venir et pour la terre entière.
Tout à coup, un cri déchire la quiétude de cette fin d'après-midi.
– … LUIGI?… LUIGI. …PER LA MADONNA… LUIGI…!
Louis se lève et saisit la bouteille de Martini.
– Je le connais par cœur. Il sait que nous sommes en train de prendre l'apéro et ça le rend malade de jalousie.
*
Nous avons dîné dehors, incapables de quitter la tonnelle malgré la fraîcheur du soir. Le Maestro n'est pas sorti de sa chambre et s'est contenté d'un petit bouillon. Devant lui, je n'aurais sans doute pas prononcé le moindre mot et les tagliatelles de Louis me seraient restées en travers de la gorge. Nous avons bâfré en buvant ce petit vin de pays tout juste tiré de la barrique. J'ai vu de mes yeux le Vieux préparer des pâtes fraîches sur l'énorme plan de travail des cuisines. Un beau cercle jaune qu'il a plié comme un ruban avant de rne demander:
– Fettucine? Spaghetti? Papardelli? Tagliatelle?
J'ai choisi au hasard, sachant que de toute façon je regretterai les autres. Nous avons passé le reste de la journée à préparer le dîner, surveiller la sauce tomate, cueillir du basilic dans le jardin, dresser le couvert, sans nous presser, en ponctuant nos rares phrases de verres de vin blanc. Je ne lui connaissais pas ce talent de mamma romaine.
– Quand tu travailles avec les Italiens, il faut s'adapter. Combien d'idées géniales ai-je laissées en souffrance parce que l'heure de la pasta avait sonné. Ils sont tous comme ça, et ils l'étaient plus encore dans les années soixante-dix.
Tard dans la soirée, il m'a sorti une grappa extraordinaire à base de truffes blanches.
– Elle vient de Venise. Pour un peu on la porterait en eau de toilette.
– Vous le terminez quand, ce scénario?
– Quand il aura cessé de tourner en orbite autour d'une idée que je n'arrive pas à cerner. Il me fait penser à un peintre dans sa dernière période.
– Un peintre?
– Vers la fin, ils vont tous vers le dépouillement maximal, regarde Turner. Ils gardent un point central, essentiel, le reste autour n'a plus beaucoup d'importance.
– Le Maestro a la réputation d'être un perfectionniste et un bourreau de travail.
– Perfectionniste peut-être, mais bourreau de travail, sûrement pas. Qu'il soit malade ou pas, c'est toujours la même histoire: on s'installe, on bavarde un peu, et dès qu'on est concentrés, il faut qu'il aille jouer au baby-foot ou téléphoner des heures à sa femme. Il revient, on re-bavarde comme des pies, on parle des films qu'on a aimés, de tous ceux que l'on n'écrira pas, on ment beaucoup, et puis c'est l'heure de la pasta. Au total, sur une journée de travail, on peut retenir une bonne demi-heure de rentable. Et puis un jour on s'aperçoit que le film se construit tout seul même si nous n'avons rien sur le papier.
– Je ne suis pas sûr de jamais travailler pour un réalisateur qui transforme tout ce qu'il filme en or.
– Sans vouloir te décourager, cette race-là se fait rare. Les films magiques issus de l'imaginaire d'un seul homme n'intéressent plus personne. Les visionnaires qui se promènent sur les territoires inconnus de l'âme humaine sont déjà en exil.
– Le cinéma aura toujours besoin d'illuminés comme lui.
– Pas sûr. Avant, quelques producteurs fous mettaient encore de l'argent au service d'un art. Aujourd'hui on fait l'inverse. Pourquoi pas, après tout? Des types comme Jérôme vont nous montrer que la logique de l'argent peut aboutir à de belles choses. Qui sait?
Quand il parle de Jérôme, me reviennent en mémoire les regards en coin que nous échangions, au début, lorsque Louis nous évoquait ses années italiennes.
– Tu sais, Louis… Jérôme et moi, les premiers temps, on ne savait pas trop quoi penser quand tu nous parlais des Italiens, du Maestro…
– Vous n'aviez jamais vu mon nom sur un générique et vous vous êtes demandé si je n'étais pas un vieux ringard qui rêvait sa filmographie?
– …
– À cette époque-là, les Italiens avaient compris qu'un film était une conjugaison de talents. Comme dans une bonne engueulade en famille, tout le monde y mettait son grain de sel. Quand un Mario travaillait avec un Dino, un Ettore passait les voir pour lire un bout de script, un Guido venait proposer une idée et appelait un Giuseppe pour avoir son avis sur la question. Ça se téléphonait du Piémont en Sicile: «Viens me sortir de ce merdier, cette putain d'histoire me casse les noix, per la madonna! » Moi, je venais de débarquer au milieu de cette bande, fasciné, avec tout plein d'images et de répliques en tête. Ils m'ont adopté vite fait, les salauds. J'étais leur mascotte, il Francese, je leur portais chance, disaient-ils, et je suis devenu un consultant permanent, le gars qui traîne partout et nulle part. Parfois je passais la matinée autour d'une bonne comédie classique, l'après-midi je faisais des sauts de puce dans une série B, et le soir on dînait à huit ou dix autour d'un film à sketches. J'étais payé par toutes les productions que comptait Rome, je n'avais qu'à être là, soit pour faire les expresses, soit pour écrire l'intégralité d'un dialogue, soit pour raconter mon rêve de la nuit précédente. Comment voulais-tu que mon nom apparaisse où que ce soit? On me disait: «Luigi, le prochain c'est le tien, ça sera ton film, on viendra tous te donner un coup de main.» Mais ce n'était jamais le moment. Tu parles d'une bande d'enfoirés! Qu'est-ce que j'ai aimé ces années-là…
– Tu aurais dû nous raconter, Louis.
– Je serais bien incapable de dire ce qui est de moi dans tous ces films, mais une chose est sûre: j'étais partout. Une image, une réplique, une idée, j'ai laissé ma trace dans vingt ans de cinéma italien.
Читать дальше