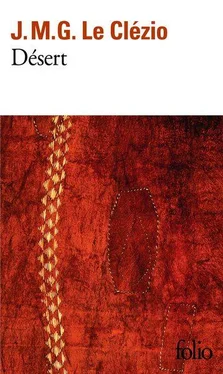« L’émir est arrivé au milieu de la forêt, il a fait descendre sa fille de cheval et il l’a attachée à un arbre. Puis il est parti, pleurant de douleur, car on entendait déjà les cris des bêtes féroces qui s’approchaient de leur victime… »
Le bruit des vagues sur la plage est plus net par instants, comme si la mer arrivait. Mais c’est seulement le vent qui tourne, et quand il se love au creux des dunes, il fait jaillir des trombes de sable qui se mêlent à la fumée.
« Dans la forêt, attachée à l’arbre, la pauvre Leila tremblait de peur, et elle appelait son père au secours, parce qu’elle n’avait pas le courage de mourir ainsi, dévorée par les bêtes sauvages… Déjà un loup de grande taille s’approchait d’elle, et elle voyait ses yeux briller comme des flammes dans la nuit. Alors tout d’un coup, dans la forêt, on a entendu une musique. C’était une musique si belle et si pure que Leila a cessé d’avoir peur, et que toutes les bêtes féroces de la forêt se sont arrêtées pour l’écouter… »
Les mains du vieux Naman prennent les pinceaux, l’un après l’autre, et les font glisser en tournant le long de la coque du bateau. Ce sont elles aussi que Lalla et les enfants regardent, comme si elles racontaient une histoire.
« La musique céleste résonnait dans toute la forêt, et en l’écoutant, les bêtes sauvages se couchaient par terre, et elles devenaient douces comme des agneaux, parce que le chant qui venait du ciel les retournait, troublait leur âme. Leila aussi écoutait le musique avec ravissement, et bientôt ses liens se sont défaits d’eux-mêmes, et elle s’est mise à marcher dans la forêt, et partout où elle allait, le musicien invisible était au-dessus d’elle, caché dans le feuillage des arbres. Et les bêtes sauvages étaient couchées le long du chemin, et elles léchaient les mains de la princesse, sans lui faire le moindre mal… »
L’air est si transparent maintenant, la lumière si douce, qu’on croit être dans un autre monde.
« Alors Leila est revenue au matin vers la maison de son père, après avoir marché toute la nuit, et la musique l’avait accompagnée jusque devant les portes du palais. Quand les gens ont vu cela, ils ont été très heureux, parce qu’ils aimaient beaucoup la princesse. Et personne n’a fait attention à un petit oiseau qui volait discrètement de branche en branche. Et le matin même, la pluie a commencé à tomber sur la terre… »
Naman s’arrête de peindre un instant ; les enfants et Lalla regardent son visage de cuivre où brillent ses yeux verts. Mais personne ne pose de question, personne ne dit un mot pour savoir.
« Et sous la pluie, l’oiseau Balaabilou chantait toujours, parce que c’était lui qui avait apporté la vie sauve à la princesse qu’il aimait. Et comme il ne pouvait plus reprendre sa forme première, il est venu chaque nuit se poser sur la branche d’un arbre, près de la fenêtre de Leila, et il lui a chanté sa belle musique. On dit même, qu’après sa mort, la princesse a été changée en oiseau, elle aussi, et qu’elle a pu rejoindre Balaabilou, et chanter éternellement avec lui, dans les forêts et les jardins. »
Quand l’histoire est finie, Naman ne dit plus rien. Il continue à soigner sa barque, en roulant les pinceaux de poix le long de la coque. La lumière décline, parce que le soleil glisse de l’autre côté de l’horizon. Le ciel devient très jaune, et un peu vert, les collines semblent découpées dans du papier goudronné. La fumée du brasier est fine, légère, elle s’aperçoit à peine à contre-jour, comme la fumée d’une seule cigarette.
Les enfants s’en vont, les uns après les autres. Lalla reste seule avec le vieux Naman. Lui termine son travail sans rien dire. Puis il s’en va à son tour, en marchant lentement le long de la plage, emportant ses pinceaux et la casserole de poix. Alors il ne reste plus, auprès de Lalla, que le feu qui s’éteint. L’ombre gagne vite la profondeur du ciel, tout le bleu intense du jour qui devient peu à peu noir de nuit. La mer s’apaise, à cet instant-là, on ne sait pourquoi. Les vagues tombent, toutes molles, sur le sable de la plage, allongent leurs nappes d’écume mauve. Les premières chauves-souris commencent à zigzaguer au-dessus de la mer, à la recherche d’insectes. Il y a quelques moustiques, quelques papillons gris égarés. Lalla écoute au loin le cri étouffé de l’engoulevent. Dans le brasier, seules quelques braises rouges continuent à brûler, sans flamme ni fumée, comme de drôles de bêtes palpitantes cachées au milieu des cendres. Quand la dernière braise s’éteint, après avoir brillé plus fort pendant quelques secondes, comme une étoile qui meurt. Lalla se lève et s’en va.
Il y a des traces, un peu partout, dans la poussière des vieux chemins, et Lalla s’amuse à les suivre. Quelquefois elles ne mènent nulle part, quand ce sont des traces d’oiseau ou d’insecte. Quelquefois elles vous conduisent jusqu’à un trou dans la terre, ou bien jusqu’à la porte d’une maison. C’est le Hartani qui lui a montré comment suivre les traces, sans se laisser dérouter par ce qui est autour, les herbes, les fleurs ou les cailloux qui brillent. Quand le Hartani suit une trace, il est tout à fait pareil à un chien. Ses yeux sont luisants, ses narines sont dilatées, tout son corps est tendu en avant. De temps en temps, même, il se couche sur le sol pour mieux sentir la piste.
Lalla aime bien les sentiers, près des dunes. Elle se souvient des premiers jours, après son arrivée à la Cité, après que sa mère était morte dans les fièvres. Elle se souvient de son voyage dans le camion bâché, et la sœur de son père, celle qui s’appelle Aamma, était enveloppée dans le grand manteau de laine grise, le visage voilé à cause de la poussière du désert. Le voyage avait duré plusieurs jours, et chaque jour Lalla était assise à l’arrière du camion, sous la bâche étouffante, au milieu des sacs et des fardeaux poussiéreux. Puis un jour, par l’ouverture de la bâche, elle avait vu la mer très bleue, le long de la plage bordée d’écume, et elle s’était mise à pleurer, sans savoir si c’était de plaisir ou de fatigue.
Chaque fois que Lalla marche sur le sentier, au bord de la mer, elle pense à la mer si bleue, au milieu de toute la poussière du camion, et à ces longues lames silencieuses qui avançaient de travers, très loin, le long de la plage. Elle pense à tout ce qu’elle a vu, d’un coup, comme cela, à travers la fente de la bâche du camion, et elle sent les larmes dans ses yeux, parce que c’est un peu le regard de sa mère qui vient sur elle, qui l’enveloppe, la fait frissonner.
C’est cela qu’elle cherche le long du chemin des dunes, le cœur palpitant, tout son corps tendu en avant, comme le Hartani quand il suit une trace. Elle cherche les endroits où elle est venue, après ces jours-là, il y a si longtemps qu’elle ne se souvient même plus d’elle-même.
Elle dit quelquefois : « Oummi », comme cela, très doucement, en murmurant. Quelquefois elle lui parle, toute seule, très bas, dans un souffle, en regardant la mer très bleue entre les dunes. Elle ne sait pas bien ce qu’elle doit dire, parce qu’il y a si longtemps qu’elle a même oublié comment était sa mère. Peut-être qu’elle a oublié jusqu’au son de sa voix, jusqu’aux mots qu’elle aimait entendre alors ?
« Où es-tu allée, Oummi ? Je voudrais bien que tu viennes ici pour me voir, je le voudrais bien… »
Lalla s’assoit dans le sable, face à la mer, et elle regarde les mouvements lents des vagues. Mais ce n’est pas tout à fait comme le jour où elle a vu la mer pour la première fois, après la poussière étouffante du camion, sur les routes rouges qui viennent du désert.
Читать дальше