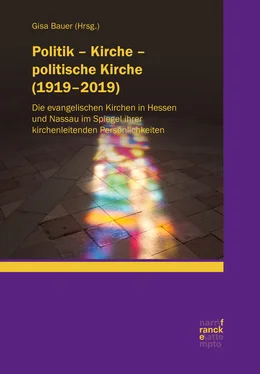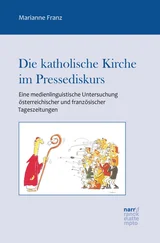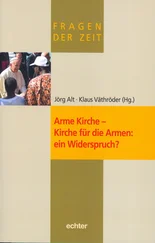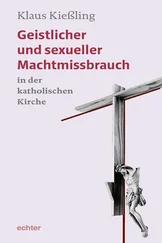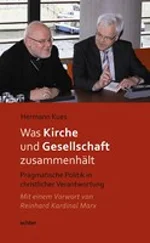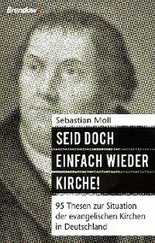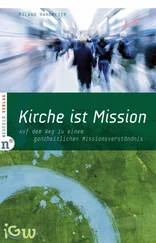Burkert Walter (2011) : La religion grecque à l’époque archaïque et classique [ Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche , 1977], traduction et mise à jour bibliographique par Pierre Bonnechere. Paris : Picard
Goulet-Cazé Marie-Odile (1993) : « Les premiers cyniques et la religion ». In : Goulet-Cazé M.-O. & Goulet R. (éd.), Le Cynisme ancien et ses prolongements . Paris : Presses Universitaires de France
Halfwassen Jens (2008) : « Der Gott des Xenophanes : Überlegung über Ursprung uns Struktur eines philosophischen Monotheismus ». Archiv für Religionsgeschichte 10, 275–294
Ismard Paulin (2013) : L’Événement Socrate . Paris : Flammarion
Kerferd George Br. (1999 [1981]) : Le mouvement sophistique . Paris : Vrin
Kirk Geoffrey Stephen, Raven John Earle & Schofield Malcolm (1983) : The Presocratic Philosophers. A Critical History with a selection of Texts . Cambridge : Cambridge University Press
Meier Christian (2011) : A Culture of Freedom. Ancient Greece and the Origins of Europe . Oxford : Oxford University Press
Morlet Sébastien (2014) : Christianisme et philosophie. Les premières confrontations (l erVI es.) . Paris : Librairie Générale Française, Le Livre de Poche
Narbonne Jean-Marc (2016) : Antiquité critique et modernité . Paris : Les Belles Lettres
Ober Josiah (2017) : L’Énigme grecque. Histoire d’un miracle économique (VIe-IIIe s. avant J.-C.) [ The Rise and Fall of Classical Greece , 2015]. Paris : La Découverte
Popper Karl Raimund (1979) : La société ouverte et ses ennemis [ The Open Society and its enemies , 1945], t. I. Paris : Le Seuil
Popper Karl Raimund (2011) : À la recherche d’un monde meilleur [ Auf der Suche nach einer bessern Welt , 1984]. Paris : Les Belles Lettres
Sedley David (2013) : « The Atheist Underground ». In : Harte V. & Lane M. (eds.), Politeia in Greek and Roman Philosophy . Cambridge : Cambridge University Press, 329–348
Stroumsa Guy (1999) : La formazione dell’identità cristiana . Brescia : Morcelliana
Villavicencio Manuel Vasquez (2017) : « La double approche sceptique à l’égard de la divinité ». Phare 17, 193–214
Whitmarsh Tim (2015) : Battling the Gods. Atheism in the Ancient World . New York : Alfred A. Knopf
Le vide sans qualité chez Lucrèce et Leopardi
Ada Bronowski
On analyse le concept du vide chez les anciens, Épicure et Lucrèce, et on identifie chez le moderne, Leopardi, lʼapprofondissement dʼune spécificité amorcée chez Lucrèce. Cʼest lʼabsence même de toute qualité du vide qui fait lʼobjet dʼétude de ces derniers qui théorisent la pure négativité du vide comme la clef de la transformation continue de la matière. Le vide est garant de lʼinfini renouvellement du possible. Ainsi, une vision pessimiste du monde humain est mise en perspective par lʼavènement dʼautres mondes, peut-être meilleurs mais probablement sans lʼhomme. La connaissance du vide est donc notre consolation à rebours.
Nous avons deux buts dans cet article : le premier est de rendre compte dʼune spécificité de la philosophie de la physique chez Lucrèce, poète-philosophe du Ier siècle de notre ère, qui se démarque dʼÉpicure, son maître dont les écrits datent du III esiècle avant notre ère, sur le rôle du vide. Le deuxième est de faire valoir ce contraste grâce à une analyse de lʼinterprétation du vide chez le poète-/philosophe italien, Giacomo Leopardi (1798–1837). Leopardi saisit un aspect de lʼanalyse du vide amorcé chez Lucrèce mais qui y reste sous-exploité, notamment la capacité, par sa pure présence, de réaliser dʼinfinies possibilités, précisément grâce à lʼabsolue négativité du vide, cʼest-à-dire grâce à lʼabsence totale de qualité – ce qui devient en soi une propriété caractéristique du vide. Ce nʼest pas une étude historiciste de la réception de Lucrèce chez Leopardi que nous proposons1, mais lʼidentification dʼune affinité intellectuelle qui converge sur cette même connaissance ou reconnaissance de la qualité négative du vide. Grâce à lʼapport de Leopardi, on sera plus à même de réévaluer le contraste entre Lucrèce et Épicure sur la question du vide, que lʼon a plutôt tendance, dans les études modernes de la philosophie épicurienne, à ignorer ou à voir comme une pure et simple continuation de la pensée dʼÉpicure.
1. Un pessimisme partagé : entre tragédie et comédie
Le rapprochement entre les univers poétiques et philosophiques de Leopardi et Lucrèce a été maintes fois abordé. On souligne ainsi chez Lucrèce lʼanticipation subtile du pessimisme dont Leopardi fera son étendard – un pessimisme contenu sous la surface chez Lucrèce, et qui le distingue de son maître Épicure. Cʼest le critique et philologue italien Carlo Giussani qui saisit ainsi la sève toute particulière de ce pessimisme-là, qui se fabrique à partir de la prise de conscience chez Lucrèce que le bonheur tranquille épicurien résulte de la rencontre de forces opposées, cʼest-à-dire que ce bonheur nʼest gagné quʼau prix dʼun déni ou rejet conscient de tendances opposées existantes – et qui ne cesseront pas dʼexister. Dans une formule qui cherche tout dʼabord à identifier la différence de Lucrèce dʼavec Épicure, Giussani observe que « la comédie épicurienne de la nature devient quasiment une tragédie chez Lucrèce », où le poète qui « chante le système philosophique le moins pessimiste de toute lʼAntiquité », non seulement « ne sourit guère, mais, presque toujours sévère, et bien souvent en colère, nous rappelle plutôt le pessimisme de Leopardi1 ».
Cette comédie épicurienne, la comédie du hasard sur fond de chute éternelle et infinie des atomes, a été incarnée dans lʼhistoire de lʼépicurisme – nous ne ferons que le rappeler au passage ici2 – par la figure du philosophe qui rit, qui nʼest autre que le philosophe atomiste, Démocrite. Ce Démocrite rieur, pour citer Sénèque, « ne trouvait rien de sérieux dans ce que tout le monde prenait sérieusement3 ». Dans ce même passage, Sénèque reprend aussi ce que lʼon retiendra dans toute la tradition de transmission de cette figure-là4, notamment lʼopposition au Démocrite rieur de lʼHéraclite pleureur, qui renforce lʼeffet du rire épicurien comme « victoire » de lʼinsouciance, théorisée et rationnelle, sur le constat dʼinsignifiance cosmique de lʼaction humaine5. Cʼest Épicure qui y insiste quand il écrit qu’« il faut rire en même temps que lʼon fait de la philosophie et que lʼon vaque aux affaires de tous les jours6 ». En considérant le rire comme accompagnant ainsi tous les moments de notre vie, Épicure ne conteste pas que lʼon se consacre aux actions quotidiennes mais il met ces actions en perspective, en leur ôtant leur importance. Le rire quʼil préconise nʼest donc pas le rire cynique du « à quoi bon ? », mais bien le rire de la comédie où les sujets, tout en sachant que ce quʼils font est sans grande importance (vu quʼils ne doivent jamais perdre de vue les conclusions de la philosophie), se consacrent tout de même à ces occupations, dans la bonne humeur, voire dans la jouissance – ce que la tradition, dominante depuis lʼAntiquité, de mépris à lʼégard de lʼépicurisme a vite fait dʼinterpréter comme le signe que les Épicuriens ne se consacrent quʼaux seuls plaisirs physiques et immédiats.
Mais entre le rire (sans amertume cynique) et les larmes du sentimental, il y a une brèche qui sʼouvre, peu ou pas approfondie dans lʼAntiquité – si ce nʼest en tant que condition médicale, celle de la mélancolie, traitée dans le corpus des écrits médicaux car elle est essentiellement comprise comme une défaillance physiologique7. Dans cette brèche se développe chez Lucrèce, pour reprendre la fameuse formule de Miguel de Unamuno, un certain « sentiment tragique de la vie8 ». Cʼest là où, tout en restant fidèle à lʼinsouciance épicurienne qui brave le défaitisme cynique, Lucrèce ne peut sʼempêcher de rendre compte de la tristesse du monde des hommes. Unamuno parle bien en effet de Lucrèce comme celui qui « masque, sous lʼapparente sérénité de lʼataraxie épicurienne, tant de désespoir9 ». Ce nʼest pas un pur hasard si, quatre siècles après la mort de Lucrèce, Saint Jérôme rapportera une anecdote (dont on a suffisamment dit quʼelle est inventée de toutes pièces10) selon laquelle Lucrèce serait mort suicidé, dans un excès de folie et malade dʼamour11. Si cette fin, ou du moins ses raisons ne sont ni vérifiables ni plausibles, elles ont été fabriquées à la suite dʼune mythologie dont la source première est bien évidemment le texte même de Lucrèce, où une tendance aux images grandioses et désespérantes (il suffit de penser aux dernières pages du poème qui décrivent de façon visionnaire et apocalyptique la peste dʼAthènes) sʼimmisce dans la présentation de la philosophie tant admirée – aussi parce quʼelle sait consoler et guérir12 – dʼÉpicure.
Читать дальше