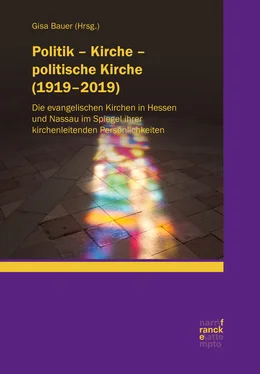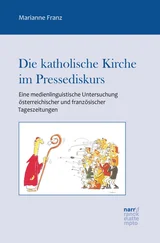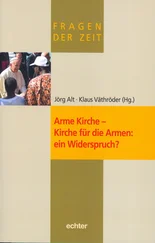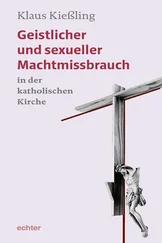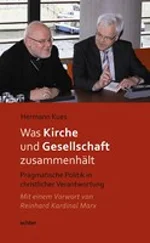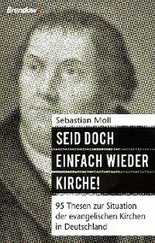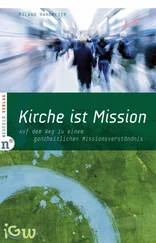La tradition hénologique est un autre bel exemple de modération ou, disons, de stricte économie théologique. Par le moyen du concept d’« unité », la méthode hénologique parvient à dégager une sorte de substructure de la réalité tout entière23, chaque niveau de réalité pouvant être ramené à un certain coefficient d’unité, jusqu’à ce qu’on parvienne à la notion d’une unité parfaite, un « un » purum qui n’est rien d’autre qu’unité et prend dès lors le nom, avec une majuscule, de l’« Un ». On peut même aller plus loin dans la maigreur théologique, en posant que le nom de « Un » lui-même n’est qu’une désignation extrinsèque et finalement fausse ou inadéquate24, une façon commode de référer à soi-même ce principe premier inexprimable ou ineffable, sorte de trou noir métaphysique en lequel tous les noms se défont ou s’effilochent, à la manière des trous noirs cosmiques en lesquels les objets se spaghettisent et la lumière elle-même, on le sait, s’évanouit.
La méthode hénologique apparaît ainsi comme une échelle qu’on rejette une fois parvenu au sommet. Dans ces conditions, c’est le principe du ἄφελε πάντα clôturant le traité 49 (V 3), c’est-à-dire le principe du « retranche tout » ou du « élimine tout », qui s’impose désormais25. Certes, l’idée même de la principialité demeure, dans la mesure où ce qu’on dénomme l’« Un » est bien source et puissance de toutes choses26, mais l’entité ou la chose qu’elle incarne ou représente, en fait la « non-chose », puisque Plotin place l’Un en-deçà du « quelque chose27 », se révèle une non-chose étrange ou merveilleuse comme on voudra (VI 9 [9] 5, 30 : θαῦμα), ou encore un certain infini (VI 9 [9] 6, 10 ; VI 7 [38] 32, 15), qui en un sens franchit même l’appellation de dieu : « si tu le penses comme Intellect ou comme Dieu, observe Plotin, il est plus28 » (6, 12).
À partir de là se produit une sorte de révélation en forme de chiasme, où la certitude se mêle à l’indétermination de la source, au caractère sans forme (VI 7 [38] 17, 18 ; 33, 21) du principe qu’on rejoint par l’inconnaissance (VI 9 [9] 7, 18–19). Il y a un passage de Plotin remarquable sur ce point, à la fin justement du traité 49 :
Mais à ce moment-là, il faut croire qu’on a vu (χρὴ ἑωρακέναι πιστεύειν), quand l’âme soudain (ἐξαίφνης) a reçu une lumière : c’est de lui et c’est lui. Et à ce moment-là, il faut penser qu’il est présent (χρὴ νομίζειν παρεῖναι), quand, comme pour un autre dieu qu’on appelle dans sa maison, il est venu et a illuminé. Car non, s’il n’était pas venu, il n’aurait pas illuminé. Oui, c’est ainsi que l’âme non illuminée est sans ce dieu-là, sans sa vision. Mais quand elle est illuminée, elle a ce qu’elle cherchait et là est le but (τέλος) véritable de l’âme : toucher cette lumière et la contempler par elle-même, non pas la lumière d’autre chose, mais contempler la lumière même par laquelle elle voit […]. Et comment cela peut-il avoir lieu ? Retranche toutes choses29.
Voilà des expressions bien étranges : « il faut croire qu’on a vu », « il faut penser qu’il était présent », parce qu’au fond, le fait est qu’on ne sait pas exactement ce qu’on a vu , ni finalement si on l’a vu , même si la certitude que quelque chose a eu lieu ne semble pas pouvoir être mise en doute. S’il a illuminé, il faut bien croire qu’il est venu – même si comme tel je ne l’ai pas vu, puisque je n’ai vu qu’une lumière – car « s’il n’était pas venu, raisonne Plotin, il n’aurait pas illuminé » ! Plotin, de manière éminemment audacieuse, nous mène au-delà du seuil de la choséité, dans un exercice de vision à terme dématérialisée et dont seule l’expérience du « je » peut rendre compte, même si le témoignage ici est forcément en-deçà de l’événementialité dont il s’agit. Dès son premier traité, Plotin avait d’ailleurs parlé de la certitude liée à la vision : « Si donc quelqu’un l’a vu (εἶδεν), il sait (οἶδεν) de quoi je parle30 », jouant alors de la proximité lexicale εἶδεν/οἶδεν (voir/savoir), qui en grec ont tous deux même racine, puisque οἶδα est un vieux parfait à alternance vocalique mais à sens présent du verbe voir (ὁρᾶν) dont l’aoriste est εἶδον, d’où le couple εἶδεν/οἶδεν (voir/savoir). On pourrait en quelque sorte traduire : « si donc quelqu’un l’a vu (εἶδεν), il sait pour l’avoir vu (οἶδεν) de quoi je parle ». La certitude est absolue, mais en même temps elle est nue ou quasi vide : on sait pour sûr avoir vu quelque non-chose, mais on ne sait quoi.
Si révélation il y a, chez Plotin, son message est blanc, ne présente d’autres exigences que l’exercice de la vertu et l’effort d’unification qui l’accompagne. Oui, vertu et sobriété intellectuelle, voilà en quoi consiste la recherche d’absolu plotinienne. Parlant de sa philosophie, celui-ci insistera sur le caractère humble et hésitant de la démarche qui est la sienne, loin de l’arrogance et des certitudes :
Le genre de philosophie (εἶδος φιλοσοφίας) que nous poursuivons, en plus de l’ensemble de ses autres bienfaits, manifeste aussi la simplicité de caractère, assortie de la pureté de la réflexion, une philosophie qui, poursuivant ce qui est digne, et non pas ce qui est arrogant (αὔθαδες), dispose d’une hardiesse (θαρραλέον) empreinte de raison, de beaucoup d’assurance (ἀσφαλείας) et de précaution (εὐλαβείας), et d’une très grande circonspection (περιωπῆς)31.
Pour conclure sur tout ceci, je dirais qu’à la base, la tradition grecque nous offre soit des récits mythiques modulables et variés sur les dieux et la façon de s’y rapporter, soit plusieurs modèles spéculatifs de théologie faible ou minimale, des approches négatives ou épurées, c’est-à-dire confinant à l’admission pure et simple de l’existence d’un certain principe transcendant dont on ne connaît rien, au-delà de la supposition de sa présence comme instance possiblement organisatrice.
3. Les Grecs anciens et nous
À partir de ce qui vient d’être énoncé, le lien avec notre situation actuelle apparaît incontestable. Si la culture grecque incarne la pluralité et l’opposition des points de vue sur les questions ultimes, on peut croire qu’il existe une certaine isomorphie entre ces traits culturels et la disposition d’esprit qui est la nôtre. Dans un texte issu d’une conférence de 1958, intitulé « En quoi croit l’Occident », Karl Popper, insistant pour rappeler que, de manière tout au moins définitive, « il n’y a rien que l’on puisse prouver », mais qu’il est évident qu’« on peut avancer des arguments et soumettre des points de vue à l’examen critique1 », Popper donc en venait à cette déclaration selon laquelle c’est « la discussion critique [qui] est le fondement de la libre pensée de l’individu2 ». Et on sait que pour lui, cette tradition bien spéciale de la discussion critique, et qu’on peut appeler la tradition du rapport critique à la tradition , remonte pour l’essentiel à la Grèce ancienne3. Maintenant, qu’en est-il du problème de la croyance ? Popper répondait : « Nous devrions être fiers de n’avoir pas une , mais de nombreuses idées, de bonnes et de mauvaises ; de n’avoir pas une croyance, une religion, mais de nombreuses, bonnes et mauvaises », et il conclut que si l’Occident « s’unissait autour d’ une idée, d’ une croyance, d’ une religion, cela serait la fin, notre capitulation, notre soumission inconditionnelle à l’idée totalitaire4 ». Il va de soi que si on entretient ce point de vue, on s’éloigne de la thèse d’un Occident essentiellement chrétien ou d’une Europe fondamentalement chrétienne, idée qu’on entend de plus en plus fréquemment ces derniers temps5, non pas que le christianisme ne forme pas, de fait, un élément important de la tradition européenne, mais parce qu’il a d’entrée de jeu baigné dans l’hellénisme, s’est trouvé initialement mêlé à sa forte conceptualité, à sa diversité radicale aussi, et qu’il s’est ainsi d’entrée de jeu trouvé dilué doctrinalement. C’est comme cela que le christianisme a pu devenir peu à peu, bon gré mal gré, le véhicule d’autre chose que de simplement lui-même. Or le danger du fanatisme, qu’il soit chrétien, musulman ou juif, est toujours là, inscrit dans une certaine mesure dans le code même du monothéisme, dans la mesure où le monothéisme a quelque chose de la Gegenreligion . Dans ce qu’on pourrait appeler l’ hénothéisme ou le monothéisme inclusif , l’idée du dieu premier coexiste naturellement avec la présence possible d’autres dieux et par extension d’autres croyances ; en revanche, le monothéisme exclusif contredistingue la religion de l’unique et vrai dieu, de celle des fausses croyances en plusieurs dieux, ou en un seul dieu mais autre que celui qu’elle reconnaît elle-même6. De ce point de vue-là, comme on l’a fait remarquer, il est clair que la cultuelle antique pourrait a contrario « contribuer à réduire l’un des maux qui accablent [notre société], à savoir le conflit religieux 7 », et il est manifeste aussi que ce n’est pas le christianisme en tant quel tel – ou le judaïsme ou l’islam – qui peut mener éventuellement à la terreur et à l’inhumanité, « c’est bien plutôt l’idée d’une idée une, unitaire, la croyance en une croyance une, unitaire et exclusive8 ».
Читать дальше