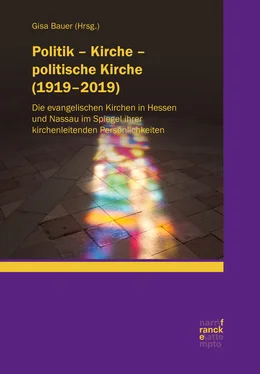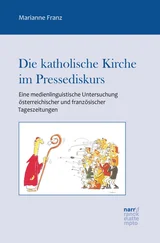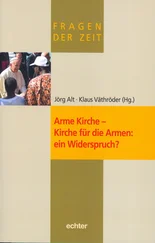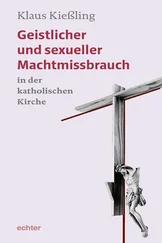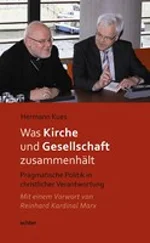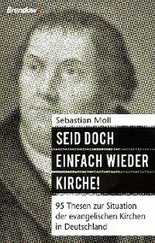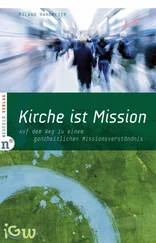1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Il se trouve que la seule entité réunissant les deux critères, cʼest-à-dire dʼun côté le caractère incorporel, et de lʼautre le fait de posséder un statut ontologique indépendant, cʼest le vide. Mais ce nʼest pas son incorporéité qui donne son statut dʼexistence au vide. Bien plutôt, cʼest sa nature dʼêtre en soi, entièrement, qui le distingue de la dépendance dans laquelle se trouvent les accidents des choses. Ces accidents qui eux non plus ne sont pas des corps, et devraient alors être incorporels. On peut donc être incorporel sans pour autant exister.
Ce ne sont donc pas les qualités dʼune chose qui donnent à cette chose son statut ontologique quel quʼil soit (indépendant en soi ou dépendant non-existant), vu quʼelles nʼont, elles-mêmes, aucune existence indépendante. En se réappropriant la formule platonicienne du kathʼheauto , en soi, Épicure opère ainsi un double détournement : (i) alors que lʼabsence ou la présence dʼaspects sensibles sont déterminants pour ses rivaux (Platoniciens ou Aristotéliciens) quand il sʼagit dʼétablir le niveau dʼexistence dʼune chose (en perpétuel devenir pour les uns, ou proprement existant pour les autres), Épicure montre que la présence (que ce soit par inhérence, ou par accompagnement) de qualités est ontologiquement complètement indifférente. Deuxièmement (ii), Épicure fait de lʼincorporel une qualité. Une qualité, il faut le souligner, bien particulière, vu quʼil sʼagirait de la qualité de ne pas avoir de qualité. Mais là encore, il faut faire une distinction entre, dʼune part la dépendance ontologique de toutes les qualités (y compris celle de ne pas avoir de qualité), et dʼautre part lʼexistence en soi du vide. Le fait dʼêtre incorporel pour le vide, cʼest comme le fait dʼavoir ses qualités pour un corps. Ainsi, il y a des qualités qui constituent une « nature pleine » ( plērē phusis ), il sʼagit là de la nature de lʼatome8, et il y a lʼincorporéité qui donne sa « nature intangible » ( anaphē phusis ) au vide9. Cʼest donc bien quʼêtre incorporel pour le vide est lʼéquivalent dʼavoir des qualités pour les corps.
Du point de vue ontologique, les qualités du corps, dʼun côté, et lʼabsence de qualité quʼest lʼincorporéité, de lʼautre, sont sur le même plan, cʼest-à-dire, inexistants « accompagnateurs10 » de leurs existants respectifs, le corps et le vide.
Cette insistance sur la séparation de la question du statut ontologique indépendant du vide de celle de son incorporéité témoigne du souci majeur chez Épicure de défendre la présence du vide comme entité métaphysique constitutive de lʼunivers. Il fait ainsi dʼune pierre deux coups : en attaquant les Platoniciens pour avoir associé, ou plutôt confondu, dans leurs Formes Platoniciennes, indépendance ontologique et caractérisation qualitative ; mais en attaquant aussi ses rivaux les plus proches, les Stoïciens, pour avoir donné une caractérisation positive au vide, outre son incorporéité.
Pour les Stoïciens, si le vide est présent, et est incorporel, il lʼest hors du monde, il est de fait partout autour du monde ; il est, pour ainsi dire, pour le monde, à sa disposition, puisque sa caractérisation consiste précisément en ce quʼil est là prêt à être occupé par le cosmos le jour de sa destruction. Il est ainsi par définition « ce qui peut être occupé » et donc ne lʼest pas encore11. Il ne sera, dʼailleurs, jamais occupé entièrement, car il est infini, mais permettra au monde de se régénérer en lui fournissant un lieu pour le faire.
Il y a donc pour les Stoïciens une évolution du monde, ainsi quʼune fin et une régénération anticipées, grâce à la relation du cosmos au vide, et même, devrions-nous dire, en vertu même de cette relation. Cela est important pour les Stoïciens : car cette relation garantit le rationalisme du cosmos, qui est un monde clos parfaitement agencé et qui, parce que les choses ne peuvent pas être autrement, recommencera à partir de ses cendres dissoutes dans le vide exactement comme la fois précédente (cʼest le principe de lʼéternel retour). Les possibilités de réalisation des corps sont donc finies, limitées par le vide infini qui les encercle. Il nʼy a cependant pas de vide à lʼintérieur du cosmos : là, tout touche tout.
Épicure pointe le doigt sur ce qui permet cette vision close et rationnelle des Stoïciens : cʼest le vide avec qualité, même sʼil nʼen a quʼune : celle de pouvoir être occupé.
Mais en faisant de lʼincorporéité, non pas la marque dʼune indépendance ontologique, mais la qualité du vide qui correspond justement à la négation du fait dʼavoir des qualités, Épicure retire lʼobstacle (ou la garantie, selon les points de vue) qui maintient, chez les Stoïciens, le vide hors du monde. Le vide existant fait irruption dans le monde, et avec lui lʼinfini des possibles, car sa présence libère la matière.
Le débat est donc métaphysique dʼabord, cʼest-à-dire concentré sur la structure cosmologique, avant que dʼêtre une question de physique. Si le vide se distingue des corps par sa nature intangible, tandis que les corps ont une nature tangible, ce ne sont là que des différences de manière dʼêtre au monde, et non de structure ontologique.
3. Lucrèce : présence du vide
Quand il arrive que ce point de doctrine essentiel passe au monde latin dans la langue innovante et imagée de Lucrèce, le double niveau (le statut ontologique indépendant et ses qualités) se voit traduit de façon surprenante. Lʼélève et passeur de la philosophie dʼÉpicure choisit, pour traduire la pensée de son maître sur le vide, le terme augmen , dont la traduction et lʼinterprétation deviennent un vrai terrain de bataille. Car augmen en latin, comme les mots français qui en dérivent étymologiquement, appartient au champ lexical de la masse, de lʼaugmentation, et ainsi semble sʼapparenter naturellement au corporel. Lucrèce écrit :
Car toute chose, quoi quʼelle soit, devra être une chose en soi
Par son augmen , grand ou petit, du moment quʼelle existe.
Sʼil sʼagit dʼune chose tangible, toute frêle et ténue quʼelle soit,
Elle fera croître la quantité de corps, et ajoutera à la somme totale.
Sʼil sʼagit dʼune chose intangible,
Elle sera incapable dʼempêcher que tout corps mouvant la traverse de tous les côtés,
Il sʼagit alors de cet espace vacant que lʼon appelle le vide.
₁ Nam quodcumque erit, esse aliquid debebit id ipsum
₂ augmine vel grandi vel parvo denique, dum sit;
₃ cui si tactus erit quamvis levis exiguusque,
₄ corporis augebit numerum summamque sequetur;
₅ sin intactile erit, nulla de parte quod ullam
₆ rem prohibere queat per se transire meantem
₇ scilicet hoc id erit, vacuum quod inane vocamus1.
La bataille dʼincompréhension commence donc avec ce quʼon a pris pour un usage incongru du mot augmen , qui indiquerait quelque chose de quantifiable ; il est dʼailleurs souvent traduit par le mot « masse » en français. Or, il semble bien quʼici Lucrèce octroie aussi bien au corps tangible quʼau vide intangible un augmen .
Comment peut-on concevoir un vide avec de lʼ augmen ? Cela semble, et a semblé être, un oxymore, et même un contresens, tant et si bien que dans les éditions modernes du texte, depuis la fameuse grande édition de 1850 de Karl Lachmann, on a imprimé le texte de Lucrèce en inversant lʼordre des vers : plaçant le deuxième vers après le troisième pour que augmen décrive exclusivement le corps tangible. Lachmann est suivi par Alfred Ernout dans son édition aux Belles Lettres de 1920 (et toujours réimprimée depuis) ainsi que par Cyril Bailey pour lʼédition dʼOxford. Mais lʼordre donné ci-dessus est bien lʼordre que lʼon trouve dans tous les manuscrits et cʼest lʼordre que choisit dʼimprimer lʼédition de Josef Martin chez Teubner de 1934 ; nous nous proposons de le défendre ici.
Читать дальше