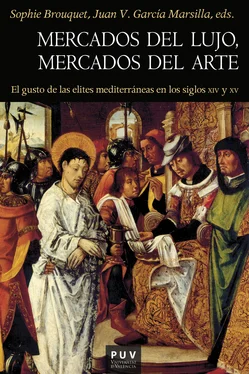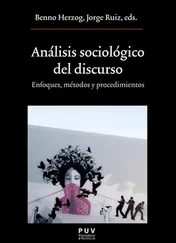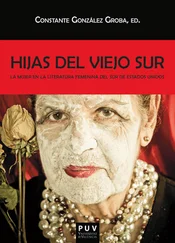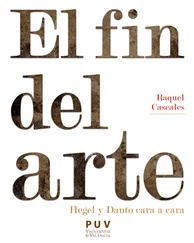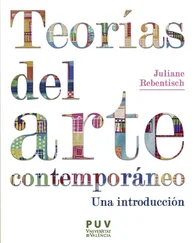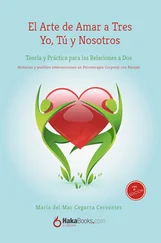1 ...6 7 8 10 11 12 ...48 De nouvelles familles sont apparues au XIII esiècle grâce à leur réussite dans les métiers du change, de la draperie, de l’épicerie comme les Blazy, les Quimbal, les Boix, les Astorg, ou les Ysalguier. Ils achètent des fiefs nobles et se font anoblir. 23 D’autres lignages n’ont pas encore franchi le pas, mais ne s’en allient pas moins à des lignages de la noblesse locale et affichent un mode de vie aristocratique.
Si l’on en croit le registre des Estimes du Bourg de Toulouse en 1335: sur 1.163 fortunes familiales, 50% sont cotées à moins de 100 livres; à l’opposé, 70 familles ont plus de 1.000 livres. Le plus riche contribuable, Guilhem Garrigues, un marchand, possède une fortune estimées à 14.160 livres avec six beaux hôtels particuliers et leurs boutiques, 10 hectares de prés, 1 hectare de vigne et deux métairies. Une fortune qui semble malgré tout liée à une réussite et temporaire qui ne s’enracine pas dans la durée.
Malgré les difficultés dues à la guerre de Cent Ans, le commerce et le change demeurent des moyens d’ascension remarquables au cours des deux derniers siècles du Moyen Âge. Les élites toulousaines trouvent une solution à leurs difficultés économiques dans le pastel.
Dès la deuxième moitié du XIV esiècle, les exportations de cette plante tinctoriale augmentent en direction de l’Angleterre, pourtant en lutte contre la France. Le deuxième débouché est la Catalogne, en particulier Barcelone soit par la voie côtière, soit par la voie maritime à partir du port de Narbonne. 24 Dans les années 1350-1450, le pastel toulousain s’exporte dans deux directions, l’Angleterre par Bayonne, la Catalogne et Valence et Carthagène par Narbonne. Le derniers quart du XV esiècle voit une arrivée massive d’acheteurs castillans, en particulier de Burgos qui accaparent le marché. 25 À Toulouse même, cette richesse due au pastel favorise l’essor d’une draperie de luxe à la fin du XV edont profitent certains lignages toulousains comme les Lancefoc, ou les Assezat. 26
Au centre de l’isthme atlantique, la capitale languedocienne profite de sa situation géographique avantageuse entre Océan et Méditerranée pour devenir un centre d’exportation et d’importation du commerce de luxe.
Cependant, une autre catégorie sociale profite de la conjoncture troublée des deux derniers siècles du Moyen Âge. Restée fidèle au roi de France pendant toute la guerre de Cent Ans, la capitale languedocienne est largement récompensée par la monarchie. Les juristes formés dans son université trouvent à s’y employer auprès des capitouls, mais aussi des offices royaux et pour finir du Parlement installé définitivement à Toulouse en 1444. 27 Un nouveau groupe se constitue au sein de l’élite, celui de la noblesse de robe, très étroitement liée cependant aux anciens lignages et aux familles marchandes par des alliances matrimoniales. L’exemple en est fourni par Bernard Lauret, professeur de droit canon et civil à Montpellier, il est avocat auprès du parlement de Toulouse dès 1461 et devient son premier président de 1472 à 1495. Il achète la seigneurie de Merville et fonde une dynastie de parlementaires qui ne dédaigne pas les alliances avec le milieu des riches marchands pasteliers. 28
Tandis que des lignages disparaissent, d’autres surgissent dans une société urbaine où la mobilité et l’instabilité l’emportent. 29
Consommation et marché du luxe
La manne fournie par la commercialisation du pastel du Lauraguais permet en retour l’achat d’articles de luxe. Déjà au XIII esiècle, des marchands toulousains sont présents aux foires de Champagne y vendant fourrures, draps et épices. Au XIV esiècle, la ville entretient des liens commerciaux étroits avec la péninsule ibérique, mais aussi l’Italie, et l’Angleterre à laquelle elle vend du vin contre de la laine. 30 Ces relations avec l’Angleterre s’accroissent avec l’exportation de pastel destiné à la draperie anglaise. 31 Le Languedoc commerce aussi avec les Flandres; des villes comme Toulouse, Albi ou Gaillac envoient leur pastel vers les cités drapières, ainsi que des peignes de buis dont le bois vient du Roussillon, mais qui sont façonnés à Toulouse. 32 Les liens étroits du Languedoc avec la Catalogne, et notamment Barcelone se traduisent par l’achat d’épices et de draps en échange du pastel. Les épices consommées à Toulouse, révélées par quelques inventaires après décès d’épiciers, proviennent surtout de Catalogne. Il s’agit du safran, du poivre, du gingembre, de cannelle, des clous de girofle, du cumin, de la noix de muscade, auxquels il faut ajouter de l’encens et des confitures épicées appelées confimens . Très prisées, elles font partie des repas de fête des capitouls. Des marchands toulousains sont installés à Barcelone et une colonie catalane est présente à Toulouse. 33 Dans tout le sud de la France, les inventaires après décès révèlent la présence dans les maisons de notables de céramiques «hispano-mauresques» provenant de Valence et de Malaga qui font l’objet d’un cabotage actif le long des côtes méditerranéennes, un circulation des objets de luxe confirmée par les fouilles archéologiques sous-marines. 34
Les objets mis en gage par les débiteurs retracent bien les catégories habituelles du luxe en cette fin de Moyen Âge. Il s’agit souvent de pièces d’orfèvrerie, de l’argenterie, mais aussi des livres. Les étudiants de l’université engagent surtout des livres tandis que les consuls de l’Isle-en-Dodon, non loin de la capitale du Languedoc, mettent en gage le 13 mars 1433 pour une dette de 292 écus et demi: six calices, un reliquaire et d’autres objets d’argenterie. 35 La comtesse Jeanne de Boulogne met en gage elle aussi des croix et des tasses. 36 L’attachement de l’aristocratie méridionale aux bijoux et autres pièces de la parure ne fait aucun doute. Le courtier Genes Amarel restitue au vicomte de Caraman un fermoir en or garni de pierres précieuses qu’il lui avait laissé en gage d’une dette de 170 écus. 37
Cette faveur de l’orfèvrerie auprès des élites urbaines est partagée par un autre groupe dont je n’ai guère parlé jusqu’ici et qui joue pourtant un rôle essentiel dans l’activité du marché du luxe. Siège d’un archevêché, d’une abbaye de chanoines à Saint-Sernin et de nombreux autres monastères et couvents d’ordres mendiants, la ville bénéficie d’une clientèle ecclésiastique locale, mais aussi provinciale. Le clergé méridional vient s’y approvisionner en croix processionnelles, reliquaires et chasses d’argent auprès d’un groupe d’orfèvres bien implanté et dont le marché dépasse largement le seul ressort du Toulousain.
Les peintres bénéficient aussi de cette commande ecclésiastique comme Jean Portal chargé en 1428 d’orner un oratoire entre Donneville et Montgiscard, ou l’imageur Louis de Bousin qui doit faire en 1431 pour l’église de Belpech un monument semblable à celui de Notre Dame du Taur avec Nicodème, Marie, Jean et autres personnages, sans aucun doute un groupe de la Mise au Tombeau pour ne citer que quelques exemples de ces commandes religieuses.
Dans le Sud de la France comme dans toute l’Europe, la commande religieuse, qu’elle soit laïque ou cléricale, collective ou individuelle, accapare la majeure partie des activités des artisanats d’art. C’est une donnée trop connue des médiévistes que l’activité des confréries de dévotion, les initiatives individuelles en faveur de la construction de chapelles funéraires, de dons aux églises, mais aussi l’intervention collective des consulats des villes comme des villages pour l’embellissement de leurs églises pour que je m’y attarde trop longuement.
Parmi d’innombrables exemples, je n’en retiendrai que deux car ils témoignent de la circulation des biens culturels au sein du domaine méridional au temps de la papauté d’Avignon. Le premier est celui de Pierre Godin. cardinal, mort à Avignon en 1336, cet ancien frère prêcheur du couvent de Toulouse lègue une grande partie de sa fortune en faveur de son ancien couvent. Une forte somme d’argent permet l’achèvement de la reconstruction de l’église conventuelle, mais le cardinal est aussi représenté sur un tableau placé au-dessus de la porte du cloître, offrant à la Vierge l’église des frères prêcheurs de Toulouse, vers 1385, ainsi qu’au pied d’un Crucifix peint sur un petit panneau de bois, conservé au Musée des Augustins. 38
Читать дальше