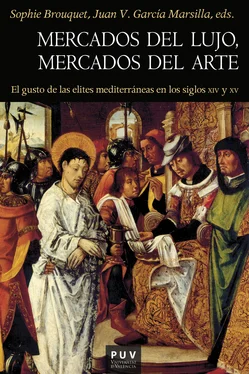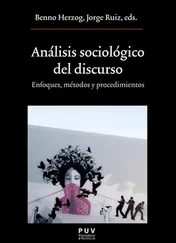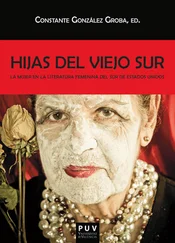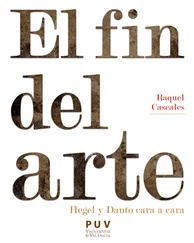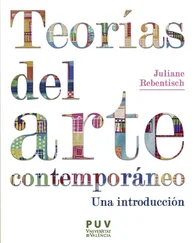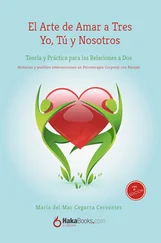L’approche sociologique et prosopographique permet de reconstituer les carrières de la naissance à l’accès à la notabilité urbaine, ainsi que les réseaux de pouvoir partagés. Les codes de la notabilité, le paraître, les marqueurs de la supériorité sociale sont autant d’approches qui ont attiré l’attention des médiévistes français au cours de ces dernières années.
Une autre voie d’approche est celle de l’anthropologie historique avec l’étude de la parenté, des familles, ou encore des rituels d’intégration ou d’exclusion comme la participation aux fêtes civiques et religieuses et les entrées royales. Elle s’intéresse aussi à la construction identitaire des élites à travers leur code d’honneur. En effet, les recherches sur la justice et la criminalité ont renouvelé cette notion. Si l’honneur blessé ressort de la criminalité médiévale, elles ont en outre révélé qu’il existe bien au Moyen Âge un code d’honneur partagé par tous, et non pas seulement réservé à la noblesse et que dans les yeux des autres, l’honneur est lié à la renommée, fama , et surtout à la commune renommée, la fama publica . La perte de l’honneur signifie la mort sociale de l’individu. Cette défense très âpre de l’honneur, cette recherche effrénée des signes et des marques d’honorabilité montrent à l’évidence que le modèle aristocratique s’est imposé aux élites urbaines à la fin du Moyen Âge.
Les historiens s’attachent donc désormais à étudier la recherche par les élites de leur propre légitimité et leur souci du consensus politique et social. Mais, dans le même temps, une attention plus grande est portée aux oppositions qui traversent les groupes dirigeants, non seulement en termes de factions et de partis, mais aussi de concurrence et de corruption.
Au centre des réflexions se trouve désormais la diversité des origines et des modes d’ascension, les modes de représentation et de transmission de la domination, l’accent se plaçant sur la discipline sociale et la discipline des mœurs, mais la question reste de savoir quel modèle est suivi et le problème de la réception par les élites urbaines d’une culture nobiliaire et courtoise fait encore l’objet d’appréciations divergentes. 18
Que les patriciens n’aient pas puisé en ville, mais dans la culture nobiliaire, les modèles culturels de leur domination et de leur représentation est communément accepté, mais il est tout aussi évident que ces modèles, empruntés au registre de la culture chevaleresque, sont retravaillés par les élites urbaines et ont désormais besoin de la ville pour perdurer.
Les élites méridionales urbaines
Deux longues périodes se succèdent dans le processus de formation et de renouvellement des élites urbaines françaises au Nord comme au Sud: celle d’une ploutocratie, puis celle d’une oligarchie de notables. Ce sont d’abord les riches qui dominent les villes du XII eau milieu du XIV esiècle, puis les dominants du pouvoir et de la culture du milieu XIV eà la fin du XV e. La rupture se situe au milieu du XIV esiècle, marqué par un profond bouleversement des élites urbaines.
La ville médiévale est d’abord patricienne; une élite de l’argent et de l’influence y monopolise les charges communales, mais ce qui fait sa domination, c’est d’abord la richesse Elle peut se définir selon quatre critères principaux: une puissance financière fondée sur le grand commerce, mais aussi le marché des rentes, le prêt et le change et l’immobilier urbain. Cette oligarchie détient le pouvoir urbain au moment même où se mettent en place les institutions municipales, aussi bien dans les villes dotées d’une commune que d’un consulat. Quelques familles se partagent le pouvoir civique, toutes étroitement liées par les alliances matrimoniales. 19
En quelques décennies, entre 1348 et 1380, le paysage social est bouleversé, marqué par le passage du patriciat urbain à la bourgeoisie qui doit son appartenance à l’élite à son savoir, surtout juridique. Les grands lignages patriciens disparaissent dans la crise économique et démographique qui a engendré l’effondrement des rentes foncières, en ville comme à la campagne, le déplacement des lieux de commerce et le recul de la production industrielle. Dans le même temps, la croissance continue de l’appareil d’État favorise l’apparition de nouveaux groupes, surtout des gens de lois, officiers royaux de finances et de justice, qui doivent leur ascension à leur savoir, souvent universitaire, et pour lesquels les valeurs essentielles sont désormais celle de la connaissance, du service de l’État et de l’honneur. Les élites françaises, nobles et non nobles, se détournent progressivement de la marchandise pour se tourner vers l’appropriation des fonctions publiques, un mode d’ascension plus sûr et plus rentable, économiquement et socialement. 20
C’est particulièrement le cas dans le Midi où la pénétration du droit romain est précoce. Dès avant le milieu du XII esiècle, les écoles cathédrales de Provence et du Languedoc sont des centres d’étude du droit renommés. Cette tendance se renforce avec l’arrivée de professeurs lombards comme Osbert le Lombard à Béziers vers 1170, Rogerius à Arles ou Placentin à Montpellier dans les mêmes années. Cette diffusion du droit écrit est à mettre en rapport avec l’installation de consulats dans ces villes et la rédaction des premières coutumes urbaines. Le monde des juristes se présente sous la forme d’un groupe hiérarchisé, avec à sa base, les notaires publics attachés à un seigneur, ce n’est que vers le milieu du XII esiècle qu’apparaissent les premiers notaires publics en même temps que les chancelleries princières comme celle des comtes de Toulouse. Il s’agit en l’occurrence de praticiens de la copie et du droit sans formation spécialisée. Au niveau supérieur se placent les véritables juristes qui ont étudié le droit canon ou civil dans le cadre des écoles cathédrales dont ils sont devenus les chanoines, pour la plupart issus de familles de chevaliers urbains, puis à la fin du XII esiècle, des membres de la bourgeoisie marchande.
La croissance des effectifs de ces juristes au XIII eest à mettre en parallèle avec l’essor urbain, les progrès de l’écrit dans la société urbaine, mais aussi avec le rattachement progressif du Languedoc au domaine royal. L’enseignement du droit est désormais dispensé dans le cadre des universités. Jusque vers 1250, les juristes méridionaux allaient se former à Bologne, mais vers cette date, un groupe d’anciens élèves de Bologne crée un studium à Montpellier, dispensant surtout des cours de droit canons que la papauté érige en université en 1289. À Toulouse, l’échec de la faculté de théologie, implantée par la papauté pour lutter contre l’hérésie albigeoise, est suivi par une nouvelle rédaction des statuts de l’université en 1245 qui prévoient un enseignement du droit. Dès 1251, un groupe de juristes travaille pour le nouveau comte de Toulouse Alphonse de Poitiers, mais la faculté de droit ne prend véritablement son essor qu’à partir de 1270. À Béziers, à Narbonne et peut-être même à Carcassonne fleurissent d’autres écoles attachées aux cathédrales qui dispensent un enseignement du droit; les familles des élites urbaines y envoient leurs fils. 21
Cependant, la domination des juristes ne prend véritablement toute sa vigueur que dans la deuxième moitié du XIV esiècle et plus encore au XV esiècle. Les élites urbaines restent encore largement composites à la fin du Moyen Âge si l’on en croit l’exemple toulousain.
Élites toulousaines
De vieilles familles de l’oligarchie, dont certaines affichent une origine chevaleresque sont encore bien présentes comme les lignages des Maurand ou des Rouaix. Vers 1400, Toulouse compte environ 23.000 habitants parmi lesquels la noblesse fait figure de groupe très minoritaire avec quatre chevaliers, dix écuyers et damoiseaux. Cette noblesse militaire est donc très peu nombreuse et semble en grande difficulté comme les Rouaix et les Maurand: le revenu de leurs terres chute, les friches progressent faute de bras or les dépenses augmentent et, à chaque décès, le patrimoine foncier est morcelé. 22
Читать дальше