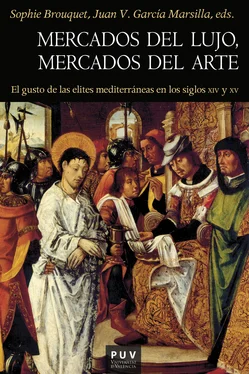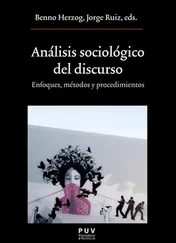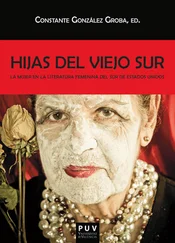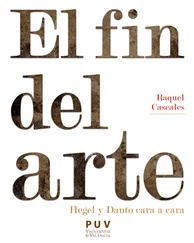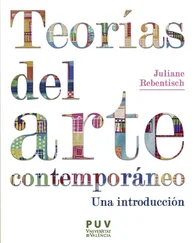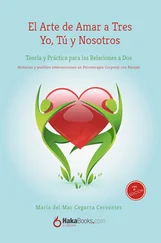1 ...7 8 9 11 12 13 ...48 Un exemple plus frappant encore de cet enrichissement du clergé du Languedoc à la faveur de la présence de la papauté en Avignon, est celui de Jean Tissandier, évêque du minuscule évêché de Rieux une création du pape Jean XXII, entre 1324-1348. Originaire du Quercy comme le pontife, Jean Rieux est un ancien profès du couvent des Cordeliers de Toulouse. Dans son testament, il demande à être enterré dans une chapelle funéraire, située dans le couvent franciscain, son tombeau placé à la gauche du chœur. La chapelle doit être entièrement décorée sur son pourtour de vingt statues figurant le Christ, la Vierge, les douze apôtres, saint Jean-Baptiste, les saints franciscains, et l’évêque, agenouillé en donateur, portant la maquette de l’église conventuelle. 39
Des commandes religieuses formulées par les laïques ne restent que quelques vestiges, mais les inventaires établis après décès et les contrats établis devant notaires permettent de percevoir un autre marché du luxe, profane, entièrement tourné vers le bien-être et l’ostentation.
Le premier poste de dépense est la maison qui permet aux élites d’afficher leur réussite et leurs prétentions. L’hôtel du marchand Pierre del Fau, construit à partir de 1495, s’ouvre sur une porte surmontée d’un arc en accolade dont les moulures encadrent le monogramme du Christ. Elle donne sur un couloir voûté d’ogives, longeant l’ouvroir et la boutique, et menantà la cour intérieure bordée de quatre corps de logis. Une tourelle hexagonale abrite l’escalier, sa porte est surmontée du monogramme familial et d’une niche où se trouvait une statue aujourd’hui disparue. Au sommet, la tour se termine par une voûte dont les six arêtes retombent sur un pilier formant une étoile. L’escalier à vis donne sur la «mirande», une terrasse où l’on prenait le frais l’été. 40 Nombre d’hôtels toulousains, nobles ou bourgeois, adoptent cette présence d’une tour d’escalier et d’une mirande qui devient presque la signature de l’architecture locale. La tour évoque une aspiration certaine à un mode de vie aristocratique tandis que la mirande permet de voir et d’être vu.
Ce bref aperçu des élites et du marché du luxe dans le Sud de la France reste malgré tout très partiel, les études manquent encore pour appréhender ces questions et peu de chercheurs ont eu le courage comme Philippe Wolff en son temps et Véronique Lamazou-Duplan actuellement de se plonger dans l’océan insondable des registres de notaires en Languedoc. Les documents ne manquent pas, ils sont pléthoriques, mais souvent bien peu bavards pour appréhender les circulations des hommes et des objets.
1 P. Perdrizet: La Vierge de Miséricorde. Étude d’un thème iconographique , Paris, Fontemoing, 1908.
2 Paris Bibliothèque Mazarine, ms. 520, f. 105.
3 Lisbonne, Bibliotheca Nacional, ms. II 112, f. 104v.
4 Lisbonne, Bibliotheca Nacional, ms. II 112.
5 C. Rabel: «Sous le manteau de la Vierge: le missel des Carmes de Toulouse ( vers 1390-1400)», en S. Cassagnes-Brouquet et M. Fournié (éds.): Le livre dans la région toulousaine et ailleurs … au Moyen Âge , Toulouse, Méridiennes, 2010, pp. 85-106.
6 Idem , p. 95.
7 Chantilly, Musée Condé, Enguerrand Quarton: Retable Cadard , 1452, bois transposé sur toile, H. 66 cm L. 187 cm. L’œuvre est conservée sans prédelle et sans couronnement, elle fut acquise par le duc d’Aumale en 1879.
8 Abbé Requin: «Les peintres d’Avignon», Extrait des comptes-rendus des Réunions des sociétés des beaux-arts des départements , Paris, 1889, pp. 176-177.
9 C. Sterling: Enguerrand Quarton, Le peintre de la Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux , Paris, 1983, p. 23.
10 Archives départementales du Vaucluse, Fonds Martin n.° 800, ff. 25-26, 16 février 1452.
11 C. Sterling: Enguerrand Quarton …, cit. , p. 24.
12 Nice, Musée Masséna: Retable de Jean Mirailhet, vers 1425.
13 C. Sterling: Enguerrand Quarton …, cit ., pp. 31-32.
14 On peut citer à titre d’exemple, le colloque organisé à Rome en 1996 par la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public: Les élites urbaines au Moyen Âge , Paris-Rome, MEFR, n.° 27, 1996.
15 É. Crouzet-Pavan: «Les élites urbaines: aperçus problématiques (France, Angleterre, Italie)», dans Les élites urbaines au Moyen Âge …, cit ., pp. 9-28.
16 Ph. Braunstein: «Pour une histoire des élites urbaines: vocabulaire, réalités et représentations», dans Les élites urbaines au Moyen Âge …, cit ., pp. 28-38.
17 C. Petitfrère (dir.): Construction, reproduction et représentation des patriciats urbains de l’Antiquité au XXe siècle , Tours, Centre d’histoire de la ville moderne et contemporaine, 1999.
18 P. Monnet: «Élites dirigeantes et distinction sociale à Francfort-sur-le-Main (XIV e– XV esiècles)», Francia , t. 27/1, 2000, pp. 118-162, p. 126.
19 M. Berthe: «Les élites urbaines méridionales au Moyen Âge (XI e-XV esiècles)», dans La Maison au Moyen Âge dans le Midi de la France, actes des journées d’études de Toulouse, 19/20 mai 2001 , Toulouse, MSAMF, 2002, pp. 21-40.
20 Idem , p. 22.
21 Idem , pp. 30-33.
22 P. Wolff: Histoire de Toulouse , cit ., pp. 200-202.
23 Idem , pp. 157-166.
24 F. Brumont: «La commercialisation du pastel toulousain, 1350-1600», Annales du Midi , t. 106, n.° 205, janvier-mars 1994, p. 26.
25 Idem , p. 28.
26 Ph. Wolff: Histoire de Toulouse , cit ., pp. 224-226.
27 Idem , p. 208.
28 Idem , pp. 242-243.
29 V. Lamazou-Duplan: «Les élites toulousaines et leurs demeures à la fin du Moyen Âge d’après les registres notariés: entre maison possédée et maison habitée», dans La Maison au Moyen Âge dans le Midi de la France, actes des journées d’études de Toulouse, 19/20 mai 2001 , Toulouse, MSAMF, 2002, p. 42.
30 Ph. Wolff: Commerce et marchands de Toulouse (v. 1350-v. 1450) , Paris, Plon, 1954, pp. 15-16.
31 Idem , p. 117.
32 Idem , p. 129.
33 Idem , p. 145.
34 H. Amouric, F. Richez, L. Vallauri: 20.000 pots sous les mers, le commerce de la céramique en Provence et en Languedoc du Xe au XIXe siècle , exposition, Musée d’Istres, Édisud, Aix-en-Provence, 1999.
35 ADHG, 3E 384, f. 11.
36 ADHG, 3E 2485, f. 123v, le 21 janvier 1437.
37 ADHG, 3E 3306, f. 149.
38 R. Mesuret: «Les primitifs du Languedoc essai de catalogue», GBA , 1965, t. LXV, pp. 1-38, pp. 19-20.
39 R. Rey: L’art gothique du midi de la France , Paris, Librairie Renouard, 1934, pp. 249-257.
40 Ph. Wolff: Commerce et marchands de Toulouse …, cit ., pp. 598-299.
CLIENTES DE CALIDAD Y MERCADO ARTÍSTICO EN LA CORONA DE ARAGÓN MEDIEVAL
Francesca Español Bertran Universitat de Barcelona
El 4 de septiembre de 1443 los concellers de Barcelona acordaron buscar al millor e pus abte pintor encerchar de trovar se posqués para encargarle el retablo que debía presidir la capilla del palacio cívico. 1 Algo más de un mes más tarde el pintor valenciano, Lluís Dalmau, contrató la obra (29 de octubre) y en el documento se comprometió a representar a sus clientes: segons proporcions e habituts de lurs cosors, ab les façs axii pròpies com ells vivents han . 2 La tabla se conserva y permite apreciar hasta qué punto el artista se acomodó a lo convenido. A los pies de la Virgen con el Niño que la preside y por delante de santa Eulalia, la patrona de la ciudad, y de san Andrés, en cuya festividad se elegía a los representantes del gobierno municipal, aparecen arrodillados cinco personajes vestidos con la suntuosa gramalla roja distintiva de los concellers barceloneses. Se trata, por un lado, de Joan Llull, Francesc Llobet y Joan Junyent y, por otro, de Ramon Savall y Antoni Villatorta. Sus rostros son fidedignos, según reclamaron al pintor, y esta particularidad, con otras que presenta la obra, signo inequívoco de la modernidad de la tabla [fig. 1.1]. La historiografía ha puesto de relieve sobradamente la importancia de este trabajo de Lluís Dalmau, 3 enviado a Flandes por orden del rey Alfonso el Magnánimo unos años antes (1431), 4 con el objeto de que aprendiera a pintar según la nova manera , puesta a punto por pintores como Robert Campin († 1444) y Jean van Eyck († 1441) en las primeras décadas del siglo XV.
Читать дальше