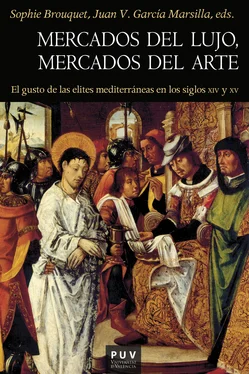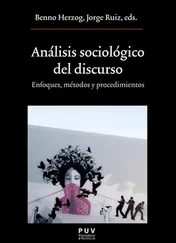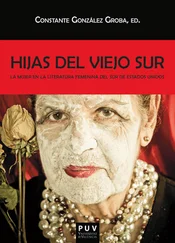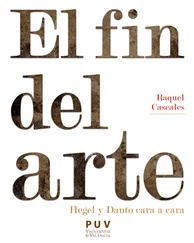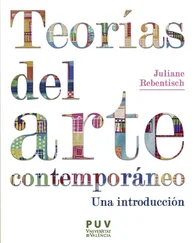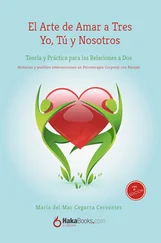5 Werner Paravicini (éd.): Luxus und Integration: materielle Hofkultur Westeuropas vom 12. bis zum 18. Jahrhundert , München, R. Oldenbourg, 2010.
6 Gilles Lipovetsky: Le luxe éternel: de l’âge du sacré au temps des marques , Paris, Gallimard, 2003.
7 Simon Schama: L’embarras des richesses, une interprétation de la culture hollandaise au siècle d’Or , Gallimard, 1991.
8 Richard Goldthwaite: Wealth and the Demand for art in Italy, 1300-1600 , Baltimore, John Hopkins University Press, 1993.
PROMOTORES Y CLIENTES DEL LUJO
ÉLITES ET CONSOMMATION DE LUXE DANS LE MIDI À LA FIN DU MOYEN ÂGE
Sophie Brouquet Université de Toulouse-Jean Jaurès
Deux images de la Vierge de Miséricorde, produites en Languedoc et en Provence à près de soixante années de distance serviront ici d’introduction à une réflexion sur les élites et la consommation de luxe dans le Midi de la France à la fin du Moyen Âge. Un bien vaste sujet que je ne prétends pas traiter dans son intégralité, loin de là, mais éclairer à la lueur de quelques publications récentes.
L’une de ces images est fort célèbre, il s’agit du Retable Cadard, peint par Enguerrand Quarton en Avignon en 1452. L’autre l’est beaucoup moins, pour tout dire, elle vient d’être redécouverte grâce aux travaux de Claudia Rabel sur le Missel des Carmes de Toulouse qu’elle illustre. Elles seront le point de départ d’une réflexion sur les notions d’élites et de consommation de luxe dans les régions méridionales à la fin du Moyen Âge.
LES ÉLITES SOUS LE MANTEAU DE LA VIERGE
L’image de la Vierge au Manteau ou Vierge de Miséricorde apparait dans le troisième quart du XIII esiècle, d’abord en Italie, puis se répand dans tout l’Occident à la fin du Moyen Âge. 1 Plus présente en Provence que dans le Languedoc médiéval, elle n’y est pourtant pas inconnue. Marie s’y présente comme l’avocate de l’humanité; elle protège tous les fidèles, d’abord les religieux sur les images les plus anciennes, les membres d’une confrérie comme à Toulouse, puis la chrétienté toute entière à partir du XIV esiècle. Cette iconographie est peinte en tête des statues de confrérie ou de corps de métier qui se placent sous sa protection.
L’une des plus anciennes représentations de cette Mater omnium a été peinte sur un livre d’heures d’origine méridionale, sans doute avignonnaise, de Jean d’Armagnac réalisé avant qu’il ne devienne évêque de Mende en 1387. 2 Mater Omnium , certes, mais dans la réalité, sous le manteau de la Vierge, ce sont bien souvent les élites laïques et cléricales qui viennent se blottir pour rechercher sa protection. Portraits de groupe réels ou fictifs, les élites se donnent à voir et exhibent leur luxe sous la protection de Notre-Dame, comme les confrères de Toulouse.
Les confrères du Missel des Carmes de Toulouse, vers 1390-1400
Sur une autre enluminure, la Vierge étend son manteau d’un bleu profond, tenu par deux angelots aux ailes vermillon, sur un groupe d’hommes, égaux par la taille et par le costume. Seules, les couleurs vives de leurs houppelandes aux longues manches terminées en éventail et celle de leurs chevelures permettent de les distinguer.
Marie les domine de sa silhouette longiligne. La Vierge couronnée porte l’Enfant Jésus et étend sa protection sur eux avec bienveillance. 3 Cette enluminure illustre un missel des Carmes, conservé à la bibliothèque nationale de Lisbonne 4 et récemment identifié par Claudia Rabel comme le Missel des Carmes de Toulouse. 5
Les enluminures du manuscrit ont longtemps été rattachées à la production ibérique avant de retrouver leur origine languedocienne; preuve s’il en est de la proximité des productions artistiques de cet autre marché de l’art et du luxe qu’est la côte méditerranéenne depuis la Provence jusqu’au royaume de Valence.
Le couvent des Carmes de Toulouse aurait été fondé en 1238 au sud de la ville, dans le faubourg Saint-Michel par un certain Guillaume Anesia, originaire de Toulouse, accompagné de six frères venus de Terre Sainte. Au cours de leur périple, ils auraient bénéficié de la protection d’une image miraculeuse de Marie venue du Mont Carmel. Parvenue à Toulouse, elle y fait de nombreux miracles. En 1264, le couvent est transféré intra muros dans la paroisse de la cathédrale Saint-Étienne, au cœur de la Cité dans l’ancien quartier juif, un secteur modeste, surtout peuplé d’artisans. Mais il évolue à la fin du Moyen Âge avec l’installation de notables, membres du capitoulat et parlementaires. Le couvent des Carmes est le siège de nombreuses confréries dont son église accueille les chapelles. C’est l’une d’entre elles, non encore identifiée, mais dédiée à la Vierge, qui a commandé le missel.
Le style de son enluminure peut être daté de la fin du XIV esiècle si on le compare à celui des Annales manuscrites de Toulouse , le livre consulaire des capitouls, dont les peintures sont précisément datées.
La représentation de la Vierge de Miséricorde est placée juste avant le canon de la messe, une place de choix au sein du Missel, avant les deux autres enluminures pleine page qui l’illustrent. Le groupe venu se placer sous le Manteau de la Vierge compte vingt hommes identifiés par leurs noms et dont la fonction est précisément évoquée sous l’enluminure: «S’es noms dels bayles qua an fayt far aquest missal…».
Cependant, les personnages ne sont pas du tout individualisés. L’effet choisi est plutôt celui de la représentation d’une entité collective. 6 Les personnages, dont les traits sont sommairement évoqués, ne se distinguent que par l’alternance des couleurs de leur costume: rose, vert, bleu, rouge et de leurs cheveux bruns foncé et clair. Ils portent de longues houppelandes à la mode à Toulouse dans les années 1400 dont les larges manches sont plissées en éventail. Elles rappellent celle des capitouls qui apparaissent sur les enluminures attribuées à Jean Négrier dans les Annales , pour les années 1392-1393 et 1393-1394. Bien d’autres points communs les rapprochent, l’emploi de fonds losangés, les figures des anges aux ailes rouges presque identiques, les nez pointus et les grandes mains stylisées des personnages.
La composition emprunte à l’Italie la position strictement frontale de la Vierge, sa robe au tissu orné semé d’étoiles, le manteau fourré de vair et la véritable ostension du manteau étendu à l’extrême par les anges. Mais d’autres aspects n’ont rien d’italien comme la couronne que porte la Vierge qui correspond davantage à une iconographie du nord de la France.
Qui sont les commanditaires qui ont fait enluminer le missel de leur confrérie? En dépit des recherches conjointes des médiévistes toulousains, il n’a pas été permis pour l’instant de les identifier. Qui sont ces hommes qui s’affichent fièrement vêtus à la dernière mode toulousaine comme les Capitouls; un peu en retard, il faut bien le dire sur celle de Paris. En tous les cas, leurs noms n’évoquent nullement ceux des grandes familles de la marchandise et des offices au tournant des XIV eet XV esiècle. Appartiennent-ils à l’élite de la ville? Et, si c’est le cas, quelle limite inférieure convient-il d’avant attribuer à la notion d’élite?
Le retable Cadard d’Enguerrand Quarton, 1452
En revanche, il n’existe aucun doute quant à l’appartenance de Jean Cadard et de sa femme Jeanne de Moulins représentés sur le retable d’Enguerrand Quarton à l’élite, non seulement locale, mais nationale. Jean de Moussy dit Cadard est originaire de Picardie. Il est le médecin des enfants de Charles VI et particulièrement attaché au Dauphin, le futur Charles VII, dont il devient un familier. Il est présent lors de l’entrevue houleuse du pont de Montereau en 1419 où est assassiné le duc de Bourgogne Jean sans Peur. Son fils Philippe le Bon soupçonne même Cadard d’en être l’un des principaux instigateurs et exige du roi son bannissement. Dès 1423, Pierre Cadard s’établit à Avignon, sous la protection de la curie romaine. Très riche, il achète de nombreuses seigneuries dans le Comtat Venaissin, comme celle d’Oppède en 1425 et celle de Gor en 1427. Il possède aussi des immeubles en Avignon. Mais sa renommée va bien au-delà de Provence: il prête de l’argent à la municipalité de Florence, au trésor royal par l’intermédiaire de Jacques Cœur, au comte de Dunois, le bâtard d’Orléans, pour payer la rançon du duc Charles d’Orléans.
Читать дальше