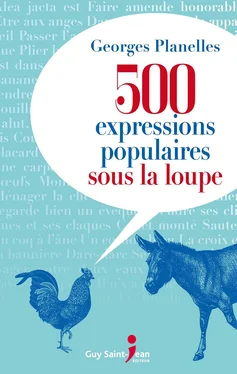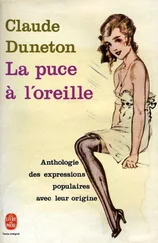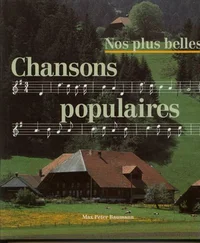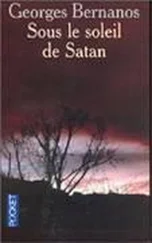Ce n’est qu’à la fin du XIX esiècle qu’un historien anglais germanophile, Thomas Carlyle, l’utilise dans un de ses écrits après en avoir souvent entendu la version allemande. Elle se répand ensuite en Grande-Bretagne avant d’être transposée en français.
On peut maintenant se demander ce qui a amené les Allemands à imaginer cette expression imagée. Malheureusement, les ouvrages évoquant l’expression ne le précisent pas. Certains font le rapprochement avec les pratiques hygiéniques d’autrefois qui voulaient que, en raison de difficultés d’approvisionnement en eau (absence d’eau courante) et de chauffage de cette eau pour le lavage, toute la famille passe dans le même bain, le père d’abord, puis les autres hommes de la maisonnée, puis les femmes, les enfants et enfin les bébés en dernier. Autant dire qu’à la fin, l’eau était tout sauf limpide et qu’il était donc facile d’oublier que bébé y pataugeait.
Si l’origine est bien là, alors elle repose sur une plaisanterie, car il va de soi que bébé ne pouvait être abandonné comme ça dans la baignoire dans laquelle il se serait noyé.
Le deuxième sens proposé est apparu plus tard au XX esiècle. Cette fois, on n’hésite pas à jeter le bébé volontairement. Tant pis s’il patauge dans la baignoire, à partir du moment où l’on préfère se débarrasser vite fait de l’eau maintenant considérée comme encombrante sans perdre le temps nécessaire à en ôter le bébé.
Il reste que depuis 11 ans, grâce à cette soirée et grâce à une poignée de gens qui la portent à bout de bras, le cinéma québécois compte sur une vitrine de choix dont il ne pourrait plus se passer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Mais il faut changer l’eau de temps à autre.
Marc Cassivi — « Le mystère Susan Sarandon » —
La Presse , 26 février 2009
38. Se défendre bec et ongles
Se défendre de façon énergique, avec tous les moyens à sa disposition.
En latin, on disait unguibus et rostro qui voulait dire « à griffes et bec » ou « par les griffes et le bec », locution qui sert d’ailleurs de devise à la ville française de Valence, et qu’on trouve sur son blason.
L’origine et la compréhension de cette expression sont toutes simples : lorsqu’un oiseau doit se défendre, il le fait avec les moyens à sa disposition, son bec et ses griffes (ou ongles). Elle a d’abord été utilisée avec le verbe « avoir » (avoir bec et ongles) en signifiant « être de taille à se défendre » ou également « répondre vivement à une attaque », mais cette forme a maintenant été oubliée, alors que l’actuelle reste très vivace.
Depuis fin 1993, elle défend bec et ongles son père, accusé, à tort selon elle, du meurtre de sa mère.
Libération — Article du 1 eravril 1999
Être amoureux.
Si elle est juste, voilà une bien étrange histoire que celle de cette expression qui, dans sa forme actuelle, date du XVI esiècle. L’histoire commence au XII esiècle, à Liège, dans le premier couvent de béguines, sœurs de l’ordre de Saint-François, appelées ainsi, paraît-il, parce que le fondateur du couvent s’appelait Lambert le Bègue. Ces religieuses portaient une coiffure faite d’une toile fine et qu’on appelait béguin .
Mais ce n’est pas parce que certaines béguines avaient, en cachette, le béguin pour le bedeau que cette expression est apparue. De coiffe de bonne sœur, le béguin est devenu une coiffe de femme et d’enfant.
Par ailleurs, être coiffé (de quelqu’un) était une expression qui voulait dire « être à la merci » de cette personne, mais au sens d’être impuissant ou d’être aveuglé par elle.
Prenez maintenant une femme qui est coiffée d’un béguin et, surtout, qui est amoureuse folle de quelqu’un. N’est-elle pas aveuglée par l’autre au point de se livrer entièrement à lui, comme étant à sa merci ?
Par croisement avec l’autre expression, il n’en a pas fallu beaucoup plus pour qu’on dise de cette femme qu’elle s’est « embéguinée », c’est-à-dire qu’elle est tombée amoureuse. Car si, dans son sens initial, s’embéguiner, c’était se coiffer d’un béguin, au figuré, il voulait aussi dire « devenir amoureux » avec la connotation excessive ou ridicule que cela peut avoir dans certains cas.
Au XVI esiècle également, et selon Gaston Esnault, avoir le béguin à l’envers signifiait « avoir la tête troublée ». Ce qui se comprend bien, puisque celle qui mettait son béguin dans le mauvais sens devait penser à tout autre chose. Et si rien ne dit d’où venait le trouble, l’amour faisait certainement partie des causes possibles.
Claude Duneton indique que l’expression n’est largement attestée qu’à partir du XIX esiècle. Pour expliquer l’écart de trois siècles entre l’apparition initiale et l’usage élargi, il écrit que la locution est réapparue dans les maisons closes, probablement dans les propos des filles de la campagne qui y étaient embauchées. Jusque-là, l’expression ne s’était pas encore vraiment répandue dans la capitale et chez les bourgeois, clients assidus de ces établissements.
Ensuite, des bourgeois et par imitation des gens de la haute, l’expression se serait répandue dans le grand public.
— Tu crois qu’il a le béguin ?
— Il doit en pincer pour elle. J’en mettrais ma main à couper ! confirma Rose, le sourire aux lèvres.
— C’est de son âge.
Cyril Comtat —
L’héritier — Polar — 2007
40. Un travail de bénédictin/de moine
1. Un travail intellectuel de longue haleine.
2. Un travail qui demande beaucoup de patience et d’application.
L’expression vient de saint Benoît de Nursie. Né à la fin du V esiècle, il est le fondateur de l’ordre des moines bénédictins, vers 529. Il est célèbre, entre autres, pour avoir défini la Règle de saint Benoît, ensemble de règles de vie d’une communauté monastique, principes adoptés par de très nombreux monastères en Occident.
Mais au fil des siècles, les bénédictins trouveront plusieurs interprétations de ces règles, ce qui conduira à la création de plusieurs ordres (Cîteaux, Cluny, etc.), chacun insistant sur telle ou telle activité (travail manuel, liturgie ou autre).
Parmi ces ordres, il y eut la congrégation de Saint Maur, créée au XVII esiècle, qui privilégiait le travail intellectuel. Très érudits et de formation humaniste, les moines de cette congrégation participaient à des travaux littéraires collectifs de très longue haleine (236 volumes pour le Trésor généalogique ou 50 volumes pour une géographie de la Gaule et de la France, par exemple).
C’est de la durée de ces travaux, qui nécessitaient une très grande patience, qu’est née l’expression qui nous intéresse.
Il admet d’emblée que le traitement des documents fournis par le maire, mardi, nécessite un travail de moine que seul un spécialiste est en mesure d’accomplir.
Mathieu Bélanger — « “Un travail de moine’’ » nécessaire pour traiter les données gatinoises » —
Le Droit , 29 novembre 2012
Cet organisme, composé de personnalités du monde des arts, recrutées pour leurs compétences et leur notoriété, avait mené un travail de bénédictin, croisant des données, fusionnant des fichiers, comparant des listes, faisant en plusieurs années le travail qu’un ordinateur accomplissait aujourd’hui en quelques secondes.
Читать дальше