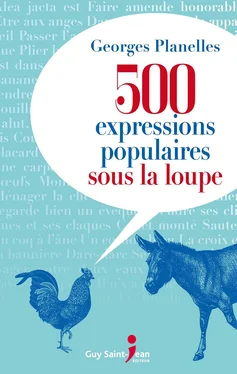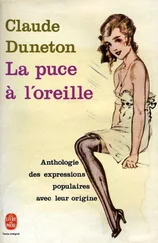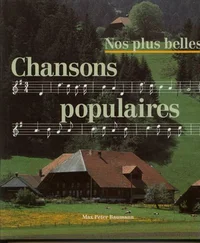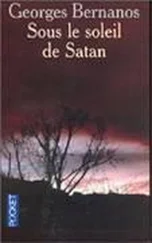Pour ceux qui aiment le latin, il est intéressant de savoir que in extremis voulait dire littéralement « dans les derniers moments » ce qui peut aussi se dire « à l’article de la mort ». Son utilisation a depuis été détournée pour devenir quelque chose comme « au tout dernier moment », mais avec le sens « de justesse ». Ainsi, on peut dire « il a pris le train in extremis » ; sauf que s’il a pris le train en pleine face, sur la voie, on retrouve plutôt le sens d’origine…
On faisait tous les jours prendre des nouvelles de tant de gens à l’article de la mort, et dont les uns s’étaient rétablis tandis que d’autres avaient « succombé ».
Marcel Proust —
Le temps retrouvé — 1927
Être le meilleur dans son genre, dans l’activité qu’on exerce.
Au XII esiècle, le mot « as » a initialement désigné la face d’un dé qui ne comporte qu’un point. De cette faible valeur, le mot a d’abord été associé à des choses de peu de valeur (ne pas valoir un as voulait dire « ne rien valoir du tout »).
Puis sont arrivés les jeux de cartes où l’as avait au contraire le rang le plus élevé, au-dessus des rois, sans que ce revirement de position soit expliqué.
Selon le Dictionnaire historique de la langue française , c’est vers 1868 que le terme « as », sorti des jeux, désigne le premier aviron d’une yole (canot de compétition contenant 2, 4 ou 8 rameurs). Dans les courses hippiques également et un peu plus tard, c’est le premier cavalier du peloton de tête qui se voit affublé de cette appellation. Dans les deux cas, c’est le premier qui est un « as ».
Je regrette d’avoir dit de toi que tu ne valais pas grand-chose au lit. Je ne m’y connais pas. Tu dois être un as, j’imagine.
Hernest Hemingway —
En avoir ou pas — 1937
23. Ne pas être dans son assiette
Ne pas être dans son état normal, physiquement ou moralement.
De nos jours, à moins de faire du cheval ou de l’aviation, par exemple, quand on pense à l’assiette, on pense généralement au plat individuel dans lequel on mange. Alors il semble assez normal de « ne pas être dans son assiette », car qui aurait l’idée saugrenue de s’y vautrer ? C’est oublier que l’assiette individuelle n’est entrée dans les mœurs qu’après le XVI esiècle, l’habitude étant auparavant de manger avec les doigts dans le plat commun placé au centre de la table.
En effet, le mot « assiette » a la même origine que le verbe « asseoir ». De ce fait, l’assiette désigne, depuis 1580 chez Montaigne, « la manière d’être assis » et, pour les amoureux des chevaux, la « position du cavalier sur sa monture ». Cette association du mot à une position a donné, au figuré et chez le même auteur, le sens de « état de l’esprit » ou « façon d’être ». C’est ce dernier sens qui s’applique à notre expression.
Certains esprits curieux se demanderont pourquoi le mot « assiette » a ensuite désigné ce plat individuel. À ceux-là (les autres, vous pouvez tourner la page), je répondrai que c’est parce que, toujours dans le sens de « position » et dès la fin du XIV esiècle, le mot a désigné la situation d’un convive à une table. Par extension, le service déposé à chaque place a également été appelé assiette avant que le mot ne désigne finalement plus que le contenant. En tout cas, ce qu’on peut constater, c’est que lorsqu’on n’est pas dans son assiette, on s’intéresse généralement peu à ce qu’il y a dedans.
Des signes avant-coureurs. Déjà, sur la rampe de lancement, Christophe Moreau ne paraissait pas dans son assiette. Le visage inexpressif, le regard dans le vague, l’absence de lunettes, aussi bénigne soit-elle, témoignaient d’une motivation sur le déclin.
Le Figaro — Article du 27 avril 2009
24. Ne pas être sorti de l’auberge
Ne pas en avoir fini avec les difficultés ou les ennuis.
Voilà une expression du XIX esiècle en apparence étrange, car il semble difficile d’associer les ennuis avec une auberge, généralement destinée à être accueillante.
Il faut nous tourner vers l’argot, plus précisément celui des voleurs, pour comprendre le sens de cette expression. En effet, dans ce monde-là, le terme « auberge » désigne la prison, ce lieu où le voleur trouve gîte et couvert, comme dans une auberge, une fois qu’il a été capturé et condamné. Autant dire qu’une fois qu’il y est enfermé, non seulement il est loin d’en avoir fini avec les ennuis de la captivité, de la promiscuité et des sévices divers, entre autres, mais il aura beaucoup de mal à en sortir de son propre chef.
Le pays n’est pas non plus sorti de l’auberge en ce qui a trait à la situation sanitaire : l’épidémie de choléra fait toujours des ravages, et l’ONU estime à 2,2 milliards $ le montant nécessaire à son éradication.
Mélanie Marquis — « Haïti : l’aide du Canada manque de transparence » — La Presse canadienne — 9 janvier 2014
25. De bon/mauvais augure
Qui annonce quelque chose de positif ou de négatif.
Le mot « augure », attesté au XII esiècle, vient du latin augur, qui désignait un devin, et augurium, qui signifie « présage ». Dans l’Antiquité, un augure était une sorte de prêtre considéré comme l’interprète de la volonté des dieux : il observait des signes naturels comme l’évolution du ciel, le tonnerre ou le vol des oiseaux pour deviner ce qui allait se passer.
Seul le second sens, « présage », a survécu aujourd’hui. C’est ainsi que, pour certains, un chat noir qui passe devant eux sous une échelle et fait tomber et se casser un miroir est considéré comme un signe très, très défavorable.
Défiez-vous de ceux qui vous disent en vous parlant d’une personne qui vous est chère : — Je crains que un tel, ou une telle, ne soit bien malade. On n’est pas oiseau de mauvais augure sans s’y plaire un peu.
Victor Hugo —
Faits et croyances — 1840
1. Celui qui défend une personne ou une cause difficile à défendre.
2. Celui qui attaque volontairement les arguments d’un autre pour le forcer à les renforcer.
Si un avocat est chargé de défendre des accusés, il y a parfois des supposés coupables ou des causes qu’il semble très difficile de défendre tellement la culpabilité est certaine, l’atrocité des crimes choquante ou la cause immorale.
Et pourtant, tout le monde doit pouvoir être défendu, même ce satané diable, considéré par certains comme responsable de tant d’infâmes vilenies.
De nos jours, et depuis le début du XIX esiècle, celui qui se fait « l’avocat du diable » est celui qui défend une cause choquante ou perdue d’avance, que ce soit par jeu (le plaisir de choquer ceux qui n’admettent pas qu’on puisse aller dans ce sens) ou, de manière plus rusée, pour obtenir quelque chose qui n’aurait pas été accordé sans la belle démonstration qu’impose une défense efficace.
De manière plus générale, un « avocat du diable » est aussi celui qui, volontairement, dénonce la thèse de celui avec lequel il discute dans le but de lui faire renforcer ses arguments.
Cette locution du XVIII esiècle vient de l’Église. En effet, l’ advocatus diaboli était un religieux qui, au cours de l’étude préalable à la canonisation d’une personne, devait rechercher tout ce qui, dans le comportement de cette dernière, pouvait trahir l’influence du diable. Ce rôle a été supprimé par le pape Jean-Paul II en 1983.
Читать дальше