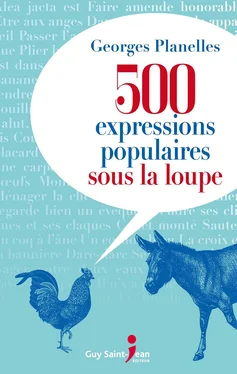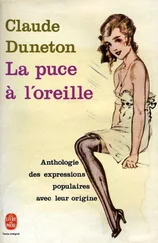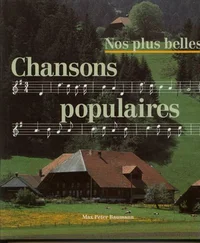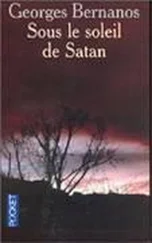Nous causions de tout, parfois âprement, si nous n’étions pas du même avis… Je me faisais souvent l’avocat du diable…
Juliette Lalonde-Rémillard —
Lionel Groulx, l’homme que j’ai connu — Fides — 2000
27. Dans tous les azimuts/tous azimuts
Dans toutes les directions, de tous les côtés, par tous les moyens.
Évacuons tout de suite une éventuelle interrogation : la seconde expression proposée n’est jamais qu’une version abrégée de la première, apparue au début du XX esiècle.
Maintenant, penchons-nous sur l’élément principal : l’azimut, qui s’écrivait aussi avec un h à la fin, mais il a tellement été aspiré qu’il a maintenant quasiment disparu.
Le mot « azimut », attesté au XV esiècle, vient de l’espagnol acimut, lui-même issu de l’arabe az-samt. Il signifie aussi bien « chemin » que « point de l’horizon ». À l’origine un terme d’astronomie, l’azimut désigne l’angle compris entre le plan vertical d’un astre et le plan méridien du point d’observation. Partant de cette définition, une « arme tous azimuts » (terme employé dans le milieu militaire) est une arme capable de tirer dans toutes les directions, et une « défense tous azimuts » peut intervenir contre les attaques venues de tous les côtés. Par extension et au figuré, les azimuts désignent aussi les moyens dans des expressions comme « répression tous azimuts » ou bien « vendre tous azimuts ».
Non satisfaits de faire du bon pain, les deux frères qui mènent la maison s’attaquent maintenant au rayon pâtisserie qu’ils développent tous azimuts. Avis aux gourmands…
Guide Michelin —
Idées de promenades à Paris — Michelin Édition des voyages — 2008
Être stupéfait.
Ce baba-là n’a rien à voir avec le succulent gâteau généralement imprégné de rhum. Il vient plutôt du bas latin, ou latin médiéval, de batare qui voulait dire « ouvrir la bouche ». C’est ce mot qui est d’ailleurs à l’origine de nos verbes « ébahir », « bâiller » et « béer », entre autres.
Et c’est justement du verbe « ébahir » que vient notre expression, « baba » étant d’abord une onomatopée obtenue par redoublement du radical ba- de ce verbe. Elle fut créée à la fin du XVIII esiècle (imaginez quelqu’un de complètement stupéfait qui ne saurait que dire d’un air forcément étonné « ba… ba… ! »).
À cette époque, on l’utilisait aussi comme un nom propre dans l’expression « rester comme Baba » ou « rester comme Baba, la bouche ouverte ». Ce n’est qu’un siècle plus tard que notre version raccourcie a pris le dessus.
J’ai envie de me rincer la bouche, non pas de chai le soir, mais il me propose un masala milk. Une saveur à en rester baba, un nectar ! Les deux serveurs et le préparateur sont là à guetter mon expression : « Good ? » « Good, excellent ! » Vingt-quatre roupies le tout, environ cinquante centimes d’euros, pourquoi se priver ?
Isabelle Soucher-Frappier —
Au fil des jours en Inde du Sud, sac au dos — Sol Air — 2008
1. Partir, décamper.
2. S’enfuir hâtivement.
3. Mourir.
Si aujourd’hui, le bagage désigne bien plus le contenant (la valise ou le sac) que le contenu, il désignait autrefois ce qu’on emportait avec soi lorsqu’on partait. Les objets et vêtements étaient mis dans quelque chose destiné à les transporter, roulé derrière la selle du cheval, dans une sacoche ou dans une malle.
Alors si on imagine mal, de nos jours, plier une valise bien rigide, plier autrefois les vêtements qu’on emportait avec soi ne posait aucun problème.
Au XVI esiècle, on a commencé par dire « trousser bagage » parce que le sens initial de trousser était « charger », « attacher » ou « mettre en paquet ». On comprend bien alors que le fait de plier bagage corresponde à un départ, d’où découle logiquement le premier sens de l’expression.
Au sens de s’enfuir, l’ajout de la notion de rapidité ou de fuite n’est pas vraiment explicité, mais la signification « abandonner un lieu en hâte et sans bruit » a bien été signalée.
Le dernier sens, « mourir », n’est qu’un euphémisme familier, la mort étant bien une forme de départ.
« Rabobank a toujours su où j’étais », a aussi souligné le coureur, qui avait été prié de plier bagage sous la pression de son équipe.
L’Équipe — Article du 8 novembre 2007
Ça fait très longtemps !
Ceux qui louent un logement ou un garage, par exemple, savent parfaitement ce qu’est un bail.
Selon Le Grand Robert , le bail est un « contrat par lequel l’une des parties, la bailleresse, s’oblige à faire jouir l’autre, le locataire, d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix, le loyer, que celle-ci s’oblige de lui payer ».
C’est le « certain temps » qui nous intéresse ici.
Si les baux de logement sont de relativement courte durée, certains peuvent être très longs, comme les baux emphytéotiques qui peuvent durer entre 18 et 99 ans. Autant dire qu’ils durent un bail !
C’est simplement de cette notion de durée parfois très longue que vient notre expression, qui semble dater d’après la Seconde Guerre mondiale.
À notre époque, où on ne laisse plus de temps au temps, où tout s’accélère, on dit aussi « ça fait une paye ! » Sauf que le temps qui s’écoule d’une paye à l’autre est largement inférieur à la durée d’un bail.
Ce matin, c’est le réveil qui m’a sorti du sommeil. Ça me ressemble pas, ça, mais ça fait un bail que ça m’était pas arrivé… j’ai oublié depuis quand ! Et toi tu dormais. C’est la première fois que ça m’arrive depuis longtemps.
Douglas Harper —
Les vagabonds du Nord-Ouest américain — Éditions L’Harmattan — 1998
31. La balle est dans votre camp !
Pour faire avancer les choses, c’est à vous d’intervenir maintenant.
Il y a longtemps que la balle est, au figuré, un mot désignant la parole, une action ou une occasion. En effet, ce mot se retrouve avec cette acception dans plusieurs expressions comme « renvoyer la balle » ou « rattraper la balle », par exemple. Dans beaucoup de jeux de balle, le but est d’envoyer celle-ci dans le camp (la zone de jeu) de l’adversaire, son défi étant de nous la renvoyer, tout comme dans un dialogue chacun prend la balle à tour de rôle.
C’était une habile façon de lancer la balle dans le camp de Lecavalier, qui touchera 85 millions d’ici les 11 prochaines années.
Mathias Brunet — « Vincent Lecavalier terminera-t-il la saison à Tampa ? » —
La Presse, 10 décembre 2009
32. Une république de bananes
État, gouvernement corrompu, où le réel pouvoir est aux mains de firmes multinationales et de puissances étrangères.
La United Fruit Company, fondée en 1899 et devenue près d’un siècle plus tard la Chiquita Brands International, est à l’origine de cette expression.
Pendant 50 ans, cette société dont le siège social se trouvait aux États-Unis a financé et manipulé la majorité des dictatures d’Amérique latine (dans des pays producteurs de bananes) et elle a tenté de tuer dans l’œuf toutes les réformes tentant de redistribuer les terres aux paysans pauvres pour pouvoir continuer à exploiter librement les plantations de bananes et sous-payer les ouvriers qui y travaillaient.
Читать дальше