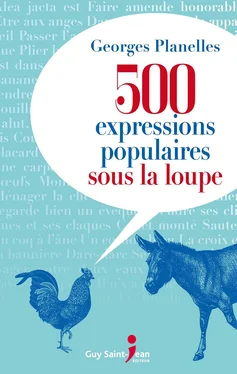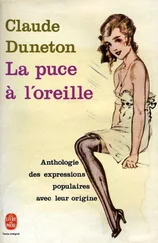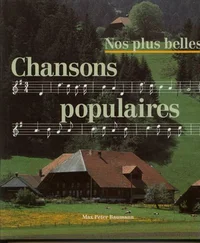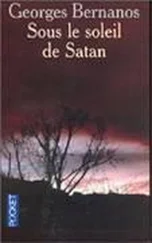Jean-Michel Lecocq —
Le christ jaune — Éditions L’Harmattan — 2010
41. Le benjamin (de la famille, de l’équipe…)
La personne la plus jeune (d’un groupe).
Si Benjamin est un prénom assez courant, on est en droit de se demander comment ce prénom a pu finir par désigner la personne la plus jeune d’un groupe, par opposition au doyen.
D’abord, il faut savoir que si, aujourd’hui, c’est bien une personne d’un âge quelconque qui peut être le benjamin (dans une maison de retraite, le benjamin n’est plus vraiment très jeune), c’est par extension du sens « enfant le plus jeune » en usage auparavant, mais toujours actuel.
En remontant encore plus loin dans le temps, au XVIII esiècle, lorsque le mot apparaît, le benjamin désignait avant tout l’enfant préféré de ses parents.
Pourquoi cela ? Eh bien, il nous faut nous pencher sur la Bible pour tout comprendre.
En effet, la Genèse nous apprend que, dans le pays de Canaan, Jacob eut douze fils, dont le dernier se nommait Benjamin. Lorsque Jacob apprit qu’il pouvait acheter du blé en Égypte, il y envoya ses fils, sauf Benjamin, de crainte qu’il ne lui arrive quelque malheur.
À vingt-huit ans, le nouveau benjamin de l’Assemblée nationale ne s’attendait pas à être élu.
Le Point — Article du 21 juin 2007
1. Avoir une vision déformée (de quelque chose).
2. Avoir des visions.
L’étymologie du mot « berlue » ne fait pas l’unanimité. Le mot pourrait trouver sa source au XIII esiècle, du verbe « belluer » qui voulait dire « éblouir », mais également « tromper » ou « duper ». Son premier usage s’appliquait à un discours trompeur, une fable.
Tombé ensuite dans l’oubli, il réapparaît au XVI esiècle pour désigner en médecine un défaut de la vue qui fait percevoir des objets imaginaires ou qui déforme la réalité.
C’est de cette acception, et du sens figuré « impression visuelle trompeuse », qu’est assez logiquement apparue notre expression au XVII esiècle.
Vous voilà prévenus si vous passez par Key West : non, vous n’avez pas la berlue, Hemingway est partout !
« Les anniversaires Hemingway et Williams » —
La Presse , 24 mai 2011
43. Compter pour du beurre
1. N’être pas pris en considération, être méprisé.
2. N’avoir aucune importance.
Bizarrement, le beurre est souvent associé à l’abondance ou à la richesse : faire son beurre (pour « faire beaucoup d’argent ») ou encore mettre du beurre dans les épinards *. Pourtant, il existait autrefois une locution adjective de « beurre » qui caractérisait quelque chose sans valeur et qui est probablement à l’origine de cette expression.
De même, Larousse précise qu’au XIX esiècle, vendre du beurre signifiait « être ignoré, délaissé dans une société ». D’ailleurs, à cette époque, les jeunes filles qui « vendaient du beurre » dans les bals étaient celles qui n’y dansaient pas, faute de cavalier.
Si l’on fait des recherches sur l’histoire du beurre, on s’aperçoit que, pendant longtemps, c’était une graisse destinée aux pauvres, car elle était facile à produire toute l’année (contrairement à l’huile qu’on ne produit qu’une fois l’an, après la récolte du produit oléagineux).
Jusqu’au Moyen Âge, le beurre a même servi aux soins médicaux ou cosmétiques, que ce soit pour soulager les brûlures, par exemple, ou pour faire briller les cheveux. Ce n’est qu’à partir du XVII esiècle que le beurre devint un produit de luxe et entra pour de bon dans l’alimentation des gens de la haute société (voir « mettre du beurre dans les épinards *»).
C’est probablement de la « première » vie du beurre, celle où il était mal considéré, que vient la connotation négative de « compter pour du beurre ».
— Va t’habiller ! C’est bientôt l’heure de ton audience.
— Une audience bidon, puisque je compte pour du beurre.
Réda Falaki —
La balade du Berbère — Éditions L’Harmattan — 1990
44. Mettre du beurre dans les épinards
Améliorer ses conditions de vie, gagner plus d’argent.
Le beurre est souvent associé à la richesse (on dit « faire son beurre », par exemple, et les Wallons utilisent l’expression « avoir le cul dans le beurre »). C’est probablement parce que c’est un aliment riche (en calories et lipides) qui fut, selon les périodes, réservé aux riches et aux champions du marché noir.
La métaphore contenue dans cette expression est parfaitement compréhensible : les épinards sans beurre, c’est diététique, mais nettement moins bon qu’avec du beurre ou de la crème. Donc pour améliorer le goût de ses épinards (ses conditions de vie), mieux vaut y ajouter une bonne dose de beurre (d’argent).
René Robin, après son travail au magasin, effectue souvent du travail au noir pour mettre du beurre dans les épinards. Il peint l’intérieur des logements et pose le papier peint avec dextérité pour un prix raisonnable chez des connaissances.
Robert Boussemart —
Adieu terrils, adieu corons : les mines du Nord-Pas-de-Calais — Éditions L’Harmattan — 1990
45. Vouloir le beurre et l’argent du beurre
1. Tout vouloir, sans contrepartie.
2. Vouloir gagner sur tous les plans.
L’usage de cette expression nous vient au moins de la fin du XIX esiècle. Le bon sens paysan veut qu’on ne puisse pas, honnêtement, vendre le beurre qu’on vient de fabriquer, en garder l’argent, mais garder aussi le beurre, histoire de pouvoir le revendre encore et encore.
Vouloir toujours tout garder à soi, vouloir tout gagner sans rien laisser aux autres, c’est vouloir le beurre et l’argent du beurre. Mais même si on réussit temporairement et honnêtement à garder le beurre et l’argent du beurre, il ne faut jamais perdre de vue que le beurre, comme l’argent, peut fondre très facilement et rapidement.
Tandis que Georges V avait exécuté la prestation qui lui incombait, Bismarck, par un moyen et des arguties qu’il est impossible de trouver honnêtes, gardait pour la Prusse le beurre et l’argent du beurre.
William Martin —
La crise politique de l’Allemagne contemporaine — 1913
46. Connaître bibliquement
Avoir des relations sexuelles.
Voilà une expression au sens apparemment étrange.
La Bible (puisque « bibliquement » veut bien dire « tel que décrit par la Bible ») n’a pas pour réputation d’être un équivalent du Kâma-sûtra. Ça se saurait, et le nombre de lecteurs exploserait !
Alors comment un verbe banal comme « connaître » peut-il produire un tel sens ?
Or dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse, on trouve une phrase qui, traduite en bon français, s’écrit généralement comme suit : « Adam connut Ève, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : “J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel.” »
Là, le doute n’est pas permis : comme le fameux coup de la vierge qui enfante ne viendra que beaucoup plus tard et même si l’Éternel a un peu aidé, dans cette phrase, « connaître » est bien un euphémisme pour « forniquer avec ».
Ce qui suffit à expliquer le sens de l’expression et à confirmer que l’hésitation à appeler un chat un chat *existe depuis bien longtemps.
Читать дальше