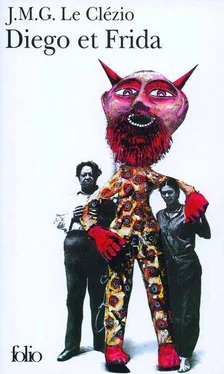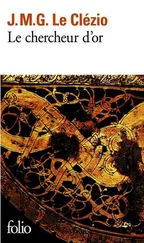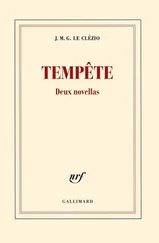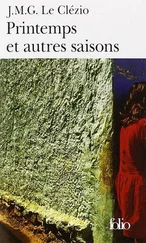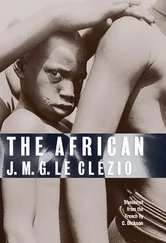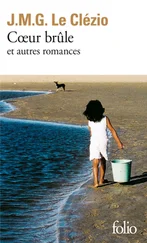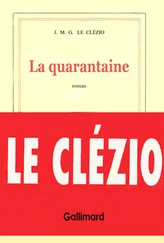Les années Porfirio ont laissé une trace inoubliable : le luxe des villas fin de siècle entourées de grands jardins, les allées somptueuses ombragées d’acacias et de flamboyants, les fontaines, les places publiques ornées d’orphéons en fer tourné où on joue le soir des quadrilles, des valses, des marches. À la société coloniale de la fin du siècle s’est mélangée la ville révolutionnaire, qui a tout à coup ouvert ses portes aux paysans venus des quatre coins de la République, tout un brouhaha de gens, la plupart Indiens, vêtus de leurs caleçons blancs, chaussés de huaraches, les femmes portant leurs bébés enveloppés dans les rebozos. Ils circulent aux abords de la place, ils sont aux marchés San Juan et de la Merced, ils viennent acheter, vendre, ou simplement regarder la ville dont ils ne sont pas encore tout à fait sûrs qu’elle leur appartienne.
Dans toutes les mémoires sont encore présentes les images prodigieuses de la révolution, quand la masse populaire envahit la place du Zócalo et les rues avoisinantes, sorte de corps de dragon géant poussant devant elle les fantômes de l’Histoire. L’autre image, celle de Francisco Villa et Emiliano Zapata, les deux chefs de l’insurrection populaire, le métis du Chihuahua et l’Indien du Morelos, réunis le temps d’une photographie-souvenir sous les lambris du palais, entourés de leurs hommes, quelque chose de sauvage et d’héroïque dans leur regard, dans l’orgueil de leur maintien, dans leur défi au monde des nantis.
Images fugitives, instants fragiles que personne ne peut oublier. À Mexico, tout doit être forcément nouveau. Les révolutionnaires, ces « magnifiques destructeurs », comme les appelle l’historien Daniel Cosío Villegas, professeur d’histoire à la Preparatoria, n’ont peut-être rien su mettre au monde, mais grâce à eux « alors apparut au-dessus du Mexique une aurore éblouissante qui annonçait un jour nouveau. L’éducation cessa d’être le privilège d’une classe urbaine moyenne pour prendre la seule forme qui pouvait être au Mexique : celle d’une mission religieuse, d’un apostolat, apportant aux quatre coins du pays la bonne nouvelle : la nation s’est réveillée de sa léthargie et s’est mise en marche… Alors chaque Mexicain ressentait au plus profond de son être et dans son cœur que l’action éducative était une urgence aussi forte et aussi chrétienne que l’étanchement de la soif et l’apaisement de la faim. Alors apparurent les premières grandes peintures murales, monuments qui aspiraient à fixer pour les siècles à venir les angoisses du pays, ses problèmes et son espérance ».
Il est difficile aujourd’hui, dans un monde laminé par les désillusions, les guerres les plus meurtrières de tous les temps, et par la pauvreté culturelle grandissante, de se représenter le tourbillon d’idées qui enflamment Mexico durant cette décennie qui va de 1923 à 1933. Alors le Mexique est en train de tout inventer, de tout changer, de tout mettre au jour, dans la période la plus chaotique de son histoire, quand, sur la scène politique, se succèdent les régimes, depuis les derniers rituels médiévaux de Porfirio Díaz jusqu’à l’héroïsme révolutionnaire de Lázaro Cárdenas, en passant par les aléas de la politique d’Alvaro Obregón, de Plutarco Elias Calles et de De La Huerta.
Tout est à inventer et tout apparaît durant cette époque fiévreuse : l’art des muralistes au service du peuple — les seuls vrais « romanciers de la Révolution », comme les appelle Miguel Angel Asturias —, écrivant sur les lieux publics l’histoire tragique et merveilleuse du continent amérindien ; l’art au service de l’éducation, quand les campagnes d’alphabétisation du monde rural utilisent le théâtre de marionnettes, la gravure populaire à la manière de Posada, la comédie de rue, les écoles rurales. L’enthousiasme pour l’ère nouvelle gagne tout le pays. Dans les villages les plus isolés (dans la vallée de Toluca, les steppes du Yucatán, ou le désert du Sonora), les maîtres d’école indigènes fondent des académies de nahuatl, de maya, de yaqui, éditent des journaux, des lexiques, des recueils de légendes. La peinture naïve — non pas celle des chapelles et des marchands de tableaux, mais, comme plus tard en Haïti ou au Brésil, la peinture née dans les champs et dans la rue — éclate comme un feu d’artifice dans une fête : elle pénètre et force la peinture officielle, apporte ses formes, ses visions nouvelles, une façon inédite d’embrasser le monde, de rendre sa pureté à la culture. La révolution fauve et cubiste qui avait un instant attiré les grands peintres de la modernité est balayée au Mexique par cette révolution populaire qui détourne l’art de la culture gréco-romaine, le replonge dans la réalité contorsionnée du quotidien où les expressions, les symboles, les équilibres et jusqu’aux lois de la perspective n’obéissent pas aux mêmes critères.
Lorsque Diego revient au Mexique pour la deuxième fois, en 1921, c’est cela qu’il trouve et qui le retient pour toujours. Ce qu’il découvre dans le Mexique brisé et pantelant du lendemain des guerres civiles, c’est l’autre révolution, qui commence quand la révolution politique est en train de s’achever.
La Révolution mexicaine, née de l’enthousiasme de Madero et de l’indignation populaire, meurt au cours des années 20 dans le caudillismo révolutionnaire, la succession des Césars et des assassinats : Venustiano Carranza, tué à Tlaxcalantongo par la faction armée favorable à Obregón ; Obregón, assassiné par le fanatique Toral à Coyoacán, au lendemain de sa réélection. Pouvoirs et contre-pouvoirs cherchent à se partager les restes de l’âge d’or de la révolution tandis que tombent les vrais révolutionnaires, Felipe Carrillo Puerto, Francisco Villa, Emiliano Zapata, assassinés par ceux-là mêmes qu’ils ont aidés à s’emparer des terres. Calles, surtout, l’homme de toutes les ambiguïtés, le Jefe máximo de la Révolución, qui, au nom de la Constitution de 1917, plonge le Mexique rural dans la plus sanglante, la plus cruelle des guerres de castes : le pouvoir central athée et anticlérical contre les paysans catholiques du Michoacán, du Jalisco et du Nayarit.
Diego fuit l’Europe anéantie par la guerre, une Europe sombre et glacée comme l’enfer — l’enfer de Montparnasse, ce Minotaure qui a dévoré le corps de son fils, et qui a réduit l’amour d’Angelina à une farce douloureuse — et ce qu’il trouve à son retour au Mexique, c’est cette explosion de vie et de violence, ce chaos régénérateur où tout est magnifiquement nouveau, le corps des femmes, la sensualité métisse de Lupe Marín, l’immensité des horizons et des possibilités. Il découvre aussi l’âpre enracinement dans cette terre, les pulsions secrètes du passé indien en train de renaître, et surtout l’extraordinaire impatience de ce peuple qui attend depuis si longtemps, qui est prêt à tout recevoir, à tout apprendre. Tout cela que Diego Rivera appelle lui-même la Renaissance mexicaine : « Alors les fresques commencèrent à éclore sur les murs des écoles, des hôtels, des bâtiments publics, malgré les attaques violentes de l’intelligentsia bourgeoise et de la presse à son service. »
Diego rentre au Mexique porteur de cette certitude : la terrible guerre qui a coûté tant de vies à l’Europe et qui a pris la vie de son fils n’a pas été un épisode de plus dans l’affrontement des nationalismes. Elle a été le signe du naufrage de la bourgeoisie capitaliste et l’annonce d’un changement total dans l’histoire de l’humanité. La révolution, cet incendie qui a brûlé le Mexique avec une fureur fulgurante, en a été le premier signal. Mais la Révolution russe de 1917, elle, a apporté au monde la foi nouvelle et l’espérance du triomphe des forces populaires sur l’ère du capital. Diego a fait sienne la formule du premier Manifeste du Parti communiste américain, en septembre 1919 :
Читать дальше