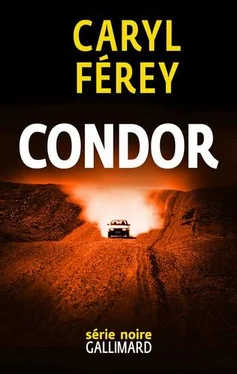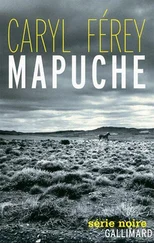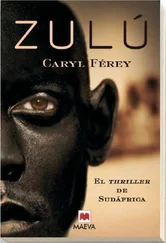Valparaiso, où avait été imaginé le Plan Condor, Valparaiso où la Marine aux ordres de Pinochet avait fait des manœuvres avant le coup d’État : Stefano vivait à rebours.
— Tu as des preuves de tout ça ? demanda-t-il.
— Mon témoignage, autant dire rien du tout, fit l’avocat. Je ne connais pas le nom de mes agresseurs et ça m’étonnerait qu’ils figurent dans les fichiers de la justice.
— Ton copain Luis était quand même policier.
— Ça ne les a pas empêchés de l’abattre de sang-froid… Tout le monde était sur écoute, Edwards, Luis, moi, d’autres personnes peut-être. Un réseau de surveillance suffisamment élaboré pour être réactif quasiment en temps réel. Schober n’est pas seul, il a une équipe de pros derrière lui, des tueurs, des spécialistes de l’espionnage électronique et des complices jusque dans la police. On ne peut plus avoir confiance en personne. Il va falloir se débrouiller seuls.
Après ce qu’il venait de vivre avec le chef des carabiniers, Stefano se voyait mal le contredire.
— Ils savent peut-être où vous êtes, réalisa-t-il alors. Un mouchard quelconque a pu vous localiser.
— Si c’était le cas, il y a longtemps qu’ils seraient venus me liquider.
— Oui… Sans doute.
L’avocat était le seul témoin des meurtres. Raison de plus pour se tenir loin de Valparaiso.
— Vous feriez mieux de rester planqués à Lota, dit Stefano. Au moins le temps de te remettre.
— Ha ha, pour ça n’y compte pas trop ! lâcha Esteban dans un petit rire sans joie.
Ils étaient pris dans les barbelés.
* * *
Minuit sonna dans l’appartement du Ciné Brazil. Près du poêle, Anita Ekberg prenait un bain de nuit dans une fontaine romaine. Stefano était assis dans la cuisine, regardant le P38 posé sur la table comme s’il était responsable de ses actes. Trop de colère accumulée sans doute, d’innocents et d’espoirs assassinés. Le logement semblait vide sans Gabriela, partie avec l’avocat. Il venait de les avoir au téléphone. La tension retombait, contrecoup des derniers événements, et il ne savait trop quoi penser. Stefano se sentait vieux, usé, une sculpture de métal abandonnée sous la pluie. Il n’avait pas dit ce qui s’était passé dans la décharge, juste que Popper était mort après avoir avoué les meurtres et le trafic. Mais Esteban avait raison : tout venait de Valparaiso.
Des nuages troublaient la lune par la fenêtre de la cuisine. Stefano gambergeait dans le silence de la nuit, le regard perdu sur le vieux pistolet. L’avocat était hors course même s’il s’en défendait, Gabriela consignée avec lui à Lota. Stefano ne pouvait pas les laisser comme ça. Il devait stopper Schober et ses tueurs avant qu’ils ne les retrouvent. Car la petite était en danger avec Esteban, beaucoup plus qu’elle ne l’imaginait. Stefano savait qu’elle partirait un jour du cinéma, comme les enfants nous quittent, mais ses sentiments s’étaient cristallisés depuis le décès de Patricio. Gabriela était son esprit-fille, son espoir après la mort, l’ADN d’un autre futur pour son pays. Il n’avait pas su protéger Manuela à l’époque : il ne pouvait pas perdre une deuxième fois la femme qu’il aimait le plus au monde.
Il décida d’aller à Valparaiso, dès le lendemain. Une fois là-bas, il verrait quelle option serait la moins mauvaise.
Incapable de dormir, Stefano prépara un sac de voyage, y glissa le Parabellum et les munitions, quelques affaires de première nécessité. Une petite araignée brune déroulait son fil depuis l’abat-jour de la lampe 1900 posée sur le secrétaire de la chambre. Il chercha sur Internet et trouva plusieurs photos de Gustavo Schober, plus ou moins récentes, celles d’un septuagénaire au physique avantageux, les cheveux gris ramenés en arrière, qui lui sembla familier… Où l’avait-il croisé ? Une photo notamment datait du début des années 2000, lors de l’inauguration de l’usine de transformation de poisson à Antofagasta : Stefano observa de longues secondes le visage glabre de l’homme d’affaires, ses traits réguliers, et son cœur lentement se serra.
Un rideau de larmes l’aveuglait après qu’El Negro lui avait démoli le genou dans le bureau de la Villa Grimaldi, mais le visage était resté net dans son souvenir. Le jeune officier qui avait passé un savon à la brute, l’homme qui par humanité l’avait sauvé en l’envoyant à l’hôpital, c’était lui : Gustavo Schober.
Port mythique des cap-horniers du Pacifique Sud jusqu’à l’ouverture du canal de Panamá, Valparaiso avait failli être rayé de la carte après le tremblement de terre de 1906 qui avait dévasté la moitié de la ville. Les riches avaient rebâti leurs maisons sur les collines, les autres s’étaient accrochés à ce qu’ils pouvaient. Régulièrement, les incendies continuaient de ravager les quartiers pauvres, mal raccordés, mais avec ses cerros aux maisons colorées entassées contre les flancs pentus des collines, ses ruelles baroques, ses graffitis subversifs et ses funiculaires d’un autre temps, Valparaiso restait la plus belle ville du pays.
De petits bus intrépides se faufilaient dans le trafic, toujours intense le long du port de commerce ; Stefano dépassa les échoppes des marchands ambulants, joua du klaxon et gara la voiture de location dans un parking souterrain proche de la mer. Il remonta à pied à l’air libre, un ticket en poche.
Il était midi à l’horloge de l’hôtel de ville, vaste bâtiment bleu et blanc dont l’architecture rappelait l’époque coloniale. L’esplanade pavée donnait sur l’avenue grouillante où les trolleys bigarrés chassaient les piétons imprudents. Stefano enfonça les mains dans les poches de sa veste en daim, traversa sur les passages cloutés en prenant garde aux chauffards sans pitié pour son genou d’éclopé. Il avait laissé le P38 dans le coffre de la voiture, au fond du sac. Un simple repérage pour le moment.
L’accès au port de commerce était bloqué par de hautes grilles acérées. D’après les infos d’Esteban, le terminal 12 appartenait à Schober. Stefano marcha jusqu’au petit port de pêcheurs accolé au monstre industriel — des milliers de tonnes étaient débarquées chaque jour des porte-containers et autres vraquiers géants qui accostaient les quais. Le ciel était bleu au zénith, le vacarme de la circulation moins oppressant aux abords des chalutiers. Quelques marins recousaient les filets après leur matinée en mer, une cigarette à la bouche, sans un regard pour les bateaux flanqués de bouées orange qui promenaient les touristes dans la baie. Stefano acheta un empanada à l’une des boutiques qui longeaient le port de pêche, s’assit sur un banc où il pouvait surveiller le ballet ininterrompu des camions devant les grilles. Trois grues gigantesques alimentaient les remorques depuis les ponts des navires, leurs containers empilés comme des cubes défiant la pesanteur. Il pensait toujours à l’officier de la Villa Grimaldi, au chemin sordide qui les réunissait aujourd’hui… Une mouette stoïque attendait près du banc, l’œil oblique. Stefano lui lança un bout de son chausson aux épinards, guère fameux, que le volatile avala d’un coup de bec avant de s’envoler comme si on pouvait le lui chiper. Aucun véhicule privé n’entrait ou ne sortait du port de commerce, seulement des camions chargés de marchandises. Stefano quitta le banc où soufflait l’air marin, se dirigea vers la guérite du gardien qui filtrait l’accès aux quais et demanda comment accéder aux bureaux du terminal 12.
Le type, un petit gros au nez de tapir, l’accueillit d’abord avec méfiance.
— On peut pas entrer avec sa voiture par ici, répondit-il, c’est réservé aux camions ! Pour les bureaux, faut aller à l’autre bout du port, du côté de la plage de San Mateo !
Читать дальше