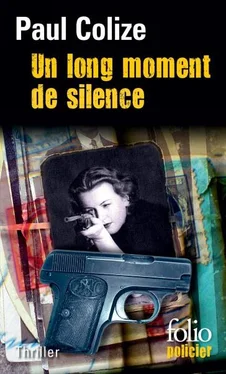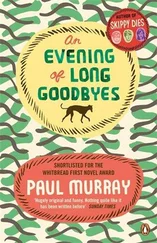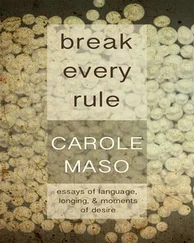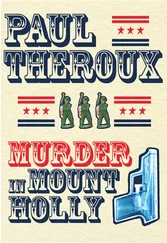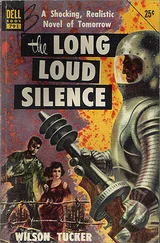Je m’arrête à hauteur de Karlsruhe.
Il est presque dix-huit heures. Je fais le plein, j’avale trois cafés et deux sandwiches. J’en profite pour envoyer un mail à Katz. Je lui explique dans les grandes lignes ce qu’il sait déjà.
À la mort de sa mère adoptive, Reinhard a récupéré la perle et a appris qu’elle venait de sa mère.
Le doute est venu ce jour-là. Pour quelle raison sa mère lui aurait-elle remis ce bijou ?
Il a entamé une enquête.
Un joailler de Magdebourg lui a appris que c’était une pièce prestigieuse, souvent remise à la naissance dans l’aristocratie polonaise. Il a tenté d’en savoir plus, mais il a été expulsé par les bureaucrates est-allemands.
Comme il se faisait insistant, la Stasi s’en est mêlée. Il a laissé tomber.
En 1989, lors de la réunification, il a voulu connaître la vérité, mais il n’avait pour seuls outils qu’un téléphone et du papier à lettres. Il a continué ses recherches malgré tout. Deux ans plus tard, il a appris qui était son père, mais n’est pas parvenu à connaître le nom de sa mère.
Il a tenté sa chance à Lwów, devenue Lviv, et s’est heurté à l’administration ukrainienne.
Un fonctionnaire lui a fait comprendre à demi-mot qu’il était comme des milliers d’enfants de cette époque, un enfant non désiré d’un père nazi et d’une mère de race inférieure. Un sous-homme. Un moins que rien.
La honte ne l’a jamais quitté.
La même honte que ma mère a dû ressentir et qui l’a incitée à ne jamais en parler. Plus encore que la honte, l’amour qu’elle nous portait l’a poussée à nous cacher l’existence de cet enfant.
Enfant de veuve était déjà assez difficile à porter, veuve de nazi et demi-frère de schleu aurait été insupportable.
J’ai compris ce qu’elle regrettait tellement. La mort de son mari, la perte de son enfant, la honte, la mort du deuxième homme de sa vie.
À hauteur de Speyer, je suis ralenti par des travaux sur le pont qui enjambe le Rhin. Je perds une bonne demi-heure, bloqué entre les camions et les caravanes de Hollandais.
Dès que l’autoroute s’ouvre à nouveau, j’enfonce l’accélérateur. Je monte à cent quatre-vingts.
Mes paupières sont lourdes, je zigzague entre les voitures pour rattraper le temps perdu.
Quand le coq a chanté, nous avons arrêté de parler.
Nous étions épuisés. Sa femme est venue nous servir du café. Laura s’est écroulée dans le canapé.
Mon téléphone me sort de ma torpeur.
Numéro inconnu.
— Stanislas ?
Je reconnais sans peine la voix de Nathan Katz.
— Vous avez reçu mon mail ?
— Je suis content pour toi.
— Vous avez fait du bon boulot, monsieur Katz. Sans vous, je n’aurais jamais su le fin mot de cette histoire.
Il soupire.
— Il faut parfois attendre de longues années pour recevoir une réponse.
J’ai l’impression qu’il évoque autre chose que mon histoire.
— Sans doute.
— Dans certains cas, c’est mieux.
Il laisse un blanc avant de poursuivre.
— Il y a une chose que tu ne sais pas et Reinhard non plus. J’ai retrouvé certains documents, des lettres aussi. Rudolf Volker est venu chercher Reinhard à Lwów au début du mois de juillet 1944. Nous avons retrouvé les documents de transport. Il n’est pas allé directement chez ses parents. Il est d’abord retourné à Berlin et l’a placé dans une famille d’accueil parce qu’il a dû partir en mission à Alexandrie, en Égypte. L’enfant est resté à Berlin jusqu’au début du mois d’août. Quand Rudolf est reparti avec lui en Allemagne, son frère était mort au front et ses parents ont refusé de prendre l’enfant. Ce sont eux qui lui ont donné l’adresse du couple de Messdorf. Rudolf Volker a trafiqué les papiers pour en faire leur fils adoptif, comme c’était le cas pour les Lebensborn .
— C’est une des zones d’ombre qui restait.
— À présent, tu en sais autant que moi. Je te salue, Stanislas, ton père aurait été fier de toi. Dieu te garde.
Il raccroche sans me laisser l’occasion de répondre.
Je passe Coblence. L’orage éclate.
Des trombes d’eau s’abattent sur la route.
Je pense à mon père, à ce qu’il a fait. Par amour.
Malgré moi, je suis forcé de ralentir.
Il est vingt heures trente, le ciel est noir d’encre.
J’imagine la détresse de ma mère quand elle a appris dans quelles circonstances mon père était mort et ce qu’il faisait pour elle. Malgré cela, la honte l’a emporté.
De nombreuses voitures se rangent sur le côté pour échapper au déluge. Des éclairs traversent le ciel.
J’agrippe mon téléphone, fais le numéro que je connais par cœur sans jamais le composer.
Sa voix me fait sursauter.
— Oui ?
— Sébastien ?
— Qu’est-ce que tu veux ?
— Il faut que je te parle.
— De quoi ?
— J’aimerais te voir.
— Tu me verras à Noël, je n’ai pas beaucoup changé.
Il raccroche.
En temps normal, je me serais arrêté là.
Je refais le numéro.
— Quoi encore ?
— Cinq minutes, je te demande cinq minutes.
Il se tait.
Me connaissant, il se doute que c’est important.
— Bon, cinq minutes.
— Je peux passer chez toi ?
Un blanc.
— Quand ?
— Demain, à l’heure qui t’arrange.
— À l’heure qui m’arrange, c’est nouveau ça.
Cette fois, c’est moi qui me tais.
— Bon, OK, demain. Vers midi.
— D’accord, je serai là à midi.
Je perçois une hésitation. Il veut ajouter quelque chose.
J’attends.
Il reprend.
— Un truc…
Il semble embarrassé.
— Je t’écoute.
— Voilà, Julie est enceinte. Comme ça, tu le sais.
Les essuie-glaces ne parviennent pas à chasser les torrents d’eau. Je double un camion en perdition, les feux de détresse allumés.
— C’est pour quand ?
— Octobre.
— OK, à demain.
Après les fleurs, j’ai quitté Reinhard. Nous avons promis de nous revoir.
J’ai déposé Laura à la gare de Wolfsburg et j’ai pris la route pour Zusmarshausen.
Je passe Cologne, la pluie se calme, j’accélère de plus belle.
Il est vingt-deux heures lorsque je passe la frontière.
Le temps est sec, il n’a pas plu en Belgique. La route est dégagée. J’accélère.
Il me reste une centaine de kilomètres à parcourir lorsque je prends ma décision.
Je reprends le téléphone.
— Thierry ?
Il ne semble pas surpris de mon appel.
— Oui, Stan ?
— Tu peux planifier l’opération. Si j’en sors impuissant, je te casse la gueule.
Il rit.
— D’accord. Je suis content. Je m’occupe de ça. Je te rappelle demain au plus tard.
— Salut.
Il me retient.
— Attends…
— Quoi ?
— Je voulais te dire, je suis désolé pour dimanche. Je ne pensais pas ce que je disais. Je n’ai pas envie de te perdre, tu n’es pas un pauvre con.
— Laisse tomber. En plus, ce n’est pas tout à fait faux.
J’entre dans Bruxelles. Il est vingt-trois heures trente. Je ne parviens plus à garder les yeux ouverts. Je jette un coup d’œil dans le rétroviseur. J’ai l’air d’un zombie.
Il me faut quinze minutes pour arriver à destination.
Je gare la voiture.
Je repère un rai de lumière derrière l’une des fenêtres. Je décide de tenter le coup. Je grimpe les marches, sonne à la porte de l’immeuble.
L’interphone me répond.
— Oui ?
— Stanislas Kervyn.
Elle s’égosille.
— Vous êtes fou ?
— Oui.
— Je descends.
Читать дальше