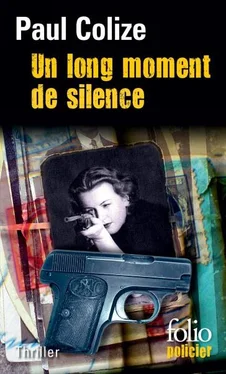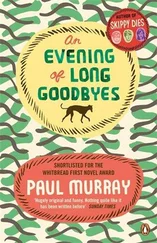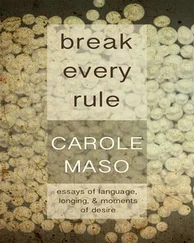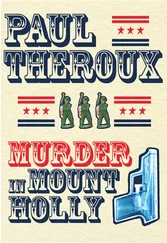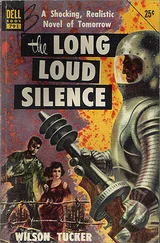— Je l’ignorais. En 1941, il a été affecté au service de Johann von Leers. Il lui servait de secrétaire, entre autres. Il était principalement basé à Berlin et à Iéna, mais il l’accompagnait dans tous ses déplacements.
Nathan tressaillit.
Johann von Leers était l’une des cibles prioritaires du Chat. Aux dernières nouvelles, il se trouvait en Argentine où il travaillait en toute impunité comme rédacteur en chef pour un magazine nazi appelé Der Weg .
Il masqua son intérêt.
— Je vois qui est Johann von Leers. Cette information pourrait m’aider, en effet. C’est tout ce que vous avez ?
— Non. Werner, le frère de Rudolf, a été enrôlé en 1939. Il était simple soldat et a été envoyé en Pologne en juin 1940, à Lodz d’abord, jusqu’en janvier 1941, dans le centre de la Pologne, ensuite à Radziechow. Il connaissait le travail de la terre. Son rôle était de contrôler la production agricole de la région et de l’accroître si possible. Quand les Russes ont lancé leur offensive en juillet 1944, il a été envoyé au front. Il n’avait jamais combattu, il a été tué lors de son premier combat.
— Pourquoi me racontez-vous l’histoire de son frère ?
— Je vous expliquerai tout en détail, si nous sommes appelés à nous revoir.
— Qu’est-ce qui vous fait dire que Rudolf Volker est encore en vie ?
— J’ai entamé des recherches de mon côté. Les autorités est-allemandes ne m’ont pas beaucoup aidé, mais j’ai au moins appris qu’il n’avait pas été déclaré mort. J’ai besoin de vous, monsieur Katz.
— Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi un peu de temps et donnez-moi un numéro de téléphone où je peux vous joindre. Dès que j’ai quelque chose, je vous fais signe.
« Tu seras bon avec le bon, mauvais avec le mauvais. »
PROVERBE JUIF, XIIIe SIÈCLE
— N’avions-nous pas convenu que vous respecteriez les limitations de vitesse ?
Je jette un coup d’œil au compteur. Je suis à plus de cent quatre-vingts.
Jusqu’à cet instant, elle savourait sa victoire.
En plus d’une hausse de ses honoraires, j’ai dû m’engager à ne pas dépasser la vitesse autorisée, à faire une halte dès la première injonction, à trouver un restaurant et un hôtel acceptables pour la nuit et à m’abstenir de lui demander si ça lui dirait de baiser avec moi. Comme si ça ne suffisait pas, elle a justifié son accord par l’ambition dévorante de sa fille qui souhaite poursuivre ses études à Lausanne.
— Il n’y a pas de limitation sur cette portion d’autoroute.
Elle accuse le coup.
— Dans ce cas, je vous demande de faire un petit arrêt.
— Nous avons fait un arrêt il y a moins d’une heure. Il reste une soixantaine de kilomètres, vous pouvez vous retenir ?
Le silence qu’elle m’oppose est éloquent. L’avantage vient de changer de main.
Nous passons Braunschweig et empruntons la bretelle de sortie. Cette partie de l’Allemagne semble moins convoitée par les touristes. Nous sommes partis à dix heures et n’avons rencontré aucun embouteillage.
Bellini m’attendait devant chez elle, à Auderghem. Cette fois, elle n’avait préparé qu’un sac de voyage.
Durant la première heure, je lui ai fait part des derniers rebondissements : ma visite à Karlsruhe et ma rencontre mouvementée avec Katz. Elle ne regrettait pas d’avoir accepté de m’accompagner, la perspective d’être aux premières loges pour assister à la fin du spectacle l’émoustillait.
Le paysage change dès la sortie de l’autoroute. L’espace se dégage, des champs s’étendent à perte de vue. Seuls quelques arbres viennent troubler la ligne d’horizon.
Après quelques kilomètres, la route se rétrécit et son état se dégrade.
Il reste quarante kilomètres à parcourir.
Nous croisons peu de véhicules. De longues lignes droites se succèdent. Certaines aboutissent à un virage à angle droit sans qu’il n’y ait de carrefour pour autant.
Nous traversons quelques villages. Ils semblent inhabités. Les trottoirs sont déserts. Je ne vois ni commerce, ni café, ni restaurant. Il me faut un moment pour réaliser qu’un élément familier dénote par son absence ; aucune enseigne, aucune affiche publicitaire n’orne les façades.
Pour ajouter à la désolation ambiante, l’éclairage urbain n’a pas encore été installé.
Trente kilomètres nous séparent de Messdorf.
Plus nous nous enfonçons dans l’arrière-pays, plus les habitations donnent l’impression d’être à l’abandon. De nombreuses maisons sont en ruine, quelques-unes se disent à vendre. Entre les hameaux, nous retrouvons les interminables lignes droites.
Vingt kilomètres.
Plus je m’approche de la destination, plus j’ai le sentiment de remonter le temps. Rien de neuf n’a été construit ici depuis Staline.
Quinze kilomètres.
Kremkau.
À Berkau, nous croisons une Trabant bleu ciel.
Les maisons qui sont encore debout ressemblent aux bâtisses à colombages que l’on voit en Normandie. Les façades sont bardées de pans de bois entre lesquels jaunit un torchis ou du plâtre. D’autres sont en briques rouge vif. Certaines sont coiffées d’un toit de chaume.
Bismark, un village à peine plus gros que les autres.
À la sortie de la bourgade, nous longeons de longues barres d’immeubles disposées en parallèle, les sinistres logements communautaires de l’ex-RDA. Ils ressemblent à des casernes désaffectées. Du linge pend à certaines fenêtres, signe apparent d’un reste de vie.
Laura sort de son mutisme.
— C’est riant, comme coin. Ils savent que l’Allemagne est réunifiée ?
— Je n’ai pas l’impression.
— Vous avez une idée de ce qui nous attend là-bas ?
— Aucune.
Huit kilomètres.
Je me rends compte que sa présence ne sera peut-être pas nécessaire. Ce qui nous attend n’est peut-être qu’une maison en ruine, un monument ou un cimetière.
Une autre ligne droite de plusieurs kilomètres nous amène à Buste, dernière étape avant Messdorf. Nouveau virage serré, suivi d’une nouvelle ligne droite.
Nous arrivons à la gare de Messdorf, une simple aubette au bord de la voie ferrée. Mon navigateur m’informe qu’il me reste deux kilomètres à parcourir.
À l’entrée de Messdorf, le macadam fait place aux pavés. Nous sommes sur la Hauptstrasse, il me reste à trouver le 27, aucune maison n’affiche de numéro.
J’interpelle Bellini.
— Que veut dire Hauptstrasse ?
Elle lève les yeux au ciel.
— Avenue principale.
Je roule au ralenti.
Il est seize heures. Le village dort, pétrifié sous le soleil. Personne dans les rues. Quelques voitures sont garées sur les bas-côtés, pour la plupart de vieux modèles Volkswagen ou Audi.
Nous parcourons une centaine de mètres.
Laura se manifeste.
— Là, le 25. C’est la maison suivante.
— Ça dépend dans quel sens vont les numéros.
La précédente est en ruine.
Bellini confirme.
— C’est la suivante.
Nous nous arrêtons devant une ferme brun-rouge d’une vingtaine de mètres de long. Aucune porte ne s’ouvre sur la façade. Trois fenêtres à croisillons sont disposées du côté droit, trois autres du côté gauche.
Au centre, une large voûte d’entrée donne accès à la cour intérieure.
Je coupe le moteur. Nous sortons de la voiture. Le soleil nous tombe sur les épaules. La chaleur est suffocante.
J’indique la façade.
— Entrons par là.
Nous franchissons le porche.
Читать дальше