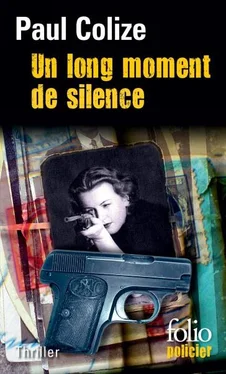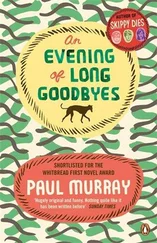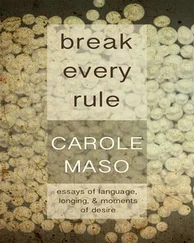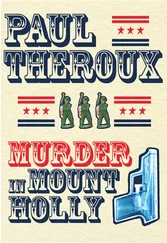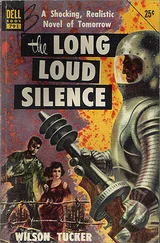— Votre cousin Roland a téléphoné à votre société pour leur expliquer ce qui s’est passé. Il est très gentil.
Ont-ils trouvé ma petite boîte métallique ?
Elle était dans ma poche. S’ils ont cru qu’elle ne contenait que des pastilles à la menthe, ils l’ont jetée. J’espère qu’ils auront des Imitrex.
— Vous avez une commotion cérébrale. On vous a mis sous sédatifs et on vous a posé une minerve. Vous étiez fort agité, mais maintenant vous allez vous sentir mieux.
Une commotion cérébrale ?
J’ai percuté un poids lourd à deux cents kilomètres-heure et je n’ai qu’une simple commotion cérébrale ? Soit elle se fiche de moi, soit elle n’ose pas m’avouer la vérité.
— Vous avez quelques lésions au visage, mais vous n’avez aucune fracture. Vous avez eu beaucoup de chance.
— Mes affaires ?
Depuis le début, elle hurle dans mes oreilles comme si j’étais sourdingue.
— Les affaires qui étaient dans votre voiture ont été récupérées par la police. Votre cousin est allé reprendre celles que vous aviez laissées à votre hôtel, à Zusmarshausen.
Je rouvre les yeux.
Elle est penchée sur moi. Son visage est à quelques centimètres du mien.
L’homme qui l’accompagne n’a pas bronché, il est au garde-à-vous derrière elle, monolithique. C’est certainement un toubib, il porte une blouse blanche sur une chemise bleue et une cravate rouge.
Je referme les yeux.
Je tente un mouvement. Mes muscles sont douloureux, ma nuque est bloquée. Je ne suis qu’élancements, des épaules aux chevilles.
— Quand ?
— Quand pourrez-vous sortir, c’est ça que vous voulez savoir ? Dans deux ou trois jours, en principe, si tout se passe bien. La police est venue, ils vont revenir cet après-midi pour vous interroger sur l’accident. Le chauffeur du camion a été blessé.
Les flics ont récupéré mes affaires. Fouille-merde comme je les connais, ils ont dû s’en donner à cœur joie. Les ont-ils ramenées ici ? S’ils ont trouvé le pistolet, ils vont me mener une vie infernale ; d’où vient-il, où est votre port d’arme, pourquoi vous promenez-vous en République fédérale d’Allemagne avec un flingue sans numéro de série ?
Le toubib prononce quelques mots.
Elle lui répond en allemand et revient vers moi.
— Vous comprenez ce que je dis, monsieur ?
— Oui.
— Le docteur Kösztler aimerait vous parler. Je vais traduire ce qu’il va dire.
Le toubib lance une longue tirade. Elle écoute en hochant la tête.
Je l’interromps avant qu’elle ne commence à restituer.
— Ne criez pas.
Elle baisse le ton.
— D’accord, monsieur. Voilà, nous avons fait quelques analyses, de votre sang, entre autres, cela fait partie de la procédure normale.
— Et ?
— Votre taux de PSA est supérieur à 10.
Suis-je censé savoir ce que cela veut dire ?
— Et après ?
— Le PSA est l’antigène de la prostate. Un taux de PSA élevé peut indiquer que vous avez un cancer de la prostate.
Le schleu acquiesce dans son dos.
Un cancer de la prostate ?
Pas de quoi paniquer. Mitterrand a dirigé la France pendant quatorze ans avec un cancer de la prostate. Si j’en crois les ouï-dire, sa prostate défaillante ne l’a pas empêché de baiser comme un lapin.
L’infirmière reprend.
— Vous le saviez ?
— Non.
— Vous n’aviez pas de douleurs ? Des difficultés à uriner ou des mictions fréquentes ? Une difficulté à vous retenir ? Du sang dans vos urines ?
— Non.
— Des douleurs quand vous éjaculez ?
— Non.
— Le docteur Kösztler propose de faire d’autres examens dans notre service d’urologie, pour établir un diagnostic plus précis.
— Je ferai ça chez moi.
Elle traduit.
Le toubib lâche quelques phrases. Il n’a pas l’air satisfait de ma réponse.
Elle revient à la charge.
— Dans ce cas, le docteur Kösztler vous conseille de ne pas tarder. Le cancer de la prostate peut être bien traité. Plus tôt il est soigné, plus de chances vous avez de guérir.
— D’accord.
Ils sortent, l’un derrière l’autre.
Quel enfoiré ce Kösztler ! Il aurait pu attendre que je sorte du cirage pour m’annoncer cette nouvelle. Certains types n’ont aucun tact.
25
L’uniforme noir des SS
Je tente de me lever dès que la porte est refermée.
J’ai surestimé mes forces. Tous les muscles de mon corps sont contusionnés. Le seul mouvement de ma respiration provoque des élancements qui irradient de mon thorax jusque dans le dos. J’ai l’impression d’avoir les côtes fracturées et les poumons perforés.
Vous avez eu beaucoup de chance.
J’essaie de basculer pour me mettre sur le flanc. Je tends un bras, à la recherche de la poignée de mobilisation qui équipe certains lits. Pas le mien. Je parviens à agripper l’un des montants et à me hisser quelque peu. Chaque centimètre se gagne au prix de geignements plaintifs.
L’opération me prend une dizaine de minutes.
Vous avez eu beaucoup de chance, vous avez un cancer de la prostate.
Je remarque à présent que je ne suis pas seul dans la chambre. Un individu est allongé dans le lit contigu. Des tuyaux lui sortent de tous les côtés. Il est cramoisi. Ses cheveux lui collent au front, ses yeux roulent dans ses orbites. À mon avis, il n’en a plus pour longtemps.
Il m’observe et cherche à accrocher mon regard. Il ouvre la bouche, prononce quelques mots que je suis bien en mal de comprendre.
À bout de souffle, il suffoque et se met à tousser.
Qu’est-ce qu’ils lui ont raconté ? Qu’il a eu beaucoup de chance ? Qu’ils ne lui ont enlevé qu’un poumon ?
Il me faut quelques minutes de plus pour parvenir à m’asseoir dans le lit. La tête me tourne, un vertige me prend.
Vaincu, je me recouche et appelle l’infirmière. Une jeunette débarque. Je lui demande en anglais de faire venir sa collègue qui parle français.
Il lui faut une demi-heure pour arriver.
— Oui, monsieur ?
— J’aimerais changer de chambre.
Elle écarquille les yeux.
— Changer de chambre ? Pourquoi ?
— Je veux aller dans une chambre individuelle.
Elle secoue la tête.
— Ce n’est pas possible. Nous avons peu de chambres individuelles et elles sont réservées à certains patients. Je ne suis pas sûre que vous remplissiez les conditions.
— Renseignez-vous.
Elle tourne les talons.
À midi, deux infirmiers débarquent pour me transférer dans une chambre individuelle. Tout bien pesé, je répondais aux exigences. Comme partout, tout est question de pognon.
Les deux gaillards ouvrent l’armoire et posent mes affaires sur le lit.
Je repère les vêtements que je portais lors de l’accident. Ils sont dans un sale état. Ils y joignent le sac que Roland est allé chercher à Zusmarshausen. En revanche, je ne vois ni carton ni téléphone. Plus inquiétant, il n’y a pas de trace de mon Mac, resté à l’hôtel Die Post .
Les gardes-malades manœuvrent et emportent le lit hors de la chambre, sous l’œil interrogateur de mon voisin.
Nous parcourons un long couloir. Le moindre écart me fait souffrir. Au passage, je croise mon regard dans l’une des vitres. J’entrevois les lésions dont l’infirmière parlait. J’ai le front écorché et l’œil gauche à moitié fermé.
Le court trajet en ascenseur est éprouvant. Mes sbires s’en contrefichent. Ils me poussent dans un nouveau couloir, franchissent une porte et immobilisent le lit. Ils prononcent ensuite quelques syllabes gutturales et ressortent de la pièce.
Читать дальше