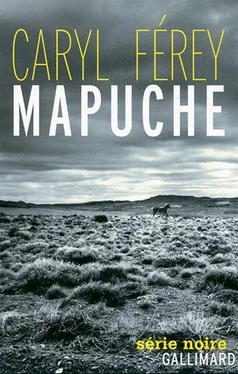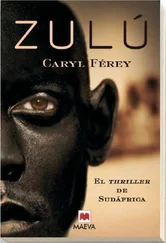Rubén comatait sur le siège arrière de l’avion de tourisme, en proie aux turbulences, à la douleur, ses chairs martyrisées comme coussin d’air. Un morse adipeux était aux commandes du Cessna, Valdès, le chef pilote de l’aérodrome d’El Tigre. Le détective l’avait trouvé dans son baraquement pourri, alignant les réussites, comme si rien n’avait bougé depuis la semaine précédente. Valdès n’avait pas de nouvelles de Del Piro mais ses grandes dents jaunies de nicotine s’étaient dévoilées devant le tas de billets déposé sur le comptoir…
— On arrive ! brailla-t-il enfin depuis le cockpit.
Le visage de Rubén ruisselait.
Mendoza, dix heures du soir. Il lui fallait un lit, un hôtel où se reposer. Le détective marchait à pas comptés sur le tarmac de l’aérodrome, le bras gauche collé au flanc comme s’il s’était cassé l’épaule. Rubén serrait les dents, dur au mal : le Glock était dans son sac, et lui tirait de la main droite…
*
La famille Torres appartenait à l’oligarchie de propriétaires terriens qui s’était partagé le pays deux siècles plus tôt. Ignacio avait grandi dans les vallées fertiles de l’Uco, fierté de l’Argentine. Il aimait sa région, magnifique, le vin qu’on y fabriquait, le pouvoir dont il avait hérité et l’argent qui le finançait.
La province de Mendoza produisait le meilleur vin du pays, pour un marché intérieur alors très demandeur. Le vin était la boisson populaire par excellence, mais Ignacio était un visionnaire. L’Argentine, qui avait prospéré en nourrissant l’Europe dévastée au sortir de la guerre, était exportatrice de ses matières premières : le vin serait le nouvel eldorado. Dès les années 70, Ignacio Torres avait compris la prédominance du capital sur le travail. Avec la libéralisation des marchés, les spéculations financières rapporteraient bientôt plus que les productions agro-pastorales et industrielles locales, plus encore si les bénéfices étaient placés à l’étranger. Encore fallait-il créer une société aux reins assez solides avant de se frotter à ces fameux marchés.
Ignacio avait profité des aléas de la dictature pour agrandir son espace vital, multipliant par trois l’étendue des terres familiales, afin de constituer le domaine de ses rêves, baptisé Solente.
Les principales exploitations viticoles de la région se concentraient autour de Luján ; Solente se situait plus au sud, hors des sentiers battus. Torres avait alors fait venir les meilleurs sommeliers d’Europe et d’Amérique pour améliorer les syrahs et les cabernets jusqu’alors consommés au tout-venant, et bâtir la réputation de la bodega . Après quoi il avait misé sur une communication intense, prospecté les marchés à l’export et les milieux influents, notamment Mondovino et la revue spécialisée qui établissait les cotes, à bon escient : le vin argentin avait vu son chiffre d’affaires exploser dans les années 90, en particulier celui de Solente, dont les bouteilles se vendaient aujourd’hui six fois plus chères qu’auparavant. Qu’importe si, faute de pouvoir payer ce qui était devenu un produit de luxe, la majorité de ses compatriotes ne buvaient plus de vin : l’exportation compensait largement la chute du marché local.
Solente. La situation géographique de la bodega était idéale, avec ses centaines d’hectares de vignes alignées au pied des Andes, et si la chapelle familiale rappelait l’architecture pinochetiste, un bâtiment ultramoderne accueillait public et marchands. Vaste hall d’exposition doté de sculptures et d’œuvres d’art contemporain, jardins de plantes exotiques, boutique climatisée vendant bouteilles et autre merchandising à l’effigie du domaine, restaurant lounge avec terrasse donnant sur la fabuleuse cordillère et ses monts enneigés : plus qu’une exploitation viticole, Solente était devenue une marque. Grâce à elle, Ignacio Torres avait amassé assez d’argent pour lancer son fils aîné dans la politique.
Accéder à la Casa Rosada : à soixante-seize ans, c’était pour lui la réalisation de toute une vie. Son fils Francisco avait l’envergure d’un président, la capacité de travail, le charisme, et lui de solides soutiens dans les milieux financiers et industriels. L’empreinte qu’il laisserait sur le pays serait irréversible : la marque Torres.
Ignacio avait certes quelques problèmes mais il ne changerait rien à ses méthodes. Comme tous les ans à cette époque, le maître du domaine était venu superviser les vendanges. Les rares nuages partis à l’assaut des Andes se délitaient le long des sommets, sous l’œil éteint du volcan Tupungato, gardien de la vallée de son enfance. Oui, il pouvait être fier de son ouvrage. Les grappes gorgées de soleil s’étendaient à perte de vue sur les coteaux, pour un cru qui s’annonçait exceptionnel. Ignacio goûta un raisin, recracha la peau, opina pour lui-même — acidité parfaite… Réfugié sous un chapeau à large bord, le vieil homme gambergeait au milieu de l’allée quand une voix le héla :
— Monsieur Torres ?
Coupé dans ses pensées, Ignacio eut un geste de surprise. Bref moment de flottement. Romero l’avait déposé au sommet de la parcelle Nord pour inspecter les vignes avant la vendange, le quad était arrêté en contrebas, il ne voyait pas Romero et un homme remontait le chemin de terre : un grand type brun vêtu de noir, qui marchait au pas lent et cadencé du légionnaire.
— Que voulez-vous ? lança Torres.
— Il faut que je vous parle, répondit l’homme en approchant.
Après dix heures de mauvais sommeil dans l’hôtel le plus proche, Rubén avait loué une berline près de l’aérodrome et filé à la bodega de Solente en se bourrant d’antalgiques. Encore dix mètres avant de rejoindre le boss.
— Si vous êtes journaliste, on a dû vous dire à l’accueil que je ne reçois que sur rendez-vous, s’irrita Ignacio. Vous voyez bien que je suis occupé.
— Oui, fit-il d’une voix lasse, j’ai appelé ce midi. On m’a dit que vous étiez au domaine pour superviser la récolte. Je ne suis pas journaliste.
Le détective s’arrêta au bout de l’allée, ruisselant de sueurs froides après sa marche forcée parmi les coteaux. Ignacio Torres avait un corps large et épaté au diapason de sa tenue de cow-boy. Ses yeux vifs viraient au vinaigre.
— Qui êtes-vous ?
— Rubén Calderón, dit-il. Je travaille pour les Grands-Mères.
Impossible de lire l’émotion derrière les Ray-Ban du propriétaire terrien.
— Qu’est-ce que vous voulez ? renvoya-t-il sèchement.
Rubén crevait de chaud sous le soleil et il n’avait pas de temps à perdre.
— La vérité sur le vol des terres de la famille Verón, dit-il à brûle-pourpoint. Septembre 76, vous vous rappelez ? Le colonel Ardiles vous a amené Gabriella, la seule héritière de ces terres, une jeune femme accompagnée de son mari, tirés des geôles clandestines de l’ESMA…
Ignacio sentit le danger : il jeta un regard en contrebas de la parcelle, aperçut le quad à mi-pente mais toujours pas cet abruti de Romero. Romero reposait quelque part entre les vignes, une balle dans le thorax, un duel qui avait tourné court.
— Personne ne viendra vous sauver, Torres, fit Rubén, devinant ses pensées. Encore moins un de vos hommes déguisés en piqueteros . C’est vous qui les avez envoyés sur la piste de Montanez, n’est-ce pas ? Avec l’aide de qui, Luque ?
Torres fit un bref panoramique sur les plantations : la bodega était trop loin pour qu’on les aperçoive.
— Je n’ai rien à vous dire, répliqua-t-il avec son autorité coutumière. Vous feriez mieux de retourner d’où vous venez avant que j’appelle la sécurité.
Читать дальше