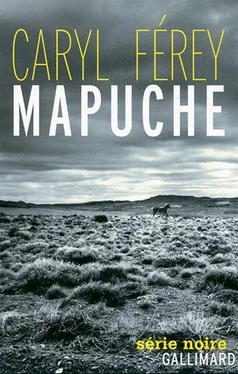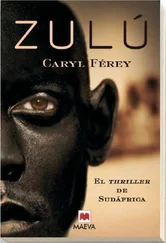Son visage peinturluré et sa voix d’outre-tombe le firent frissonner. Le Toro renifla des caillots de sang, allongé à même la terre, encore incapable de se redresser. Quant à articuler, le moindre mot lui arrachait des larmes. Il était nu comme un ver, jeté comme un paquet de linge sale au milieu d’une clairière, la bouche en charpie. Des arbres immenses ballaient au-dessus de lui, dont on devinait les cimes au jour naissant. Depuis combien de temps était-il là ? Il avait les mains liées dans le dos, ses chevilles aussi étaient entravées, des menottes qui lui sciaient méchamment la peau. Le gros homme se contorsionna et reconnut le Picador à quelques pas, nu lui aussi, gisant près d’un vieillard aux os saillant sous un corps décharné — le cardinal et sa triste figure. Bâillonnés, les prisonniers relevèrent à peine la tête. Von Wernisch semblait prier, les yeux mi-clos, recroquevillé comme pour cacher son sexe rabougri qui trempait dans les flaques. Le Picador se tenait dans une position similaire, hébété, livide. Il avait la jambe brisée, une fracture ouverte au tibia qui, à la lueur éteinte de son regard, semblait le faire souffrir atrocement.
Un chien pouilleux les observait depuis les fourrés, impassible, les pattes croisées sous son museau gris. Le Toro fit un effort pénible pour se tenir assis tant la tête lui tournait, grommela dans sa barbe ensanglantée. La petite pute lui avait brisé la mâchoire… Il lui fallut plusieurs secondes avant de retrouver pleinement ses esprits. Un froid humide lui glaçait les os. Il avait pourtant de la réserve. Où étaient les autres ? Parise, le général Ardiles ? Un bruit de chaîne sur sa droite le fit sursauter : un homme au crâne dégarni était tapi en bordure de clairière, un septuagénaire enchaîné par le cou comme un chien à un arbre… Diaz ? Le Toro croisa ses yeux de dément, et la peur inexplicable qui l’avait étreint dans la forêt lui serra les tripes. Un autre bruit l’alerta. Il se retourna vers l’araucaria : l’Indienne était en train de creuser un trou, un peu plus loin sous les branches…
Une tombe.
Jana s’échinait, tout à son ouvrage, pour ne pas penser.
Il n’y a pas de prison chez les Mapuche, que des réparations.
Les anciens quais du port de Buenos Aires avaient fait place au Waterfront, complexe ultramoderne conçu par des architectes étrangers de renom. Des bateaux de faible tonnage accostaient encore le long des entrepôts en brique, les autres bâtisses jadis désaffectées avaient été rachetées et transformées en lofts de luxe, avec jacuzzi et vue sur les bassins du port artificiel.
Rubén savait qu’il n’irait pas loin dans cet état : tousser lui tirait des larmes, les douleurs se réveillaient en sursauts furieux et son cerveau n’imprimait que des images sordides. Des joggeurs aux lunettes profilées couraient le long de la promenade. Il suivit l’allée de platanes qui menait à la digue Costanera Sur, marchant à pas comptés, l’esprit cotonneux sous l’effet des antalgiques. Il était deux heures de l’après-midi, quelques touristes anglo-saxons dans leur sempiternel short à carreaux farnientaient à la terrasse des restaurants, amollis par le malbec local. Il stoppa à hauteur de la frégate Sarmiento , le vieux bateau-école devenu musée : Isabel Campallo buvait un Perrier à la terrasse du bar lounge où ils avaient rendez-vous.
Rubén avait appelé chez elle avant de quitter l’agence, et lui avait laissé le choix. Ou elle acceptait de le voir dans un lieu public, seule, ou il racontait ce qu’il savait à Rodolfo quant au vol des enfants, preuves ADN à l’appui… Le regard errant sur les voiliers bâchés qui clapotaient dans le port, incognito sous ses grosses lunettes de soleil, la veuve cuvait son malheur au fond d’un brouillard anxiolytique. Il fallut que le détective s’assoie à la table pour qu’elle remarque sa présence. Le chignon bâclé, vieillie d’un siècle dans une robe noire, son bras droit en écharpe, stigmate d’une chute récente.
— Ma fille et mon mari sont morts, Calderón, l’accueillit-elle. Qu’est-ce que vous voulez encore ? Vous croyez que je n’ai pas assez souffert ?
Des femmes à poussette papotaient en longeant la terrasse. Rubén commanda un expresso à la serveuse qui se présentait, alluma une cigarette le temps qu’elle déguerpisse et se tourna vers l’ apropiador .
— D’abord merci d’avoir accepté ce rendez-vous, recadra-t-il. Comme je vous l’ai expliqué, tout ce que vous pourrez me dire restera entre nous. Je n’en parlerai ni au procès, ni aux flics, ni à personne. Je vais vous avouer ce que je sais et vous invite à faire de même…
La mère de Maria ne broncha pas, sur la défensive. Tout était allé de mal en pis depuis sa première irruption chez eux : elle avait perdu sa fille dans des circonstances tragiques, puis son mari. Elle n’avait plus qu’un fils devenu autiste depuis les révélations du cimetière, et ses beaux yeux pour pleurer.
— J’ai retrouvé les cadavres des parents de Maria, reprit Rubén sans animosité. Samuel et Gabriella Verón, un jeune couple chilo-argentin assassiné en septembre 1976. Le Centre d’Anthropologie légiste confirme la concordance de leur ADN avec celui de Maria Victoria et Miguel Michellini, son vrai frère… Les actes de naissance de vos enfants sont des faux, vous le saviez.
Isabel Campallo secoua la tête.
— Non.
Rubén reçut son expresso, l’œil noir.
— Écoutez, madame Campallo. Pour le moment la presse n’est pas au courant, ni les juges, mais les Grands-Mères ont un dossier à charge contre vous qui, deuil ou pas, êtes toujours sous le coup d’une condamnation comme apropiador . Sept ans de prison, c’est la peine encourue. À vous de voir si vous voulez salir votre nom, et celui de votre mari.
Un silence passa le long de la promenade où s’enlaçaient les amoureux, sous les claquements des drisses. Isabel Campallo s’arc-bouta un peu plus sur son bras bandé.
— Alors ?
— Eduardo m’a parlé des petits, un jour, dit-elle enfin. Deux enfants en bas âge. Il m’a dit qu’ils avaient été abandonnés devant un hôpital, qu’on pouvait les adopter… Je l’ai cru.
— Oui, on a trouvé Rodolfo dans un chou et Maria dans une fleur… Été 76, vous saviez ce qui se passait à l’époque, non ? la rabroua-t-il.
— La dictature militaire, oui. Ça n’empêchait malheureusement pas les gens d’abandonner leurs enfants.
— Avant d’être liquidés. Des disparus, à qui on volait leurs enfants.
— Quand on pose deux bébés dans les bras d’une femme stérile, elle veut bien croire n’importe quoi, rétorqua Isabel Campallo. Et puis, d’une manière ou d’une autre, ces enfants n’avaient plus de parents, se défendit-elle. Nous leur avons donné la possibilité d’avoir la meilleure éducation qui soit. C’est ce que nous avons fait. Toujours.
Rubén cracha la fumée de sa cigarette à la figure de la veuve.
— Vous prétendez ne rien savoir sur les conditions d’adoption de vos enfants, ni des gens qui l’ont permise ?
— Non. Je me suis tenue à la version d’Eduardo. Peut-être m’arrangeait-elle, concéda-t-elle. J’ai vécu avec.
— Mais vous n’avez jamais dit à vos enfants qu’ils avaient été adoptés.
— Non.
— Pourquoi ?
— Par commodité.
— Et lâcheté : vous deviez vous douter qu’ils avaient été arrachés à leurs parents.
— Non, répéta la mère de famille, non, je voulais les aimer, c’est tout. Vous n’êtes pas capable de comprendre ça, Calderón ?
Des larmes muettes coulaient sur les joues de l’ apropiador .
— Les aimer en cachant la vérité sur leur origine, acquiesça Rubén. Belle névrose que vous entretenez là.
Читать дальше