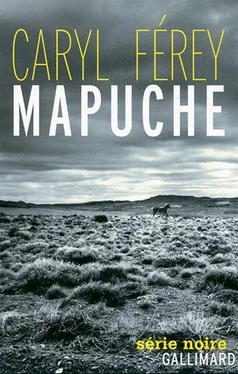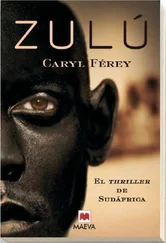Le rimmel de Miguel Michellini avait coulé sur ses paupières, qui clignèrent en voyant le soleil du soir entre les branches. Del Piro se contracta sur son fauteuil : ils l’avaient détaché .
— Putain, mais qu’est-ce que vous foutez ?! les rabroua-t-il en se contorsionnant.
— Ha, ha, ha !
Le Toro riait au visage du travesti. Le pauvre chou avait beaucoup pleuré quand il l’avait astiqué : le Picador n’avait pas daigné mettre la main à la pâte, laissant la femmelette à son compère qui, de fait, s’était régalé — sa robe de mariage était encore pleine de sang.
— Allez, ma mignonne, postillonna le Toro, viens jouer avec nous !
Ils soulevèrent le pantin et l’assirent lourdement sur la chaise. Miguel gémit de douleur, s’accrocha au rebord de la table. Ses tortionnaires lui rappelaient ces varans de Komodo qui dévoraient leur proie vivante, en meute, ces bêtes immondes dont les morsures empoisonnaient le sang de leurs victimes, dès lors condamnées. Les monstres. Ils avaient gardé sa figure intacte pour le maquiller — un travesti, c’était un peu comme une Barbie ! — et, pour rire, l’avaient barbouillé de matière fécale. Elle avait séché sur les joues creusées du gringalet, livide.
Le Toro lui souffla son haleine pleine de bière.
— Une petite partie de cartes, ça te dit, Madonna ?
Miguel sentit les larmes perler sur ses croûtes.
— Va te faire mettre, sale truie.
— Ho, ho, ho ! Tu entends ça ?! Tu l’entends, le rebelle ?!
Le Picador, dans son rôle, se contenta d’un sourire effilé. Son complice se leva, excité.
— Distribue les cartes, je reviens.
Del Piro secoua la tête, repoussa à grands gestes les moustiques qui l’assaillaient ; il n’était pas présent lors des « séances de travail », mais il avait entendu les hurlements déchirants du petit pédé. Le pilote s’attendait au pire, il ne fut pas déçu. Le Toro revint bientôt sur la terrasse, une cuvette dans ses grosses mains hilares. Pas besoin de se pencher pour voir que c’était de la merde.
Le Picador, qui avait distribué les cartes sous les yeux défaits de Miguel, recula sur sa chaise.
— De la fraîche ! s’esclaffa le Toro.
Il posa la cuvette nauséabonde sur la table de jeu, ravi de son tour. Miguel détourna le regard pour se préserver de l’odeur tandis que le gros type enfilait ses gants de vaisselle.
— Tiens-le à la chaise !
Le Picador s’empara du malheureux.
— Qu’est-ce que vous foutez, nom de Dieu ! grogna Del Piro en s’aspergeant de spray. Vous allez le bousiller !
— T’en fais pas ! On va juste le cuisiner ! Ha, ha, ha !
Miguel n’avait plus la force de résister, à peine celle de leur cracher à la figure. Il avait dit ce qu’il savait, ne comprenait pas pourquoi on le maintenait en vie, pourquoi ils s’acharnaient sur lui. Il ferma les yeux pendant qu’ils tapissaient son visage.
L’odeur d’excréments parvenait jusqu’au ponton.
— Putain, vous êtes vraiment des porcs ! commenta Del Piro sans bouger de son fauteuil.
Le Toro faisait de la sculpture in vivo , encouragé par les rires sardoniques de son acolyte.
Le pilote souffla, excédé — ces types lui fichaient la nausée —, et partit se réfugier dans la maison. Qu’ils aillent se faire foutre avec leur délire scato : il téléphonerait à Linda pendant qu’ils étaient occupés, deux minutes, le temps de la baratiner — avec un peu de chance et de talent, il réussirait à calmer sa furie érotique… Le soir tombant, moustiques et papillons de nuit s’écrasaient contre les vitres de la cuisine. La dernière vision de Gianni Del Piro fut celle de trois hommes assis autour d’une table de jeu, un travesti famélique, avec des cartes collées sur son visage couvert de merde, et deux quinquagénaires qui ricanaient.
— À toi de jouer, Madonna !
Parise appela le soir même. La fille Campallo n’avait pas dit qu’elle était enceinte quand ils avaient charcuté le trav’ enlevé avec elle à la sortie du club de tango. Calderón lui le savait. Qui d’autre que le père du marmot avait pu le renseigner ? Enceinte de trois mois, d’après les infos révélées par Eduardo Campallo le matin de son suicide. Parise avait enfin une piste. Et le hasard du calendrier faisait bien les choses…
Les Abuelas avaient monté une cellule de crise au siège de l’association. Discrétion absolue sur le but de leurs recherches, communications réduites au minimum, rendez-vous reportés sine die pour raisons de santé, le QG était en ébullition. Le document en lambeaux rapporté par Rubén rappelait les fragments grecs des présocratiques, mais les Grands-Mères avaient commencé par entrer les noms lisibles dans leur base de données. Dossiers d’hôpitaux civils et militaires, archives, procédures de justice, procès-verbaux, elles effectuèrent par équipe des dizaines de recoupements souvent hasardeux pour vérifier les pistes. Samuel et Gabriella Verón, les parents disparus, n’apparaissaient ni à la banque ADN de l’hôpital Duran ni dans leurs fichiers, ce qui laissait supposer qu’aucun membre de leurs familles n’avait réclamé leurs corps. Leurs proches avaient-ils aussi été aspirés par la machine d’État ? Si l’ADN des squelettes déterrés par Rubén correspondait avec celui de Maria et de Miguel, elles pourraient alors confier l’affaire à un juge, demander une protection pour les témoins, confondre Eduardo Campallo et sa femme comme apropiador , forcer ceux qui s’acharnaient à étouffer l’affaire à sortir du bois.
Le suicide de l’homme d’affaires, qu’elles venaient d’apprendre, leur coupait l’herbe sous le pied.
Les domestiques de la maison de Belgrano mis en congé, c’est sa femme Isabel qui avait découvert le corps au petit matin. Eduardo reposait sur le fauteuil du bureau, une balle dans la tête, l’arme encore pendante à la main. Isabel avait appelé les secours aussitôt, mais le projectile, tiré à bout touchant contre la tempe, avait emporté les lobes frontaux et la moitié du cerveau. Son mari était mort sur le coup. Il n’avait pas laissé de lettre explicative derrière lui mais les traces de poudre, les empreintes et les brûlures attestaient qu’il avait appuyé sur la détente. Le pistolet, un Browning, lui appartenant — port d’arme en règle —, le suicide laissait peu de doutes. À l’approche des élections, le coup était rude pour Francisco Torres, le maire, qui perdait là un ami et un de ses principaux piliers financiers.
Pour Rubén et les Grands-Mères, c’est leur témoin numéro Un qui disparaissait. Un de plus.
Le détective eut une longue discussion avec elles et Carlos sur la route des Andes. Le portable du pilote toujours muet, l’espoir de retrouver Miguel Michellini s’amenuisait. La mort de Campallo les obligeait à réviser leur plan de bataille, mais un nouveau personnage venait de réapparaître : Franco Diaz.
Les Grands-Mères avaient mené des recherches d’après le nom et la photo du passeport envoyé par Anita Barragan. L’homme de Colonia figurait parmi leurs fiches, qu’Elena avait basculées sur le BlackBerry de son fils.
Franco Diaz, né le 08/11/1941 à Córdoba. Formation militaire au Panamá (1961/1964), sert à Santa Cruz, Mendoza, puis Buenos Aires. Intègre le SIDE, les services de renseignements argentins, en avril 1979. Trou noir jusqu’en 1982 et la guerre des Malouines : officier de liaison dans une unité héliportée, Diaz est décoré — son commando avait pris possession de l’île en capturant la poignée d’Anglais endormis qui tenaient la place. Témoigne au procès des généraux en 1986 à la décharge du général Bignone, un des principaux responsables du fiasco des Malouines, soupçonné par ailleurs d’avoir détruit les archives des disparus avant de quitter le pouvoir. Émigré en Uruguay à la fin des années 80, retraité, Franco Diaz jouit d’une pension de l’armée et n’a plus jamais fait parler de lui.
Читать дальше