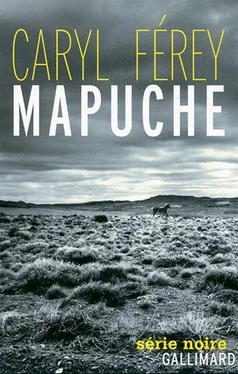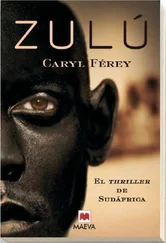— C’est quoi, ça ?!
Ils venaient de découvrir le petit papier dissimulé dans le mur : mon trésor.
Daniel Calderón, matricule 563, n’avait pas peur de mourir : il savait pourquoi il était là. Non seulement il refusait de parler, mais en écrivant un poème il avait enfreint le règlement. Il défiait l’autorité, gravement. En plus du traitement habituel, des coups et de la picana , ils décidèrent alors de l’affamer.
Les tortionnaires n’étaient pas tous des sadiques ou des violeurs patentés, plutôt des brutes ordinaires à qui on avait lâché la bride ; el Turco serait leur marionnette. Des jours passèrent, d’autres encore. Affaibli, « le Poète », comme ils l’appelaient avec sarcasme, ne tiendrait plus longtemps. J’avais connu cette faim obsédante, dans la cage à lion où ils m’avaient gardé allongé pendant des jours. Le plus dur était l’heure de la soupe, quand le cliquetis des cuillères vous mâchait l’estomac et vous faisait monter les larmes aux yeux. El Turco et les autres en rajoutaient, le narguaient par le loquet, riaient, imbéciles et repus. Enfin survint le grand jour, celui que tout le pays attendait. 25 juin 1978. Les gardiens, les officiers interrogateurs, tout le monde ne parlait plus que du match à venir : l’équipe de Menotti allait la gagner, cette putain de finale. On les entendait brailler depuis la salle de repos où ils avaient installé la télé. Fin du régime forcé ou offrande aux dieux du football, on servit ce soir-là une écuelle de « tumba » au Poète. Les gardiens, eux, s’égosillaient : un but partout à la fin du temps réglementaire, Argentine et Pays-Bas joueraient les prolongations. Profitant de la pause, el Turco et sa bande firent irruption dans la cellule de papa : ils virent l’écuelle vide, astiquée de fond en comble, et se mirent à rire comme des hyènes. J’entendais leurs commentaires dans le couloir, mais je ne comprenais pas ce qui les rendait si goguenards.
La télé hurlait quand une clameur formidable accueillit le troisième but argentin. Les gardiens exultaient d’une joie taurine : « Argentina ! Argentina ! » La rumeur de la victoire enflait depuis l’avenue. Le stade de River Plate où se jouait la finale était tout proche de l’ESMA : les gardiens dans la salle de télé criaient trop pour l’entendre, mais ce bruit sourd qui provenait de la cellule voisine, ce bruit compact, je l’identifiais clairement : c’était la tête de papa contre le mur mitoyen.
L’homme qui se brisait le crâne et geignait comme un chiot, c’était lui, petite sœur.
Ils sont venus me voir peu après, el Turco et les autres. Ils avaient attendu que le Poète finisse son ragoût immonde pour lui montrer ce qu’ils cachaient dans leur dos, et qu’ils exhibaient maintenant devant ma figure exsangue : ta tête, petite sœur. Ta tête d’enfant qu’ils brandissaient comme un trophée. Les ogres avaient laissé tes yeux noisette ouverts : on y lisait encore l’instant de stupéfaction qui avait traversé ton esprit au moment de te décapiter.
Mourir ou devenir fou : Daniel Calderón avait choisi de mourir. D’ailleurs, sa tête ne résonnait plus contre le mur de ma geôle. Le Poète était mort par indigestion du monde, et toi en chair bouillie, qu’ el Turco et les autres lui avaient fait ingurgiter, mêlée à la « tumba » …
Non, la cruauté des hommes n’a pas de limites.
Ils m’ont libéré deux jours plus tard, au milieu de la liesse nationale, pour que je raconte votre histoire. Mais je ne dirai rien, petite sœur : jamais. Jamais qu’à toi… Mon petit coquelicot.
*
Jana referma le cahier d’écolier, les yeux fixes, mâchant ses petits caillots de haine. Non : la cruauté des hommes n’avait pas de limites…
Les étoiles dégringolaient sur la roche embrasée, mais elle ne distinguait plus les couleurs, les oiseaux planant depuis les pics enneigés, les teintes du désert au couchant. Elle ne voyait plus que cette pauvre gamine et son frère de quinze ans dans les geôles putrides de l’ESMA, tout cet amour décapité, qui lui tiraient des larmes froides. Elle serra le cahier maudit où dormaient ses cauchemars, blême. Mourir ou devenir fou : Rubén avait survécu. Seul.
Une onde bleu pétrole délavait le ciel quand la Mapuche releva la tête. Il revenait justement vers leur campement de fortune, quelques branches rabougries dans les bras. Jana ravala la rage qui lui cassait le cœur et se leva à son approche.
— Tu as trouvé ce que tu cherchais ? lui lança-t-elle.
Le visage de Rubén était pâle sous la lune. Il jeta ses maigres branches sur les pierres.
— Non…
— Moi si, dit-elle.
Jana ôta le débardeur qui moulait son torse, l’abandonna sur le sable et lui fit face. Ses seins rachitiques pointèrent, deux petits monstres à la lumière des astres. Rubén ne ressentit aucune pitié devant le corps amputé de l’Indienne : sa beauté malheureuse l’éblouissait.
Jana l’enlaça la première, pressa sa poitrine contre lui et l’embrassa. Elle n’avait pas peur des winka qui avaient tenté de les détruire. Les Mapuche avaient résisté aux Incas, aux conquistadors, à l’armée régulière argentine, aux estancieros et aux coupeurs d’oreilles payés à la tâche, aux carabiniers, aux élites politiques et financières qui avaient saigné le pays : elle était une descendante de survivants. Leurs pieds dansèrent un moment sur le sable, Jana l’embrassait, l’embrassait encore.
— Viens, dit-elle en se détachant, viens…
Leurs vêtements disparurent, envolés, leur pudeur, le passé, le futur, ce qu’ils vivraient ensemble ou non, la solitude éternelle et les mots jamais dits : ils firent l’amour en tremblant, debout, se tenant par les yeux comme s’ils pouvaient se perdre, s’encastrèrent à s’en faire mal pour conjurer la mort qui les étreignait, et jouirent ensemble, comme des démons.
Elsa Calderón comptait parmi les cent soixante-douze enfants assassinés durant le Processus.
Sans nouvelles de sa famille, Elena avait rejoint les Mères de la place de Mai deux mois avant la fameuse Coupe du Monde. De par sa connaissance de l’ennemi, Elena Calderón était vite devenue une des principales têtes pensantes de l’Association de défense des Droits de l’Homme. C’est à elles que les militaires s’attaquaient en priorité. Une première rafle avait eu lieu après l’infiltration d’Astiz, qui s’était fait passer pour un frère de disparu, quand douze personnes avaient été enlevées à la sortie de l’église Santa Cruz, parmi lesquelles la première présidente et deux religieuses françaises. Fin 1977. La junte avait fait publier un faux document pour incriminer les Montoneros , un photomontage assez grossier qui avait fait le tour du monde, mais le leurre n’avait pas pris. Des voix s’élevaient. La communauté internationale s’en mêlait. L’émoi suscité par la disparition des premières Mères menaçant de gâcher la fête du football, on avait décidé d’utiliser un procédé plus subtil pour abattre ces Folles, qui osaient défier le pouvoir. Les menaces s’avérant sans effet, les répresseurs avaient ainsi imaginé un coup à plusieurs bandes qui les toucherait de plein fouet, en particulier Elena Calderón.
Les enlèvements, la mise en détention illégale et la torture systématique étaient une structure parallèle de coercition bureaucratique et hiérarchique efficace, apte à semer une terreur sans précédent dans la population ; le but était aussi de faire souffrir l’imagination des vivants. Des survivants. Rubén savait que la mise en scène de l’exécution d’Elsa et le suicide du poète-cannibale n’avaient pu fermenter dans l’esprit des geôliers. El Turco et ses sbires étaient de simples brutes, ignares et obéissantes. En le libérant, les instigateurs de cette machination comptaient faire de lui leur colporteur de douleur, le témoin rescapé qui raconterait à sa Folle de mère comment ses chers disparus étaient morts, sûrs que la vérité la tuerait, comme elle avait anéanti son mari.
Читать дальше