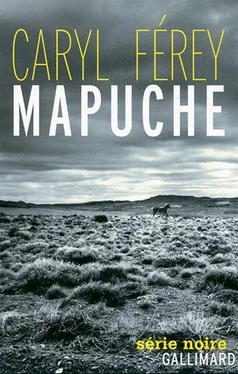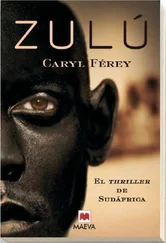— Dis-moi ce que tu sais et je te refile ta dose. C’est toi qui as engagé Calderón ?
Jo se sentait mourir. Il secoua la tête, en apnée. Il s’étouffait, pour de bon.
— Oui…
— Où il est ?
— Je… sais pas.
Le géant fouilla ses poches sans qu’il puisse réagir, trouva un petit portefeuille et la clé d’un hôtel, le « Majestic », dans le quartier de Belgrano. Bizarre. D’après ses infos Prat habitait Buenos Aires, et les papiers indiquaient une adresse à Palermo Hollywood.
— Qu’est-ce que tu fous à l’hôtel ? Hein ? Pourquoi tu ne dors pas chez toi ?
Parise agita le précieux tube sous les yeux vitreux du chanteur. Jo avait besoin du médicament, d’urgence : il agrippa le bras de l’homme qui, le voyant cramoisi et incapable d’articuler, consentit à coller la Ventoline entre ses lèvres. Jo aspira une goulée salvatrice, qui le fit sortir des abysses, mais l’homme retira aussitôt le tube de ses mains tremblantes.
— Encore, chuinta Jo. Il m’en faut… encore…
Ses poumons sifflaient comme une locomotive, il tenait à peine debout, pantin pathétique glissant sur le tapis d’épines. Parise gambergea un instant sous les branches : Calderón n’avait plus mis les pieds dans son agence, la fille qui vivait avec le trav’ avait disparu de la circulation et la surveillance des locaux des Grands-Mères ne donnait rien. Le détective avait dû trouver une planque pour son témoin, d’où il pourrait rayonner sans attirer l’attention.
— Tu sais où est Calderón, dit-il.
Jo ne répondit pas, implorant, tandis que l’autre le tenait debout à bout de bras.
— C’est lui qui squatte chez toi ? poursuivit Parise. C’est pour ça que tu es à l’hôtel ?
En proie à la panique, Jo Prat opina. Il tendit la main vers l’inhalateur, sans forces, bientôt sans air. Parise sourit sous l’arbre du parc qui les cachait. Les autres attendaient près des grilles, dans le van.
— Merci pour l’info, sourit-il à la nuit.
Parise évapora la Ventoline vers les branches et regarda l’homme s’étouffer, inexorablement, sur le tapis de mousse…
*
Buenos Aires recomptait ses tours au milieu du brouillard de pollution quand la Hyundai s’englua dans le trafic autoroutier. Sept heures du matin aux abords de la capitale. Fumées noires crachées des pots d’échappement, voitures rafistolées pétaradantes, trucks américains aux chromes rutilants, Rubén et Jana traversèrent des cités de béton aux linges pendus sur la crasse avant d’atteindre Rivadavia, l’une des plus longues avenues au monde — quarante mille numéros.
Ils arrivèrent à l’heure où les cartoneros rentraient chez eux.
Raúl Sanz les attendait au Centre d’Anthropologie légiste. L’EAAF (l’ Equipo Argentino de Antropologia Forense ) avait été créé en 1984 sous la direction de Clyde Snow, anthropologue et médecin légiste nord-américain, qui avait proposé son savoir et formé ceux qui deviendraient ses successeurs. L’organisme, indépendant, travaillait dans plus de quarante pays avec différentes institutions, gouvernementales ou non. Sous la houlette de Raúl Sanz, Rubén avait appris la balistique, la génétique, l’archéologie, l’exhumation et l’identification des corps, la localisation des fosses et la reconstitution des faits d’après la position des cadavres, des objets trouvés sur la scène de crime, les vêtements, les fractures… Raúl, quadragénaire toujours tiré à quatre épingles, fit le baise-main à Jana avant de porter l’accolade à son ami.
— On se demandait si vous alliez arriver, dit-il en les entraînant dans son antre.
— Nous aussi, commenta Jana.
Raúl jeta un œil interrogatif à Rubén, qui lui fit signe de laisser tomber. Il déposa le sac militaire sur le bureau de l’anthropologue.
— Un vrai petit Père Noël, nota ce dernier en découvrant le contenu.
Les crânes n’avaient pas trop souffert malgré les péripéties du voyage. Raúl Sanz les empoigna comme des chiots dans leur panier. Résultats ADN disponibles d’ici vingt-quatre heures, assura-t-il bientôt. Ils échangèrent quelques mots explicatifs devant un café noir, saluèrent son équipe au grand complet, et se quittèrent dans le hall du Centre d’Anthropologie. Jana et Rubén avaient rendez-vous à dix heures au siège des Abuelas avec les Grands-Mères et Carlos : ça leur laissait le temps de passer à l’appartement, de prendre une douche et de nourrir Ledzep…
— Le pauvre matou doit reluquer sa gamelle en se demandant ce qu’on fout, remarqua Jana sur la route.
— Deux ou trois kilos de moins, ça ne lui fera pas de mal, commenta Rubén : comme à son maître.
— Vilain petit puma, tout le monde n’a pas la chance d’avoir ton poil.
Elle passa les mains dans ses cheveux, reçut son sourire fatigué. Jana bâilla malgré elle. Hâte de rentrer.
Hormis le kiosco qui ouvrait à l’angle, les magasins de la rue Gurruchaga étaient encore fermés à cette heure. Ils firent deux fois le tour du cuadra avant de garer la voiture et s’engouffrèrent dans le hall d’immeuble.
L’atmosphère feutrée du loft avait quelque chose de décalé, comme s’ils étaient partis depuis un siècle. Ils déposèrent les sacs dans l’entrée. Rubén se dirigea vers la fenêtre aux rideaux tirés, ne vit que des véhicules sans chauffeur garés le long du trottoir.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Rien… rien.
La fatigue lui jouait des tours. Ou le stress. Jana déposa un baiser furtif sur ses lèvres, pour le détendre.
— Je vais prendre une douche.
Elle prit son sac dans l’entrée, se demanda où était fourré Ledzep — le vieux chat devait roupiller dans un placard ; les stores étaient tirés dans la chambre de Jo Prat, les roses flétries par la chaleur. Jana posa le .38 sur la table de nuit, tria les vêtements propres. Un miaulement se fit entendre, sous le lit. Elle se pencha et aperçut deux yeux ronds qui luisaient.
— Qu’est-ce que tu fais là, mon vieux ?
Pour toute réponse, Ledzep lui cracha au visage.
Rubén grimpait l’escalier de verre quand Anita appela sur son portable. Au son de sa voix, le détective sentit tout de suite que les nouvelles étaient mauvaises. On venait de trouver Jo Prat dans le parc de Lezama, mort : c’est un bénévole du festival qui avait découvert son corps inanimé et prévenu les secours. Une crise d’asthme d’après les premiers constats — un tube de Ventoline vide traînait près de lui.
— Merde.
— Tu es où ? s’inquiéta Anita.
— Chez lui, répondit Rubén.
La lampe marocaine tamisait la lumière de la chambre à coucher : Jana s’apprêtait à se déshabiller mais quelque chose l’arrêta. Elle huma l’air de la pièce. Les objets étaient familiers, l’atmosphère soudain irrespirable… La Mapuche recula : il y avait quelqu’un dans l’appartement . L’odeur de sueur imprégnait les murs, de plus en plus forte. Elle empoigna le revolver chargé posé près du vase où noircissaient les fleurs mortes, sentit une présence sur sa gauche.
— Tu bouges ou tu cries, je te…
Jana fit feu sans viser : la balle du .38 expulsa une pluie de plâtre en percutant le mur mais rata sa cible. Elle n’eut pas le temps d’appuyer de nouveau sur la détente : deux harpons la mordirent au cou.
— La concha de tu hermana [10] « La chatte de ta sœur. »
! siffla le Toro, la main plaquée sur l’oreille.
Les muscles tétanisés par le choc électrique, Jana s’effondra contre la table de nuit. Le Picador jaillit à son tour de la salle de bains, en sueur dans son costume trois-pièces. Le sang gouttait sur la veste à épaulettes du Toro qui grimaçait, le lobe de l’oreille arraché. La fille gisait près du lit, en proie aux convulsions. Le Picador déposa sa mallette à terre, saisit la seringue prête à l’usage et jeta le garrot dans les mains du gros homme.
Читать дальше