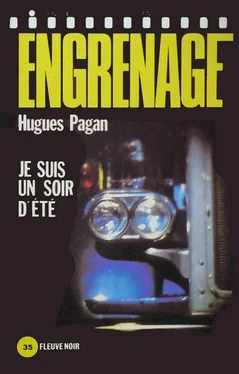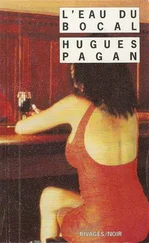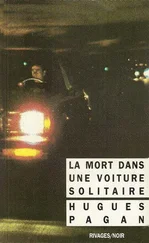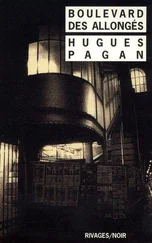— Stoppez au niveau du buisson rabougri, à gauche. Coupez le contact et attendez.
— Vous êtes dingues, répète la voix.
Le Toyota s’arrête.
La Mercedes brûle encore, mais à petits coups. Il n’y a plus de flammes, rien que des hoquets de fumée plus ou moins noire qui s’enroulent sur eux-mêmes et montent presque à regret. La gosse prend son Uzi.
— Je viens avec toi.
Elle a la voix dure.
Surfeur secoue la tête. Ce que je vois de ses yeux est dur aussi. Le radar. Je passe la lanière du portable à l’épaule, je glisse un. 45 plein dans la ceinture, derrière, sous la chemise, je fais des gestes machinaux, des gestes habituels, et Surfeur secoue à nouveau la tête. La sueur me pique la figure, sous le tissu.
Le temps d’arriver à défilement non loin du Toyota, je suis trempé de la tête aux pieds. Le ciel blanc tourne au gris, ou c’est l’éblouissement.
Kayser a ouvert la portière.
Il a les deux mains sur le volant, les poignets cassés et il fume en fixant les deux silhouettes en treillis qui avancent sur le chemin. Au dernier moment, il met pied à terre d’un seul mouvement souple, presque lymphatique. Il porte des espadrilles, un vieux pantalon de treillis décoloré et un maillot de corps douteux.
— Éteignez la Mercedes et passez-la à la presse.
Ses yeux bleus, couleur de porcelaine, se posent sur nous. Il crache la cigarette à ses pieds, glisse les mains dans la ceinture.
— Pas assez de monde pour ça.
— Écartez-vous, Kayser…
Il obtempère, sans hâte. Il recule jusqu’au buisson, il me laisse tout le champ qu’il faut pour donner un coup d’œil dans le Toyota. Il y a un automatique entre les coussins, un 9 mm camus. Je le ramasse et je le fourre dans la poche, sur la cuisse droite. Il y a une grosse cibi allumée, mais aussi et surtout un radiotéléphone dont la grande antenne remue encore derrière, fixée au garde-boue.
— Éteignez la Mercedes, Kayser. Rentrez-la et passez-la à la presse. (Je me retourne.) Appelez votre contact. Annoncez-lui ce qui vient de se produire. Passez-lui que le camion et son contenu se trouvent sous le feu de trois tubes et qu’un des servants au moins en touche assez pour flanquer sa roquette dedans sept fois sur six. Autre chose… L’opération continue, dans le bahut.
— Pas d’opération. Vous êtes dingue.
Je lui lance le boîtier. Surfeur l’a réalisé sur le modèle des boîtiers de commande à infrarouge des téléviseurs modernes, sauf qu’il n’y a qu’une grosse touche à la place du clavier.
— Au cas où vous auriez pensé aux snipers, Kayser. Les trois systèmes de mise à feu sont radiocommandés. Vous pouvez parvenir à descendre l’un d’entre nous. Ça n’empêcherait pas les autres d’envoyer la purée.
Kayser retourne l’objet.
— Trois tubes, il traîne. L’hélico, c’était ça.
— Pas d’hélico.
Il secoue un peu la tête.
Il a un regard dolent. Il a intercepté le boîtier d’une main. L’autre est toujours dans la ceinture. Il hoche la tête et cueille de la langue une goutte de sueur sur la lèvre craquelée.
— Appuyez, Kayser.
— Il y avait cinq hommes dans la voiture.
— On les pleurera plus tard…
Il me prend presque à contre-pied : il me renvoie le boîtier presque sans bouger, le visage impassible ; j’ai l’impression qu’il se tasse un peu pour bondir. Il a renvoyé plutôt bas. Je plie les genoux, je récupère du gauche et en même temps, le .45 fleurit dans ma main droite. Kayser stoppe sur le bout des orteils, comme s’il venait de percuter une paroi de verre blindé.
— Vous avez choisi le boîtier plutôt que le pistolet, il observe d’une voix traînante. Gaucher… Cinq hommes. Il ne reste plus grand monde.
— Appelez vos autorités, Kayser. Annoncez-leur la bonne nouvelle.
Il a un rire en toile émeri. La sueur lui coule entre les sourcils, le long des maxillaires. Il cherche une cigarette dans une poche. Je lui laisse le temps, mais pas trop. Myriam est silencieuse, juchée sur un bout de remblai. J’agite doucement la gueule du .45.
Kayser me passe devant, il s’assoit et se penche sur le téléphone. Avant d’appeler, il se tourne vers moi :
— Quand les autres ont appelé, j’ai failli y aller moi-même, il sourit à blanc. Ca tient à un rien, des fois.
— À un rien. Appelez.
Il pianote sur le clavier, de ses doigts boudinés. Il annonce la bonne nouvelle, il résume d’autorité mais au bout du compte l’interlocuteur peut se faire une idée exacte de la situation. Kayser éloigne le combiné de l’oreille, on va lui passer quelqu’un d’autre, ou quelque chose dans ce goût-là. En même temps, il observe vaguement la rocaille, le ciel épais, il lape un peu de sueur au coin de la bouche.
— Vous comptez ramasser combien, ce coup-là ? il s’enquiert tranquille.
Je lui annonce le chiffre. Il tourne la tête vers l’appareil, il pianote sur le volant. Puis il replaque le combine à l’oreille et il se met à débiter des « oui » et des « non » pendant cinq bonnes minutes. À la fin, il se retourne vers nous en plaquant la paume sur le micro. Il dit :
— Ils sont disposés à traiter. Je suis pas sûr que c’est ce qu’ils font de mieux, mais ils sont d’accord pour négocier. Vous prenez ?
— Rien du tout. Ils ont deux heures à partir de maintenant pour réaliser la transaction. Dans deux heures, tout saute. Dites-leur : « deux heures ». Pas une minute de plus. Et le plus tôt sera le mieux.
Il passe, ça racle et il recommence le petit jeu des oui et des non jusqu’au moment où il fait mine de me tendre le combiné. Pas assez de câble. Je secoue la tête, négatif. Il remet la paume sur le micro, mais moins près.
— Passez-moi le numéro. On va les rappeler.
Il rend compte et me donne le numéro. Je l’envoie à Surfeur sur le portable. Surfeur va l’envoyer à Ben.
— Qu’est-ce qu’on fait ? demande Kayser.
— On raccroche et on attend.
Il raccroche.
— En deux heures, c’est pas possible de réunir tout le fric que vous demandez, il observe. (Il examine sa cigarette cabossée et il la froisse entre les doigts et la jette dehors.)
Je laisse mouler. Deux heures, c’est pas assez pour sortir autant de fric, mais c’est dix fois ce qu’il faut pour opérer un virement de compte à compte dans une tranquille petite banque à l’étranger. Ben a étudié le coup et quand il étudie un coup dans la banque, c’est pas la peine de passer après : c’est du tout bon.
— Ramassez la Mercedes, Kayser. C’est pas la peine que des curieux viennent foutre leur nez dans nos affaires.
Il palabre sur la cibi. Le reste du personnel n’est pas très chaud pour montrer le bout du nez, mais il emporte le morceau et une dépanneuse peinte en jaune ne tarde pas à quitter son hangar.
— Vous avez des extincteurs ? demande Kayser.
— Y a intérêt. C’est pas prouvé qu’on va pouvoir la bouger tout de suite.
— Noyez-la et passez-la à la presse.
— … kay.
Un voyant clignote sur le radiotéléphone.
Quand il raccroche, Kayser se passe l’index le long de l’arête de son nez busqué. Il a l’air plus que désabusé, mais il s’abstient de tout commentaire. On observe de loin les deux types qui arrosent la carcasse de la voiture à l’aide de mousse carbonique. Je me gratte à travers le tissu de la cagoule.
— Vous pensez quand même pas que vous allez vous en tirer comme ça, fait Kayser. Qu’est-ce qui me dit que vous n’allez pas tout flanquer en l’air au moment de décrocher ?
— Rien ! je ricane. Sauf que si on en avait eu envie, on aurait déjà pu tout flanquer en l’air.
— C’est quand même pas triste de prendre une bonne pincée au passage, non ?
Читать дальше