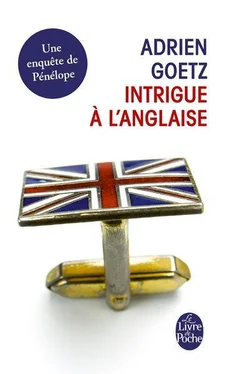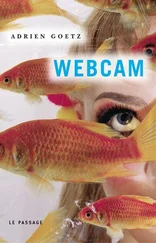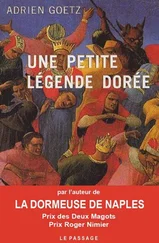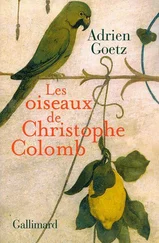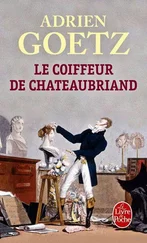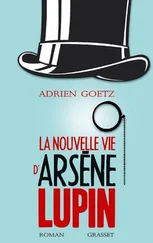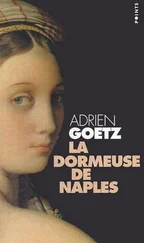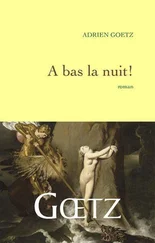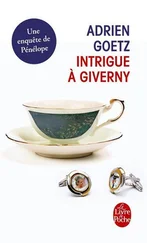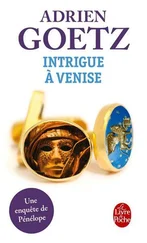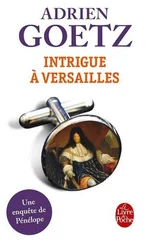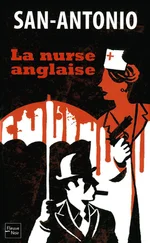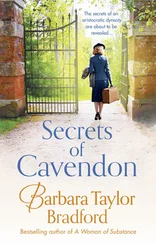Il hésite à appeler Pénélope. Il savoure, en tête à tête avec lui-même, sa découverte. Existe-t-il, ce bout de tissu — séparé des soixante-dix mètres de Bayeux, à quelle date ? par qui ? pour quelle raison ? avant ou après le passage de la Tapisserie à Paris sous Napoléon ? — qu’Édouard VIII emporte avec lui en abdiquant, se disant que, devenu duc de Windsor, il pourrait peut-être un jour en avoir besoin, qu’il tente de vendre à Hitler, ou de monnayer contre son retour, ou je ne sais quoi, ça c’est un peu moi qui invente, mais bon, il faut bien broder. Ces toiles sacrées existent encore transformées en coussins dans les années soixante. On en perd la trace après la mort du duc. Elles resurgissent la semaine dernière. Et on se les arrache à nouveau.
Il pousse la porte de sa chambre, déplie l’accordéon de cartes postales qui reproduit l’intégralité de la Tapisserie et le punaise au mur. Le voilà cerné. Il regarde, il mémorise. Il s’allonge sur son lit, entouré par les petits personnages de 1066.
Et si je demandais son avis à Marc ? Il n’a pas donné signe de vie depuis l’accident de Diana. Lui, il doit être effondré. Il perd ses « clients » — il sait peut-être où se trouve la marchandise, les trois coussins, dont il est le seul à posséder un relevé précis. Wandrille en conserve un souvenir trop flou pour dire si son dessin correspond à ce que montre la photographie des Windsor. Marc sait peut-être pourquoi ces trois scènes ont une telle importance.
Si ça se trouve, il est en danger. Wandrille se relève, fait tomber son aiguille et son fil de laine bleu nuit. C'est amusant tout ça, mais ce n’est pas qu’un jeu pour grand garçon. Il fait le numéro de la rue de la Maîtrise. Pénélope ne répond pas.
17.
Face à face au Louvre
Vendredi 5 septembre 1997
Les yeux de Pénélope errent sur la petite broderie, un fin travail d’aiguille, des caractères bâton, en coton bleu, ton sur ton — sur la poitrine, au bon endroit, selon les règles de l’art, « à la hauteur du coup de poignard », pense-t-elle avec un frisson.
Elle se recule un peu. Le directeur du Louvre est un des hommes les plus chic de Paris. Il fait broder ses initiales sur ses chemises, mais avec une certaine discrétion, il faut qu’il enlève sa veste pour que l’on puisse les voir. Et cet homme enlève rarement sa veste. Le col est élimé, juste ce qu’il faut, un chef-d’œuvre de haute chemiserie qu’il pourra bientôt offrir à sa consœur directrice du Palais Galliera, le musée de la mode et du costume. La cravate est un peu quelconque, mais la cravate, c’est le parangon de la fausse élégance, le vrai dandysme, c’est la chemise, la cravate doit s’effacer. Il parle :
« Je suis effondré. Dites-moi si Solange peut s’en tirer, et dites-moi aussi tout ce que vous avez appris sur Vivant Denon et Bayeux.
— Tout était ici, monsieur le directeur, à la bibliothèque du Louvre et à la bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques-Doucet de la Sorbonne, j’ai tout trouvé en une heure ce matin.
— Racontez-moi, n’épargnez aucun détail ; tout est suspect.
— Dominique-Vivant Denon, l’œil de Napoléon comme vous dites, a eu l’idée de faire venir, pour une exposition temporaire, la Tapisserie à Paris. Il l’a fait dresser dans la galerie d’Apollon, au cœur du Musée, afin de convaincre, dit-il dans une lettre, “les vrais amis de la gloire nationale” de la possibilité technique d’une invasion de la perfide Albion. Mieux encore, il commande à un savant italien bien connu à l’époque, le conservateur des Antiquités du Musée, Ennio Quirino Visconti, un livret explicatif, vendu 12 francs, commentant la Tapisserie. J’ai même retrouvé la lettre de Denon aux futurs maréchaux Soult et Davout, demandant de distribuer cette plaquette aux officiers de leurs divisions pour qu’ils en donnent connaissance à leurs soldats.
— Il s’agit bien d’une opération de propagande, d’intoxication. Vous voyez comme il ne néglige rien, il pense à tout, il est admirable. Et cette plaquette, elle est illustrée ?
— Oui, mais sans doute dans la précipitation. Denon avait fait reproduire sept planches qui avaient déjà servi au premier grand texte consacré à la Tapisserie, publié en 1729 et en 1733, par Antoine Lancelot dans les Mémoires de littérature tirés des Registres de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres . Selon Brown, le meilleur historien de la Tapisserie… »
Pénélope est trop précise, elle récite ses fiches ; le directeur lance :
« Le meilleur historien de la Tapisserie, avec Solange Fulgence, ne l’oubliez pas ! On me dit qu’elle va mieux.
— Selon Brown, poursuit Pénélope qui n’écoute rien, Antoine Lancelot se contentait de reproduire une copie en couleurs trouvée dans les papiers de Nicolas-Joseph Foucault, ancien intendant de Caen. Il n’avait peut-être même pas vu de ses yeux l’original. D’où de nombreuses différences entre la Tapisserie et ces gravures publiées sous l’Empire. En réalité personne n’avait directement dessiné, ni même vu, cette fameuse Tapisserie depuis belle lurette. Denon devait avoir sur son bureau les textes de Lancelot et les deux premiers volumes, 1729 et 1730, des Monuments de la Monarchie française de Montfaucon, quand il a décidé de faire venir la Tapisserie de Bayeux à Paris. C'était toute la documentation qui existait en son temps sur la “Telle du Conquest”, qui se trouvait dans un coffre au trésor de la cathédrale et dont toute l’Europe, à l’exception de quelques érudits originaux, ignorait l’existence. Originaux, car il fallait l’être pour s’intéresser, en pleine vogue des Grecs et des Romains, à ces siècles boueux du Moyen Âge. Denon, parce qu’il est politique, et pas du tout par goût de l’art du XI esiècle, demande qu’on achemine la caisse dans son bureau de Paris, le bureau de directeur du Louvre… Il la déroule, l’admire et décide de la montrer. Cela vous va, monsieur le président-directeur ? C'est le début de l’histoire officielle de notre broderie…
— Ou alors, il constate qu’elle est mangée des mites et décide de faire rebroder en Égypte une Tapisserie plus conforme, plus politique, inspirée de l’originale abîmée, ou peut-être même égarée dans la tourmente révolutionnaire. Car vous n’avez aucune trace de cette arrivée de la caisse, comme vous dites, à Paris.
— Vous y tenez. La Tapisserie brodée en Égypte. Ce n’est pas bien de se moquer d’une honnête chercheuse comme moi.
— N’en parlons plus, vous y repenserez. »
Le directeur se lève pour fermer la fenêtre. Une voiture de police passait sur le quai du Louvre.
« J’oubliais de vous demander à nouveau des nouvelles de la pauvre Solange Fulgence. Pardon d’insister. J’ai eu sa secrétaire au téléphone, conclut le Chéops du Louvre, le pharaon de la dernière pyramide, l’œil rieur. Solange n’est pas sortie du coma ; dire qu’elle était enchantée de votre nomination, depuis le temps qu’elle attendait une collaboratrice. Comment a-t-on pu cambrioler sa chambre d’hôpital ? C'est invraisemblable, racontez-moi, on ne m’a rien dit. Je vais appeler le ministre de l’Intérieur si ça continue.
— Je crois que l’on entre un peu comme on veut dans les hôpitaux, surtout par l’accès des urgences. Avec les touristes, les malheureux médecins et infirmiers sont sur la brèche toute la journée. Il suffit d’une canne blanche et de lunettes noires, de murmurer que l’on a rendez-vous. Personne ne se souvient de celui qui est entré. Il savait où était la chambre, il n’a pas hésité longtemps. L'opération, si je puis dire, a duré moins de cinq minutes. Solange Fulgence n’a pas crié, mais quand l’infirmière de l’étage, qui venait de sortir avec une feuille de résultats à transmettre au médecin, est revenue dans la chambre, presque immédiatement, pour rechercher son stylo, elle l’a trouvée au pied du lit, les appareils de perfusion renversés. Surtout, les deux ou trois dossiers qu’elle avait auprès d’elle, ceux qui étaient dans son cartable au moment où elle quittait son bureau, lors de l’agression, étaient renversés, avec des pages dans tous les sens.
Читать дальше