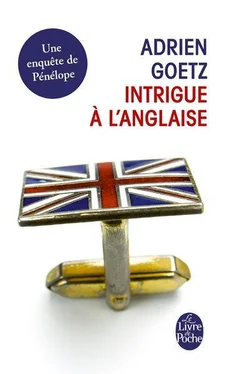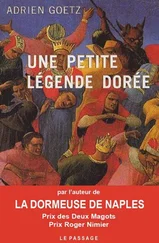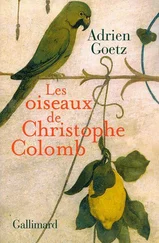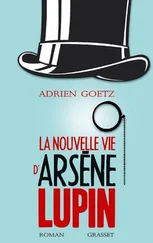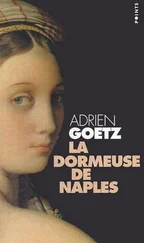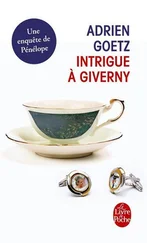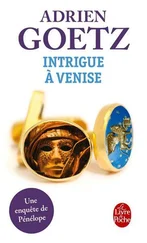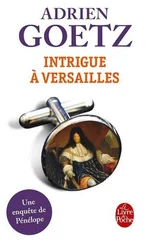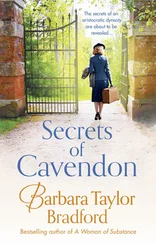Paris, jeudi 4 septembre 1997
« Dans son nid d’aigle de Berchtesgaden, Adolf Hitler ne sait pas comment s’habiller. Comment reçoit-on un ancien roi ? L'homme le plus élégant du monde ? Quand on est à la montagne et qu’il vient en visite secrète ? En uniforme. Au salut militaire, il sera obligé de répondre par le même salut, la main levée. Une image fondatrice de l’Europe nouvelle. Au second plan, la duchesse. La photo d’époque est en noir et blanc : la couleur de sa robe devait déjà être celle de ses yeux, le bleu Wallis. »
Wandrille est assez content de son début. Il est assez content de tout, de sa gueule, du compte en banque de son père, de son appartement place des Vosges, de son nouvel ordinateur portable, de sa chronique sur la télévision pour ce nouveau journal branché, à écrire chaque soir, un billet qui soulage sa conscience quand il s’installe pour huit heures d’affilée devant son poste. Il s’est battu pour obtenir sa « chronique », cette misérable « chandelle » de rien du tout, une petite colonne en haut de laquelle trône son effigie, comme le Napoléon de la place Vendôme — et qui est en train de lui faire une jolie réputation dans le monde et la ville.
Il est content aussi de la trentaine de livres qu’il vient d’acheter, toute la documentation sur « son » sujet — si elle croit qu’il passe son temps à la piscine, ou à se regarder en souriant dans la glace, elle va être surprise, lady Pénélope. Tout est empilé dans la grande pièce, qu’il appelle parfois le salon, sur la table qui ne sert plus guère aux dîners d’amis, où il s’assied, conscient de son éminent rôle social, pour écrire.
Son imprimante a rendu son âme noire au diable, il ne peut pas vraiment juger du résultat. Sa première phrase surtout est assez bonne. Ajouter, peut-être « en caleçon », cela donnerait : « Dans son nid d’aigle de Berchtesgaden, Adolf Hitler, en caleçon, ne sait pas comment s’habiller. » Non, ce serait trop. Trop facile. Cela risque de lui donner un côté Chaplin sympathique. Et Wandrille efface les mots qu’il vient d’écrire. Paragraphe suivant.
Il a débranché son téléphone, éteint son portable, glissé deux glaçons dans un verre de Lagavulin. Il aime bien ce whisky un peu tourbé, un goût de thé fumé bien fort.
Après l’entrevue secrète de 1937, Hitler avait son plan : conquérir l’Angleterre, déposer le roi et la Queen cookie (le délicieux surnom de la future grosse reine mère du temps où elle était encore la duchesse d’York, embarrassée de son empoté de mari), rétablir sur le trône Édouard VIII avec son Américaine, séduire les Anglais et les Yankees. Calmer le jeu. Gouverner l’Angleterre avec un couple de mannequins snobs et populaires. Faire tourner à plein régime les camps d’extermination. Tout était prêt. Impossible d’écrire ça tel quel, mais le lecteur doit le comprendre.
Wandrille dispose d’un épais dossier de fiches et d’articles, des centaines de photos du duc et de la duchesse, tous les livres écrits sur eux, depuis l’autobiographie châtrée intitulée Histoire d’un roi jusqu’aux tissus d’ordures les plus putrides — insistant sur la formation initiale de la future duchesse dans les bordels de Shanghai et autres détails parfaitement invérifiables.
Parmi les photos, le mariage au château de Candé, dans une France de conte de fées, la lune de miel dans les îles de la côte dalmate, le duc jeune homme, avant son mariage, avec les mineurs du pays de Galles, une photo floue prise à Monte-Carlo et trouvée, sans mention de provenance, sur Internet, Wandrille puise un peu au hasard, pour alimenter chacun de ses chapitres. Il écrit toujours avec quelques photos sous les yeux, pour donner à son récit une plus grande authenticité, comme s’il était un témoin oculaire. Il puise dans une boîte à chaussures, cette fois, une image archi-connue qui le retient un peu plus. Il sent que la page suivante va éclore. Il se rassied au clavier.
Il installe l’image devant lui, à la place d’honneur, sur son bureau : la photo quasi officielle du couple, dans les années soixante, à Paris, dans la maison du Bois de Boulogne, posant sur le canapé de leur salon au temps béni de la Café-Society. Quasi officielle, parce qu’ils ont accroché derrière eux une sorte de couverture brodée aux armes d’Angleterre — avec le lambel blanc, cette traverse horizontale à trois pendants verticaux, caractéristique des princes de Galles, qui figure depuis le Moyen Âge sur les armoiries de l’héritier du trône. Sur la série de photos qui montre la maison, ce riche tissu brodé sert de dessus-de-lit dans la chambre du duc, qui ne manquait pas d’humour. Mais cette fois, sur la photo posée dans le salon, ils l’ont accroché pour faire un fond.
Le duce britannique sourit, aucune ride car le cliché a été retouché à sa demande, la duchesse paraît vingt-cinq ans, un prodige. Ils se regardent. Tout est parfait : sa robe bleue, sa broche Cartier, cadeau de mariage, ses chaussures à lui, glacées comme des miroirs.
Wandrille fixe du regard un élément anodin du décor. C'est le canapé, gris clair, avec cinq ou six coussins à la mode anglaise, le chic cosy des Windsor. Et là, image extraordinaire ! Il pousse un cri, rebranche son téléphone, fait le numéro de Pénélope. S'arrête au dernier chiffre. Raccroche. Il appellera plus tard. Débranche à nouveau la ligne fixe, vérifie que le portable qu’il a éteint dix minutes plus tôt l’est toujours.
L'un des coussins sur lequel repose le couple maudit est une de ces merveilles que l’on achète à Bayeux, dans la boutique de la place de la cathédrale. Un coussin avec une scène de la Tapisserie : ils y sont donc allés ? À quelle date ? Il faudra vérifier. Un cadeau de bon goût choisi par la reine mère ? Pénélope va en redemander.
Wandrille tente de reconnaître le motif, la scène ; si c’était le couronnement du félon, ce serait drôle. Une espièglerie de plus de celui qui aimait commencer ses phrases, en exil, par « Du temps où j’étais encore Empereur des Indes… ».
Oui, c’est bien cela, la touche d’ironie, le sacre d’Harold, le roi « saxon », à Westminster. Ce qui aurait pu se produire avec l’appui de la Luftwaffe, puisque le sacre d’Édouard VIII n’avait pas pu avoir lieu durant son court règne officiel. Wandrille pioche sur sa table basse La Tapisserie de Bayeux de Lucien Musset, achat récent effectué à la librairie du musée. Seconde surprise, plus grandiose encore.
Aucune image ne correspond. C'est bien Westminster, comme dans la scène de l’enterrement d’Édouard le Confesseur, la première scène de la Tapisserie ; on reconnaît la nef, mais les personnages ne sont pas du tout les mêmes.
Sous la fesse de Wallis, par où le scandale est arrivé, le coussin est comme ombré de satin bleu, on voit dépasser de petits pieds du XI esiècle qui ne sont pas ceux qui figurent sur cet épisode de la Tapisserie.
Comparaison immédiate : Wandrille, qui se trouve de plus en plus fort, au comble de la surexcitation, comme s’il avait déjà compris, et qu’il était sûr de ce qu’il allait trouver, va chercher le vieux numéro du magazine de déco où l’on voit, photographiée pièce par pièce et avec un soin maniaque, la maison du Bois de Boulogne : « Le duc et la duchesse de Windsor nous ouvrent leurs portes. » Deuxième page, en plein soleil, non pas un coussin, sur le canapé gris perle, mais trois, l’un sur l’autre, bien alignés, un peu en biais, pour que l’on voie celui du dessus et les motifs des deux autres qui dépassent. Trois scènes de la Tapisserie de Bayeux qui ne se trouvent pas à Bayeux. Les scènes qui manquent. Difficile à voir en détail, mais la masse générale des couleurs ne trompe pas. Wandrille contrôle scène par scène. Il va falloir faire un agrandissement de ce détail. La perspective empêche de voir ce que représentent les scènes, mais elles sont bel et bien là.
Читать дальше