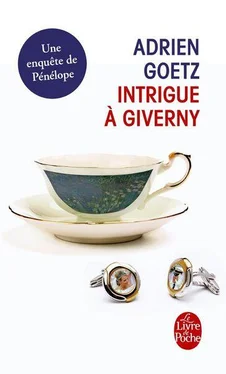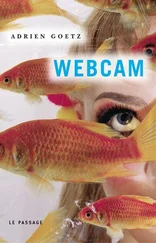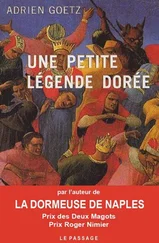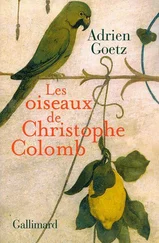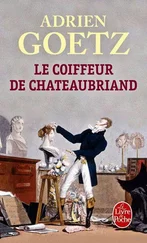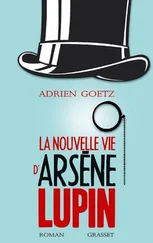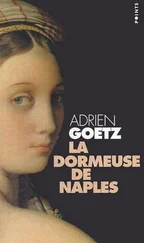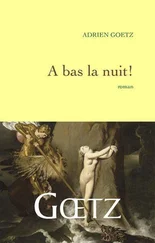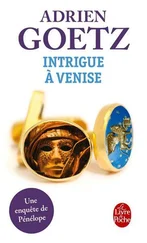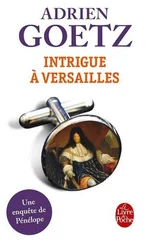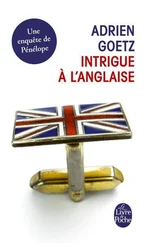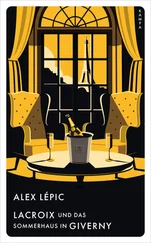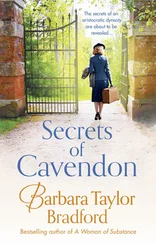« Dans cette affaire, le coupable, je le vois, Pénélope, mais personne n’osera l’arrêter, c’est un homme trop puissant. Je vais être franc avec vous. Il s’appelle Thomas Wallenstein. Un monstre froid, qui sait exactement combien il faut payer pour écarter définitivement un pion gênant dans une affaire. J’ai voulu aller revoir le tableau à Genève, le lendemain de notre dîner, j’y suis allé deux jours, et je n’ai pas pu y avoir accès. Le tableau était, à ce que m’ont répondu les responsables de ces containers géants qui sont le plus grand musée d’art d’Europe, aux Ports Francs, indisponible. Il avait été transporté à l’Institut Wallenstein sur ordre de son propriétaire pour analyses complémentaires, à Paris, et on ne me l’avait pas dit, alors que j’avais annoncé ma visite. J’ai passé deux jours pour rien au bord du lac Léman, mais bon j’ai retrouvé plein d’amis, je suis allé voir une exposition Corot au musée Rath, je n’ai pas perdu mon temps… »
Vernochet venait de se disculper. Le jour où Carolyne Square était assassinée, il n’était pas à Paris, et il y aurait des témoins pour le dire.
Sauf si celui qui a égorgé était l’homme au blouson, celui qui a enlevé Marie-Jo, celui qu’elle cherche ici… Si l’homme au blouson était le tueur payé par Vernochet… Elle n’y croit pas. Elle a mis Vernochet en confiance, elle a fait l’idiote, il a parlé.
Pénélope a du coup presque honte d’avoir suspecté ce vieil ami. Vernochet est sans scrupules, il fait des affaires, il jouit de la vie, mais il n’a rien d’un assassin. Aux assises, se serait pour elle une « intime conviction », bien solide.
Il n’en avait pas moins porté une accusation directe, et donné un nom…
7
Derrière la façade de l’Institut Wallenstein
Paris, lundi 27 juin 2011
L’immeuble de la rue de Tilsitt est un mystère. Cet anneau qui entoure l’Arc de Triomphe est ponctué d’hôtels particuliers qui ont été la gloire de la III e République et sont devenus des bureaux. Mais l’immeuble Wallenstein, avec ses persiennes de métal toujours fermées et son absence de plaque sur la façade, a su devenir invisible. Tout le monde passe devant sans le remarquer.
Thomas Wallenstein peut-il être le coupable ? Wandrille le croit. La déduction a été facile.
Les bonnes analyses ont dû lui être transmises, il a vu la photo et écrit sur sa carte : « OK pour moi » avant de renvoyer le tout à Picpus pour analyses complémentaires. A-t-il vu le tableau de ses propres yeux ? Sait-il qui en est le propriétaire ? Il est très probable, se dit Wandrille, en sonnant à l’unique bouton de cuivre qui se trouve sous l’interphone, qu’il va tout nier et dire qu’il n’a pas regardé tout cela de très près, ou qu’il ne s’en souvient pas, qu’il est occupé par d’autres affaires à Londres ou à New York. Aujourd’hui, l’empire Wallenstein, ce n’est pas seulement un prodigieux stock de tableaux anciens, c’est aussi une collection de voitures de course, la fabrication industrielle des éoliennes qu’on installe partout en Europe. Thomas Wallenstein, issu de deux générations de grands historiens de l’art, est d’abord un chef d’entreprise discret qui réussit tout.
Cette affaire est forcément pour lui plus qu’un incident. Ce qui compte à ses yeux, c’est la fiabilité absolue de ces grands indicateurs des chemins de fer du monde de l’art que sont ces immenses « catalogues raisonnés » d’artistes, qu’il confie à des savants incorruptibles. Pour Monet, il n’a jamais voulu révéler qui étaient ses enquêteurs. Il ne doit avoir qu’un seul souci en ce moment : le remplacement de Carolyne Square… Il ne peut pas l’avoir fait assassiner. En revanche, il peut avoir quelques idées sur un possible meurtrier. Et si quelqu’un a des nouvelles de la religieuse enlevée, ce ne peut être que lui.
Un sphinx, c’est ce qu’a tout de suite pensé Wandrille. Le bureau n’a pas changé depuis les années 1930, murs de parchemin, portes d’acajou, lustre en bronze Art déco, au-dessus d’une console deux photos Harcourt, le père et le grand-père. Entre les fenêtres, un grand paysage de Seurat.
Derrière ses lunettes d’or, Thomas Wallenstein, cheveux poivre et sel de jeune sportif impeccablement coiffés et coupés court, costume Cifonelli — Wandrille, même depuis qu’il a adopté le dégriffé, reste un expert —, a tout du play-boy sérieux qui a su bien vieillir.
Cordial, dès l’abord, il n’ignore pas, lui qui fuit par principe les médias, qu’il accueille chez lui le fils du ministre des Affaires étrangères. Wandrille a mis une pochette blanche, discret rappel…
Thomas Wallenstein est peut-être devenu un homme d’affaires, il tient à montrer à ce jeune journaliste qu’il n’en est pas moins un excellent historien de l’art.
Pour montrer sa passion à Wandrille, il l’embarque dans une grande discussion sur Monet et Clemenceau, que Wandrille suit et relance avec maestria, sachant bien où il amènera tôt ou tard son interlocuteur…
Ils s’installent dans de grands fauteuils de cuir dessinés par Jean-Michel Frank, tout ce dont Wandrille a toujours rêvé, le mobilier le plus élégant qui soit.
Wallenstein attaque. Sa première visite aux Nymphéas de l’Orangerie date de ses deux ans. Enfant, on l’y conduisait très souvent, c’était la seule chose qui calmait ses colères et ses crises de larmes. Depuis, il a beaucoup réfléchi à cet univers pictural unique. Pourquoi, après la mythique visite du Tigre à Giverny, les négociations pour les Nymphéas ont-elles duré si longtemps ? À l’été 1920, rien n’est encore décidé. Monet veut bien donner à la France, mais « sous réserve d’usufruit », à condition de pouvoir vivre ses derniers jours au milieu de ses dernières toiles. Le critique Arsène Alexandre s’entremet ensuite, il entraîne à Giverny Paul Léon, le secrétaire d’État aux Beaux-Arts — Wallenstein donne tous les noms comme si Wandrille les connaissait depuis toujours —, qui, enthousiasmé, demande qu’on construise un bâtiment pour abriter ce qu’il appelle « un panorama ». Wallenstein vit depuis l’enfance avec les amis de Monet, il parle d’eux comme s’ils étaient des contemporains.
« Vous pourrez écrire ça, dans Jardins Jardins , parce que c’est vrai. C’est ma première interview, vous avez de la chance : je ne mens jamais. »
Les fonctionnaires des Beaux-Arts imaginent alors un absurde temple rond, dédié à la nature, posé dans les jardins de l’hôtel Biron — devenu depuis peu le musée Rodin. Monet, ça ne lui plaît pas.
Wandrille veut comprendre pourquoi ces toiles de la dernière période de Monet sont devenues aujourd’hui les plus recherchées. Wallenstein est allé jusqu’à une étagère en laque de Dunand chercher les volumes du grand catalogue, et il les feuillette avec respect. Il montre à Wandrille les extraits des lettres du peintre que son grand-père avait transcrites.
Ces peintures, pour l’artiste, c’était un combat, semblable à celui des poilus dans les tranchées. « Cela me cause plus d’ennui que cela ne vaut… », a écrit Monet, épuisé, furieux de ne plus pouvoir peindre avec l’élan d’autrefois, découragé et dépressif. Il dit à Alice que la peinture le dégoûte. Il sent que tous veulent transformer son dernier chef-d’œuvre en une attraction de foire : une salle ronde où le public aurait l’illusion de se trouver, en plein Paris, sur le pont japonais de Giverny. Comme le panorama de Rezonville donnait l’illusion d’être au milieu d’une bataille de la guerre de 1870, face aux Prussiens. Ils n’ont rien compris. Son œuvre n’a rien à voir avec ce genre de cirque !
Читать дальше