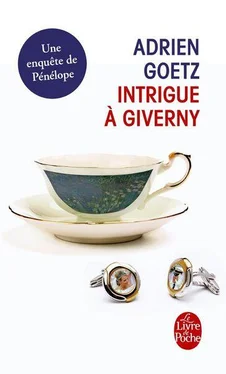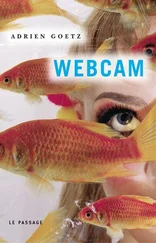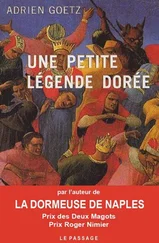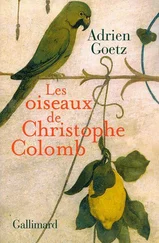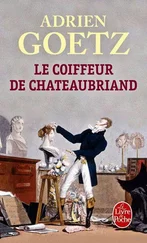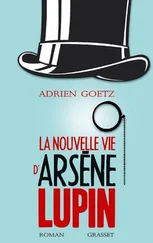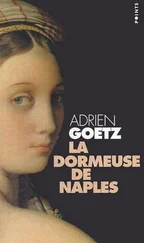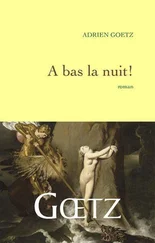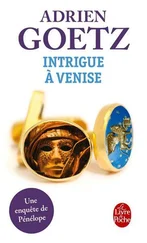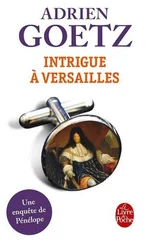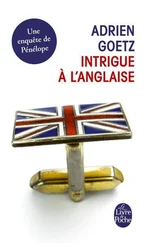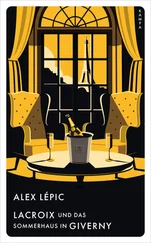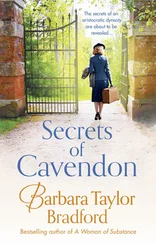Au Mobilier national, Wandrille a compris qu’on entreposait les meubles de la République, ses tapis et une prodigieuse collection de tapisseries. La Galerie des Gobelins organise des expositions superbes qui sont les plus agréables de Paris, parce que personne ne les visite. Les gens n’aiment que la peinture, ils ne connaissent rien au noble art de la tapisserie. Wandrille, lui, quand Pénélope était à Bayeux, cette jolie ville, s’était mis tout seul à la broderie, sans avoir suivi de cours, et avec de bons résultats. Les travaux d’aiguille, il connaît. Un don naturel. Son portable sonne, l’hymne monégasque piqué sur Internet.
« Je te dérange ?
— Jamais, douce reine d’Ithaque ! Pas de nouvelles depuis lundi ! Je suis en terrasse au Café de Paris. Je guette Charlène. Je pensais à toi.
— Que des bonnes nouvelles ! Tu crois que les Monégasques vont s’habituer à ce prénom ?
— La presse l’a déjà adopté. Tu verras, Péné, dans vingt ans, il y aura le boulevard Princesse-Charlène, l’hôpital Princesse-Charlène, la fondation Princesse-Charlène pour l’art conceptuel. Ils ont bien adopté d’autres prénoms bizarres : Rainier, Grace, Albert, Stéphanie, Florestan, Honoré, Ambroise, Claudine…
— Claudine ?
— Oui. Claudine de Monaco, XV e siècle. Je t’apprendrai des choses, moi, j’ai fait des recherches. Ta soirée marmottienne ? Je commençais à m’inquiéter.
— Je me suis fait piéger. Le directeur, Antonin Dechaume, le sculpteur, celui qui a fait la statue de Lindbergh au parc Montsouris, tu sais, il m’a à moitié draguée, j’ai dû rester pour le dîner officiel…
— Je vais le buter. Tu sais qu’il sculptait des nus torrides dans les années 1970 ?
— Il m’amuse, tu l’aimeras. J’étais simplement pas du tout bien habillée…
— Moi, je t’aime en jupe École du Louvre. Tu n’avais quand même pas mis la mauve qui peluche ?
— Le pire, c’est ce qui s’est passé pendant ce dîner, une chose stupéfiante… J’hésitais à t’appeler. Tu vas me trouver bête. Je me trompe peut-être…
— On a volé Impression, soleil levant ?
— Ça serait la routine, c’est déjà arrivé… On l’avait retrouvé au Japon, l’histoire n’a jamais été bien éclaircie. »
Pénélope est heureuse de raconter à Wandrille comment ce dîner a dérapé. Il aime que Pénélope soit mêlée à des événements inattendus. Ça lui arrive souvent, sa vie de conservatrice s’accélère tout à coup, et la voilà partie ailleurs. Elle a peur, cette fois, qu’il se moque d’elle.
La lumière s’est éteinte. Comme si la machine à laver de Caroline Bonaparte avait tout fait disjoncter. Sauf qu’il s’agit d’un des plus célèbres musées de Paris. On a entendu la voix du présentateur de « Mystères d’Histoire », de France Inter, qui a dit : « Chic, un anniversaire. » Quelqu’un d’autre, une voix de femme : « Attention aux colliers de perles. » Pendant sept à huit minutes, c’est très long, on n’a rien vu. Certains ont allumé leurs téléphones portables, comme des lucioles dans les fleurs de Monet — et la conversation a continué, à voix basse, sur un rythme lent, une mare aux grenouilles… On attendait l’arrivée des braqueurs, les femmes retournaient leurs bagues vers l’intérieur, personne n’est venu…
« Tu sais que ce musée est à côté du bois de Boulogne. Je me suis tout de suite dit que des cambrioleurs allaient arriver par la fenêtre… Tu vois comment ça se présente, ce petit musée qui a l’air d’être une maquette en carton ?
— Ne raconte pas tout à la fois. Commence par le début. Souviens-toi qu’il est possible que les lecteurs de Jardins Jardins n’y connaissent rien… »
Wandrille a des réflexes de journaliste. Il pose des questions. Il veut savoir ce que c’est que ce musée qu’il n’a jamais vu. À vrai dire à quoi bon y aller : Impression, soleil levant , tout le monde connaît, que voit-on d’autre dans cet endroit de rêve ?
Pénélope explique. Le collectionneur Paul Marmottan, passionné par l’Empire, avait racheté ce pavillon de chasse de la famille Kellermann, l’avait agrandi, y avait accumulé des portraits de Boilly, des bustes des grands hommes du temps de Napoléon, et ces meubles, somptueusement démodés à son époque, ornés de sphinx, de serpents, de casques, de glaives et de frises grecques.
Ce sanctuaire du style Empire était échu à l’Académie des beaux-arts, et placé depuis sous la direction d’un académicien volontaire pour devenir directeur de musée, élu par ses pairs.
« Et les impressionnistes, alors ? Quand arrivent-ils ? Et le cambriolage auquel tu as assisté ?
— Attends ! Qui te parle de cambriolage ? Je t’explique les richesses de ce musée. Après la donation Paul Marmottan, la fille du docteur de Bellio, le médecin de Manet, de Pissarro, de Sisley, de Monet et de quelques autres, a légué une collection de peintures plus modernes, avec des bords de mer, des fleurs des champs et des ombrelles, et on a accroché dans les salons de style Empire des tableaux impressionnistes, dont Impression, soleil levant .
— J’imagine qu’il avait fallu changer les rideaux, installer le gaz et l’électricité.
— Tu vois que tu connais… C’est alors que l’incroyable donation a eu lieu : Michel Monet, fils du peintre, mort en 1966, offre la vieille maison de famille de Giverny et ce qui restait de l’atelier de son père à l’Académie des beaux-arts. »
Il avait fallu transformer la cave à vin de Paul Marmottan en chambre forte, avec une porte digne d’un sous-marin. Pénélope s’interroge encore : comment le moins académique de tous les artistes se retrouvait-il sous la protection de ces académiciens en uniforme brodé avec leur bicorne empanaché, semblables à ceux qu’en son temps il avait tellement détestés ? Ceux qui étaient les successeurs de ces « chers maîtres » académiques, qui constituaient le jury du Salon, la traditionnelle exposition où lui-même et les impressionnistes étaient si souvent refusés. Michel Monet avait joué un bon tour à l’ombre paternelle. Mais au fond Claude Monet, à la fin de sa vie, était une sorte de révolté respectable, capable de blagues potaches et de pur génie, que la bande sympathique des académiciens des Beaux-Arts d’aujourd’hui aurait accueilli avec transport.
Les chefs-d’œuvre venus de Giverny avaient quitté la campagne, l’étang, l’ombre des peupliers et s’étaient retrouvés accrochés dans le décor suranné de Paul Marmottan, avec les tableaux du docteur de Bellio, qu’ils complétaient très bien, mais aussi avec les bustes représentant les beautés de l’Empire qui n’avaient pas bougé. Étaient arrivés ensuite les mythiques tableaux de la collection Rouart, avec des œuvres de Berthe Morisot, Degas, Manet… Henri Rouart, ingénieur, peintre lui-même, était un ami de Degas et avait eu en son temps un goût audacieux et percutant.
Ce musée un peu à part était de plus en plus riche — très difficile à organiser tant y régnait la confusion des époques et des styles. Pénélope, du temps où elle était à l’école du Louvre, avait fait une fiche : elle était deux fois plus longue que celles qui concernaient les autres musées de Paris. Cette bonbonnière incompréhensible, à la fois Empire et impressionniste, académique en diable et anti-académique, porte un nom impossible qui résume tout et ne dit rien : « Marmottan-Monet », autant dire carpe-lapin, La Motte-Piquet-Grenelle, Barbès-Rochechouart, nitro-glycérine.
« Ce qui n’est pas clair, demande encore Wandrille, c’est le rapport entre ce qu’on visite dans ce musée et ce qui est à Giverny. Par exemple, les nymphéas, on les voit où ?
Читать дальше