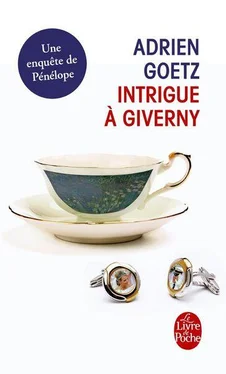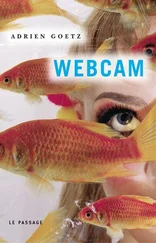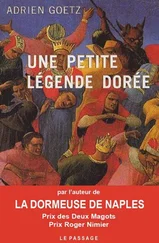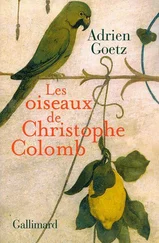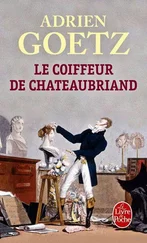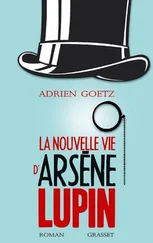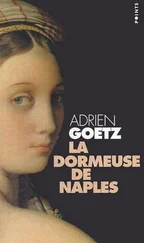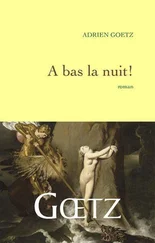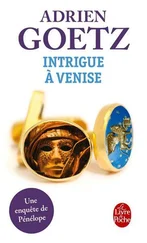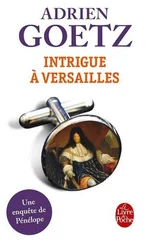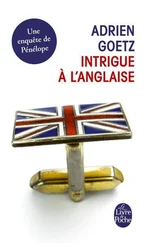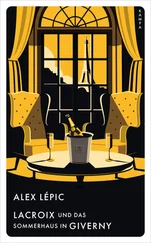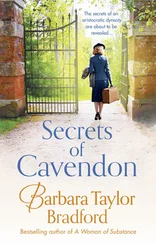Dès son arrivée, Kintô avait eu une idée simple. Au Japon, le patrimoine ne se définit pas comme en Occident : un temple reconstruit au même endroit, selon les techniques ancestrales, est digne d’être vénéré. Et quand les bois de sa toiture sont vieillis, on les remplace, pour qu’elle perdure. La maison de Monet de Kitagawa, pour les Japonais, c’est une maison de Monet, pas une reproduction. Du coup, l’idée de génie a été d’appliquer à Giverny les principes simples qui ont fait le succès de Kitagawa.
Dans son salon, Monet avait accroché des tableaux qui lui rappelaient toutes les périodes de sa vie. Camille, sa première femme, à son lit de mort — aujourd’hui au musée d’Orsay. Alice, sa seconde compagne, devait bien penser à la malheureuse, de temps à autre, quand elle s’asseyait là pour prendre le thé. Une cathédrale de Rouen, une étude ronde pour les nymphéas et, accrochée au second rang, juste sous le plafond, une des toiles peintes lors du séjour aux environs de Nice, sur la route de La Turbie. Le tableau s’intitule La Corniche de Monaco . Tout cela était copiable.
Kintô Fujiwara cherche à se rendormir. Il est heureux. Quand on a réussi à éviter la mainmise d’Antonin Dechaume sur le monde enchanté de Claude Monet, on peut se sentir apaisé. Ce pauvre Dechaume, qui ne sculpte plus mais a gardé son atelier pour épater la galerie, à la tête de ce caravansérail que tous les touristes visitent sans savoir pourquoi, parce que sur la liste des choses à cocher il y a, pour l’éternité : « Avoir vu Impression, soleil levant », ce tableau vite peint qui est loin d’être le plus intéressant de Monet. De cette période, Les Coquelicots sont mieux. La Pie du musée d’Orsay, avec cette neige éblouissante, date d’avant et Kintô considère que c’est le vrai premier chef-d’œuvre absolu de Monet.
Le silence est revenu. Kintô s’est alarmé à tort. Il s’allonge à nouveau, ferme les yeux. Il joue, pour se bercer, à penser à son seul vrai ennemi en ce monde. Il le méprise, et cette pensée le rend toujours serein. Dechaume s’escrime à organiser des expositions, à recevoir la terre entière avec sa femme espagnole nunuche, cette pauvre Paprika, cette vieille dame à cheveux blancs. Il s’ennuie à faire remplir par ses petites mains, ses « attachées de conservation » — rien que des filles convenables, pondues par l’École du Louvre —, des bordereaux d’assurances pour envoyer partout ses toiles inestimables, du Museum of Fine Arts de Chicago au musée d’Hiroshima, du Museo Reina Sofia de Madrid à la fondation Gianadda de Martigny. Ça l’occupe. Paprika pourrait se plaindre un peu, car il y en a de jolies, dans ce défilé de filles de l’École du Louvre…
Le vent souffle moins fort. Il imagine les nuages. Son esprit flotte dans le silence enfin revenu.
Ici, c’est plus simple : il n’y a rien, mais c’est le vrai Monet. Un Monet qui est partout dans l’air, dans la terre, dans les mouvements et les ombres, dans l’eau. « Je voudrais être enterré dans une bouée, tellement j’aime l’eau », disait le peintre : c’est cette bulle hors du temps où flotte l’âme du maître que les gens viennent découvrir à Giverny. À la fin, Monet n’aimait plus que son jardin, c’était, à ses yeux, sa plus belle œuvre.
Une branche a craqué. Il n’y a plus de vent. Le bruit s’est détaché sur le fond de la pluie. Kintô est assis sur son lit. Il écoute, dans son pyjama à carreaux. Cela va réveiller les fleurs.
Pour dissuader les rôdeurs qui voudraient voler le magot quotidien que rapporte cette petite usine culturelle, il organise chaque soir, comme un spectacle digne de la relève de la garde à Buckingham, le transfert de fonds avec la camionnette de la Brinks qui bloque la rue centrale du hameau. Il a demandé aux hommes de la sécurité d’être le plus visibles possible.
Un bris de verre, du côté des vieilles serres, celles du temps du peintre, près de la maison. Cette fois, aucun doute : il y a quelqu’un.
Kintô sort, une torche à la main. Il pousse la porte qui fait communiquer la ferme Duboc et la maison de Monet. On arrive dans les serres anciennes. Il a les clefs de la maison. Le vestibule est dans l’obscurité. D’instinct, il s’oriente vers la gauche, vers le salon-atelier. Les meubles à dessins sont en place, il relève le faisceau de lumière vers les grands tableaux.
Face à lui, une silhouette petite, peut-être une femme. Elle tient à la main un grand rectangle sombre, du format d’un tableau. Il n’a pas le temps d’en voir plus, son visage est dissimulé par une cagoule. Elle a sauté.
Elle s’est échappée par la fenêtre en quelques secondes. Le Japonais se précipite, regarde. Elle escalade le mur, avec toujours, au bout de sa main droite, ce tableau rectangulaire. Elle se hisse d’une main, arrive en haut, et passe. Elle ou lui… La petite silhouette noire a disparu. Cela a duré un instant.
Les tableaux sont toujours en place, aussi faux que la veille. Il n’y a pas de vide au mur. Ils sont accrochés à touche-touche, un manque sauterait aux yeux. Rien n’a semble-t-il été emporté. Pourtant ça ressemblait vraiment à un tableau, ce qu’a vu Kintô.
Il faudra dès le matin interdire l’accès de la maison au public pour décrocher tous les faux tableaux, pour vérifier. Car si rien n’a été emporté, l’ombre a peut-être essayé d’apporter une œuvre…
Il y a pensé tout de suite, parce qu’il avait eu cette idée quand on avait reconstitué le salon-atelier avec son accrochage : pour un Monet volé, Giverny était devenu la meilleure des planques. Voler un Monet et le mettre à l’abri ici, parmi les copies, faites selon ce procédé qui mélange peinture et photographie. Elles sont à s’y méprendre. On accroche l’original, et on cache la copie derrière un meuble, ou on l’emporte…
Il est peut-être arrivé juste à temps, elle a pris peur, elle a remporté le tableau qu’elle voulait planquer. Sauf si elle a emporté un faux, en laissant un original à la place, pour l’abriter en attendant de revenir le chercher… C’est compliqué, mais ingénieux. Il suffira de tout inspecter : les copies sont sur des toiles neuves, avec une étiquette au dos. Fujiwara a l’esprit vif. Il ne voit pas d’autre explication à ce « cambriolage » après lequel toutes les peintures — fausses — sont toujours là.
Il aurait bien aimé la plaquer à terre, la faire avouer — car au fond de lui, même s’il n’a vu qu’une silhouette en noir, il croit que c’est une femme.
À son âge, Kintô n’a pas l’énergie de poursuivre les belles rôdeuses.
On verra demain. Il monte à l’étage, contrôle que tout est à sa place, dans la chambre du peintre, dans les pièces attenantes. Rien ne manque. Il faudra faire un inventaire, mais au premier coup d’œil, tout va bien. Rien n’a été volé, juste un peu de verre brisé dans la vieille serre. Il hésite à appeler le capitaine de la gendarmerie sur son portable. À quoi bon, il ne va pas perdre une heure à tout lui expliquer.
Kintô peut encore dormir trois heures avant le lever du jour et l’arrivée du groupe attendu ce matin : le club norvégien des amateurs de jardins historiques.
5
Comment se meublent les ministres
Paris, le jour du dîner du musée Marmottan-Monet,
le lundi 20 juin 2011,
au Mobilier national, avenue des Gobelins
Quand le ministre des Affaires étrangères est arrivé, silhouette mince et sportive, avec son éternelle pochette blanche et son costume anglais, au petit matin, dans la cour déserte du Mobilier national, tout était prêt. Une Marseillaise virtuelle flottait dans l’atmosphère. Les bâtiments construits par Auguste Perret, en béton, avaient sous le soleil toute la beauté du centre « historique » du Havre en plein été ; les couleurs de la France battaient au-dessus du fronton.
Читать дальше