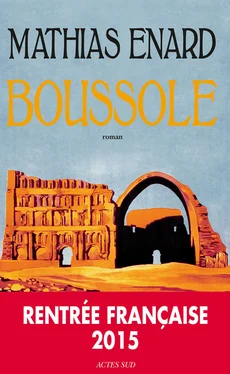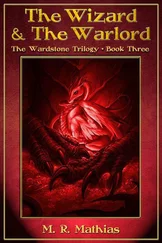— Franz, tu manques de poésie. Tu possèdes à présent une des rares boussoles qui pointent vers l’orient, la boussole de l’Illumination, l’artefact sohrawardien. Un bâton de sourcier mystique.
Vous vous demandez, cher monsieur Mann, ce que Sohrawardi, grand philosophe persan du XII esiècle décapité à Alep sur l’ordre de Saladin pouvait avoir comme relation avec la boussole de Beethoven (ou du moins sa version trafiquée par Sarah). Sohrawardi, natif de Sohraward dans le Nord-Ouest de l’Iran et découvert pour l’Europe (et aussi en grande partie pour les Iraniens) par Henry Corbin (vous ai-je déjà parlé des fauteuils en cuir de Corbin dans lesquels nous mangions des pistaches à Téhéran ?), le spécialiste de Heidegger passé à l’Islam, qui consacre à Sohrawardi et ses successeurs un volume entier de son grand œuvre, En Islam iranien . Henry Corbin est sans doute un des penseurs européens les plus influents en Iran, dont le long travail d’édition et d’exégèse a participé au renouveau, dans la tradition, de la pensée chiite. Et notamment au renouveau de l’exégèse de Sohrawardi, le fondateur de la “théosophie orientale”, de la sagesse des Lumières, héritier de Platon, de Plotin, d’Avicenne et de Zoroastre. Alors que la métaphysique musulmane s’éteignait, dans la ténèbre occidentale, avec la mort d’Averroès (et l’Europe latine s’en est tenue là) elle continuait à briller à l’est dans la théosophie mystique des disciples de Sohrawardi. C’est cette voie que montre ma boussole, d’après Sarah, le chemin de la Vérité, dans le soleil levant. Le premier orientaliste au sens strict, c’est ce décapité d’Alep, cheikh de l’illumination orientale, de l’ Ishraq , les lumières de l’Est. Mon ami Parviz Baharlou le poète de Téhéran, l’érudit à la joyeuse tristesse, nous parlait souvent de Sohrawardi, de ce savoir de l’ Ishraq et de son rapport avec la tradition mazdéenne de l’Iran antique, ce trait d’union souterrain qui unissait l’Iran chiite moderne avec la Perse ancienne. Pour lui, ce courant était bien plus intéressant et subversif que celui, initié par Ali Shariati, de relecture du chiisme comme arme de combat révolutionnaire, qu’il appelait “la rivière sèche”, car la tradition n’y coulait pas, le flux spirituel en était absent. Selon Parviz, les mollahs iraniens au pouvoir n’avaient malheureusement que faire ni de l’un, ni de l’autre : non seulement les idées révolutionnaires de Shariati n’avaient plus cours (Khomeiny déjà, au début de la Révolution, avait condamné sa pensée en tant qu’innovation blâmable) mais l’aspect théosophique et mystique était gommé de la religion du pouvoir au profit de la sécheresse du velayat-e faqih , le “gouvernement du juriste” : les clercs, jusqu’à la parousie du Mahdi, l’imam caché qui apportera la justice sur la terre, sont les responsables de l’administration terrestre, les intermédiaires non pas spirituels, mais temporels du Mahdi. Cette théorie avait provoqué, en son temps, les foudres de grands ayatollahs comme l’ayatollah Shariatmadari qui avait formé, à Qom, le père de Parviz. Parviz ajoutait d’ailleurs que le velayat-e faqih avait eu des conséquences gigantesques sur les vocations — le nombre d’aspirants mollahs s’était multiplié par cent, car un magistère temporel permettait de se remplir les poches bien plus aisément (et Dieu sait si elles sont profondes, les poches des mollahs) qu’un sacerdoce spirituel riche en récompenses dans l’au-delà mais assez peu rémunérateur pour ce bas monde : les turbans ont donc fleuri, en Iran, au moins autant que les fonctionnaires dans l’Empire austro-hongrois, c’est dire. À tel point que certains religieux se plaignent aujourd’hui que les clercs soient plus nombreux que les fidèles dans les mosquées, qu’on trouve trop de bergers et de moins en moins de moutons à tondre, à peu près comme il y avait, à la fin de la Vienne impériale, plus de commis que d’administrés. Parviz lui-même expliquait que vivant dans le Paradis de l’Islam sur terre, il ne voyait pas pour quelle raison il serait allé à la mosquée. Les seuls rassemblements religieux où il y ait foule, disait-il, sont les meetings politiques des uns et des autres : on affrète quantité d’autobus pour aller chercher les habitants du sud de la ville et ils y montent allègrement, heureux de cette promenade gratuite et du repas qu’on leur offre à la fin de la prière en commun.
Pourtant l’Iran philosophique et mystique était toujours là, et coulait comme une rivière souterraine sous les pieds de mollahs indifférents ; les tenants de l’ erfân , la connaissance spirituelle, poursuivaient la tradition de la pratique et du commentaire. Les grands poètes persans participaient de cette prière du cœur, inaudible peut-être dans le fracas de Téhéran, mais dont le battement sourd était un des rythmes les plus intimes de la ville, du pays. À fréquenter les intellectuels et les musiciens, on en oubliait presque le masque noir du régime, ce drap de deuil tendu sur toutes choses à sa portée, on s’affranchissait presque du zahir , l’apparent, pour se rapprocher du bâtin , du ventre, du caché, des puissances de l’aube. Presque, car Téhéran savait aussi, par surprise, vous déchirer l’âme et vous renvoyer à la tristesse la plus superficielle, où il n’y avait ni extase ni musique — le fou néo-gobinien du musée Abguineh, par exemple, avec son salut hitlérien et sa moustache, ou bien ce mollah croisé à l’université, professeur de je-ne-sais-plus-quoi, qui nous prit à partie en nous expliquant que nous autres, chrétiens, avions trois dieux, prônions les sacrifices humains et buvions du sang : nous n’étions donc pas de simples mécréants, mais stricto sensu de terrifiants païens. C’était, à bien y penser, la première fois qu’on me faisait porter le nom de chrétien : la première fois que l’évidence de mon baptême était utilisée par autrui pour me désigner et (en la circonstance) me mépriser, tout comme, au musée Abguineh, c’était la première fois qu’on m’imposait le nom d’Allemand pour me propulser parmi les hitlériens. Cette violence de l’identité plaquée par l’autre et prononcée telle une condamnation, Sarah la ressentait bien plus fortement que moi. Le Nom qu’elle aurait pu porter devait, en Iran, rester secret : même si la République islamique protégeait officiellement les Juifs iraniens, la petite communauté présente à Téhéran depuis quatre millénaires était la proie des brimades et des suspicions ; les dernières miettes du judaïsme achéménide étaient parfois arrêtées, torturées et pendues après des procès retentissants qui relevaient plus de la sorcellerie médiévale que de la justice moderne, accusées — entre mille autres chefs d’accusation farfelus — d’avoir frelaté des médicaments et tenté d’empoisonner les musulmans d’Iran pour le compte, bien sûr, de l’État d’Israël, dont l’évocation, à Téhéran, avait la puissance des monstres et des loups dans les contes enfantins. Et même si Sarah n’était, en réalité, pas plus juive que catholique, il fallait se méfier (vu la facilité avec laquelle la police fabriquait des espions) et dissimuler les quelques liens qu’elle pouvait entretenir avec cette entité sioniste que les discours officiels iraniens désiraient si ardemment anéantir.
Il est étrange de penser qu’aujourd’hui en Europe on pose si facilement le nom de “musulman” sur tous ceux qui portent un patronyme d’origine arabe ou turc. La violence des identités imposées.
Oh, la deuxième exposition du thème. On doit l’entendre à la loupe. Tout s’efface. Tout fuit. On s’avance dans des terrains neufs. Tout fugue. Il faut reconnaître que vos pages sur la trente-deuxième sonate de Beethoven sont propres à provoquer la jalousie des musicologues, cher Thomas Mann. Ce conférencier bègue, Kretzschmar, qui joue du piano en beuglant ses commentaires pour surpasser ses propres fortissimi . Quel personnage. Un bègue pour parler d’un sourd. Pourquoi n’y a-t-il pas de troisième mouvement à l’opus 111 ? J’aimerais vous soumettre ma propre théorie. Ce fameux troisième mouvement est présent en creux . Par son absence. Il est dans les cieux, dans le silence, dans l’avenir. Puisqu’on l’attend, ce troisième mouvement, il brise la dualité de l’affrontement des deux premières parties. Ce serait un mouvement lent. Lent, si lent ou si rapide qu’il dure dans une tension infinie. C’est au fond la même question que celle de la résolution de l’accord de Tristan. Le double, l’ambigu, le trouble, le fuyant. La fugue. Ce faux cercle, cet impossible retour est inscrit par Beethoven lui-même au tout début de la partition, dans le maestoso que nous venons d’écouter. Cette septième diminuée. L’illusion de la tonalité attendue, la vanité des espérances humaines, si facilement trompées par le destin. Ce que nous croyons entendre, ce que nous croyons attendre. L’espoir majestueux de la résurrection, de l’amour, de la consolation n’est suivi que du silence. Il n’y a pas de troisième mouvement. C’est terrifiant, n’est-ce pas ? L’art et les joies, les plaisirs et les souffrances des hommes résonnent dans le vide. Toutes ces choses auxquelles nous tenons, la fugue, la sonate, tout cela est fragile, dissous par le temps. Écoutez cette fin de premier mouvement, le génie de cette coda qui se termine en l’air, suspendue après ce long chemin harmonique — même l’espace entre les deux mouvements est incertain. De la fugue à la variation, de la fuite à l’évolution. La petite aria poursuit, adagio molto , sur un rythme des plus surprenants, la marche vers la simplicité du rien. Illusion, encore, que l’Essence ; on ne la découvre pas plus dans la variation qu’on ne la cerne par la fugue. On croit être touché par la caresse de l’amour, et on se retrouve à dévaler un escalier cul par-dessus tête. Un escalier paradoxal qui ne mène qu’à son point de départ — ni au paradis, ni à l’enfer. Le génie de ces variations, vous en conviendrez sans doute, monsieur Mann, réside aussi dans leurs transitions. C’est là que se trouve la vie, la vie fragile, dans le lien entre toutes choses. La beauté c’est le passage, la transformation, toutes les manigances du vivant. Cette sonate est vivante, justement parce qu’elle passe de la fugue à la variation et débouche sur le rien. “Qu’est-ce qu’il y a dans l’amande ? Le rien. Il s’y tient et s’y tient.” Bien sûr vous ne pouvez pas connaître ces vers de Paul Celan, monsieur Mann, vous étiez mort au moment de leur parution.
Читать дальше