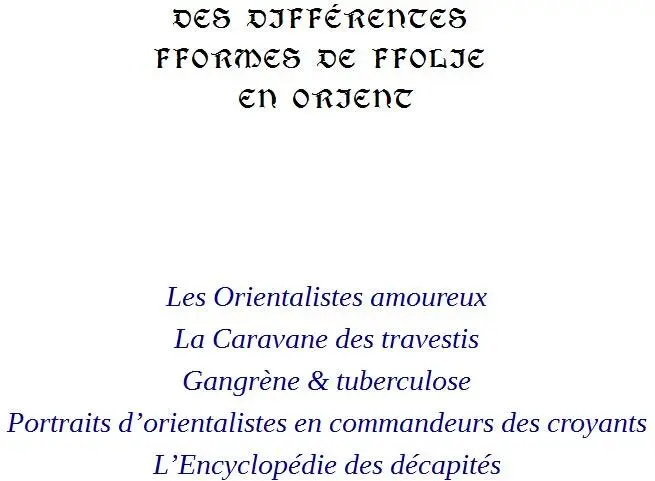Tu me manques. Le rire me manque. Un peu de légèreté. J’aimerais beaucoup être à tes côtés. J’en ai assez des voyages. Non, ce n’est pas vrai — je n’en aurai jamais assez des voyages, mais j’ai compris quelque chose, peut-être avec Pessoa :
On dit que le bon Khayyam repose
À Nishapour parmi les fragrantes roses
Mais ce n’est pas Khayyam qui gît là-bas,
C’est ici qu’il se trouve, et c’est lui nos roses.
Je crois maintenant deviner ce que voulait me dire mon maître, à Darjeeling, quand il m’a recommandé de partir. Le monde a besoin de mixité, de diasporas. L’Europe n’est plus mon continent, je peux donc y retourner. Participer aux réseaux qui s’y croisent, l’explorer en étrangère. Y apporter quelque chose. Donner, à mon tour, et mettre en lumière le don de la diversité.
Je vais venir un peu à Vienne, qu’en penses-tu ? Je viendrai te chercher à l’université, je m’assiérai sur le banc dans la jolie cour, je t’attendrai en regardant tour à tour la lumière de ton bureau et les lecteurs de la bibliothèque ; un prof aura laissé la fenêtre de sa salle ouverte ; la musique envahira le patio, et j’aurai, comme la dernière fois, la sensation d’être dans un monde amical, rassurant, de plaisir et de savoir. Je rirai à l’avance de ta surprise renfrognée à me voir là, tu diras “Tu aurais pu prévenir, tout de même”, et tu auras ce geste tendre à demi gêné, un peu guindé, qui te fait avancer le buste vers moi pour m’embrasser tout en reculant d’un pas, les mains dans le dos. J’aime beaucoup ces hésitations, elles me rappellent Alep, et Palmyre, et surtout Téhéran, elles sont douces et tendres.
Nous ne sommes pas des êtres illuminés, malheureusement. Nous concevons par moments la différence, autrui, nous nous entrevoyons nous débattre dans nos hésitations, nos difficultés, nos erreurs. Je vais venir te chercher à l’université, nous passerons devant la tour des Fous, notre tour, tu pesteras contre l’état de délabrement et d’abandon du bâtiment et du “musée des horreurs” qu’il contient ; tu diras “c’est absolument inadmissible ! L’université devrait avoir honte !” et tes emportements me feront rire ; puis nous descendrons le Strudlhofstiege pour déposer ma valise chez toi et tu seras un peu embarrassé, tu éviteras mon regard. Tu sais, il y a quelque chose que je ne t’ai jamais raconté : à mon dernier passage à Vienne, j’ai accepté de loger dans cet hôtel luxueux qu’on m’avait proposé, tu t’en souviens ? Au lieu de dormir chez toi ? Cela t’avait terriblement fâché. Je crois que c’était dans l’espoir inavoué, un peu enfantin, que tu m’y accompagnerais, que nous reprendrions, dans une belle chambre inconnue, ce que nous avons commencé à Téhéran.
Tout à coup, j’ai le mal de toi,
Que c’est beau Vienne,
Que c’est loin Vienne,
S.
Elle est gonflée, quand même. Guindé , d’après mon dictionnaire, signifie “qui manque de naturel en s’efforçant de paraître digne”, quelle honte. Elle exagère. Elle sait vraiment se rendre détestable, parfois. Si seulement elle connaissait mon état, mon terrifiant état, si elle savait dans quelles affres je me débats elle ne se moquerait pas de moi de cette façon. C’est l’aube ; c’est au point du jour que les gens meurent, dit Victor Hugo. Sarah. Isolde. Non, pas Isolde. Détournons le regard de la mort. Comme Goethe. Goethe qui refuse de voir les cadavres, de s’approcher de la maladie. Il refuse la mort. Il détourne les yeux. Il pense devoir sa longévité à la fuite. Regardons ailleurs. J’ai peur, j’ai peur. J’ai peur de mourir et peur de répondre à Sarah.
Que c’est beau Vienne, que c’est loin Vienne , c’est une citation, mais de quoi, de qui, un Autrichien ? Grillparzer ? Ou bien Balzac ? Même traduit en allemand cela ne me dit rien. Mon Dieu mon Dieu que répondre, que répondre, convoquons le djinn Google comme le génie de la lampe, Génie es-tu là, ah, foin de littérature, c’est un extrait d’une horrible chanson française, une horrible chanson française, voilà le texte complet, trouvé en 0,009 seconde — mon Dieu, elles sont longues ces paroles. La vie est longue, la vie est très longue parfois, surtout en écoutant cette Barbara, “Si je t’écris ce soir de Vienne”, quelle idée, enfin, Sarah qu’est-ce qui t’a passé par la tête, avec tous les textes que tu connais par cœur, Rimbaud, Roumi, Hafez — cette Barbara a un visage inquiétant, espiègle ou démoniaque, mon Dieu je déteste les chansons françaises, Édith Piaf à la voix de rabot, Barbara triste à déraciner un chêne, j’ai trouvé ma réponse, je vais recopier un autre passage de chanson, Schubert et l’hiver, voilà, à moitié aveuglé par l’aurore qui pointe vers le Danube, la lumière atone de l’espoir, il faut tout voir à travers les bésicles de l’espoir, chérir l’autre en soi, le reconnaître, aimer ce chant qui est tous les chants, depuis les Chants de l’aube des trouvères, de Schumann et tous les ghazals de la création, on est toujours surpris par ce qui toujours vient, la réponse du temps, la souffrance, la compassion et la mort ; le jour, qui n’en finit pas de se lever ; l’Orient des lumières, l’Est, la direction de la boussole et de l’Archange empourpré, on est surpris par le marbre du Monde veiné de souffrance et d’amour, au point du jour, allez, il n’y a pas de honte, il n’y a plus de honte depuis longtemps, il n’est pas honteux de recopier cette chanson d’hiver, pas honteux de se laisser aller aux sentiments,
Je referme les yeux,
Mon cœur bat toujours ardemment.
Quand reverdiront les feuilles à la fenêtre ?
Quand tiendrai-je mon amour entre mes bras ?
et au tiède soleil de l’espérance.
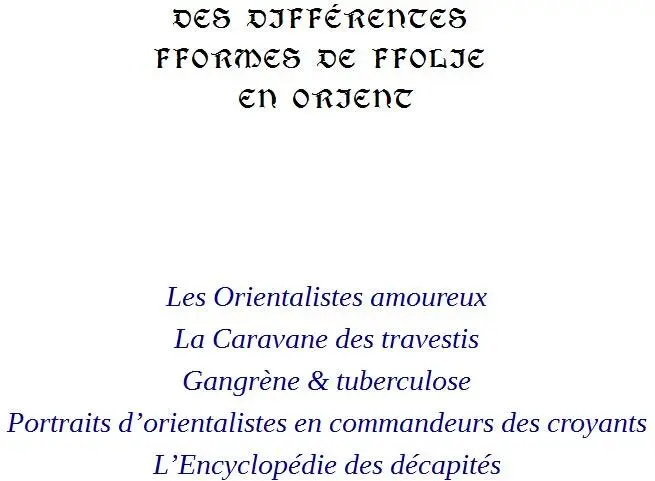
À Peter Metcalf et son “Wine of the Corpse, Endocannibalism and the Great Feast of the Dead in Borneo”, publié dans Representations en 1987, dont l’article “Du vin des morts du Sarawak” s’inspire — une contribution bien plus profonde et savante en réalité que ce qu’en disent Franz et Sarah.
Au Berliner Künstlerprogramm du Deutscher Akademischer Austauschdienst qui m’a accueilli à Berlin et permis de me plonger dans l’orientalisme allemand.
À tous les chercheurs dont les travaux m’ont nourri, orientalistes d’autrefois et érudits modernes, historiens, musicologues, spécialistes de littérature ; j’ai essayé autant que possible, quand leur nom est mentionné, de ne pas trahir leurs points de vue.
À mes vieux maîtres, Christophe Balay et Ricardo Zipoli ; au Cercle des orientalistes mélancoliques ; à mes camarades de Paris, de Damas et de Téhéran.
Aux Syriens.