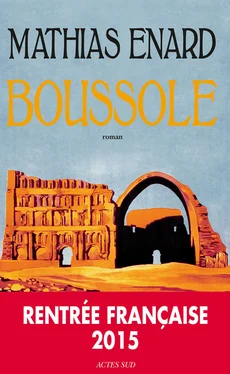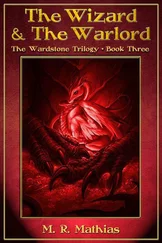Mathias Enard
Boussole
roman
Die Augen schließ’ ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster ?
Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm ?
Je referme les yeux,
Mon cœur bat toujours ardemment.
Quand reverdiront les feuilles à la fenêtre ?
Quand tiendrai-je mon amour entre mes bras ?
Wilhelm Müller & Franz Schubert,
Le Voyage en hiver.
Nous sommes deux fumeurs d’opium chacun dans son nuage, sans rien voir au-dehors, seuls, sans nous comprendre jamais nous fumons, visages agonisants dans un miroir, nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l’illusion du mouvement, un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements, je suis cette goutte d’eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l’a engendrée, ni des atomes qui la composent encore mais qui, bientôt, serviront à d’autres molécules, à d’autres corps, aux nuages pesant lourd sur Vienne ce soir : qui sait dans quelle nuque ruissellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière, et cette face indistincte sur le verre n’est mienne qu’un instant, une des millions de configurations possibles de l’illusion — tiens M. Gruber promène son chien malgré la bruine, il porte un chapeau vert et son éternel imperméable ; il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir : le clébard croit qu’il veut jouer, alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l’imper de M. Gruber qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser, sa silhouette est allongée par les réverbères, flaque noircie au milieu des mers d’ombre des grands arbres, déchirées par les phares sur la Porzellangasse, et Herr Gruber hésite apparemment à s’enfoncer dans la nuit de l’Alsergrund, comme moi à laisser ma contemplation des gouttes d’eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor.
L’existence est un reflet douloureux, un rêve d’opiomane, un poème de Roumi chanté par Shahram Nazeri, l’ ostinato du zarb fait légèrement vibrer la vitre sous mes doigts comme la peau de la percussion, je devrais poursuivre ma lecture au lieu de regarder M. Gruber disparaître sous la pluie, au lieu de tendre l’oreille aux mélismes tournoyants du chanteur iranien, dont la puissance et le timbre pourraient faire rougir de honte bien des ténors de chez nous. Je devrais arrêter le disque, impossible de me concentrer ; j’ai beau relire ce tiré à part pour la dixième fois je n’en comprends pas le sens mystérieux, vingt pages, vingt pages horribles, glaçantes, qui me parviennent précisément aujourd’hui, aujourd’hui qu’un médecin compatissant a peut-être nommé ma maladie, a déclaré mon corps officiellement malade, presque soulagé d’avoir posé — baiser mortel — un diagnostic sur mes symptômes, un diagnostic qu’il convient de confirmer, tout en commençant un traitement, disait-il, et en suivre l’évolution, l’évolution, voilà, on en est là, contempler une goutte d’eau évoluer vers la disparition avant de se reformer dans le Grand Tout.
Il n’y a pas de hasard, tout est lié, dirait Sarah, pourquoi reçois-je précisément aujourd’hui cet article par la poste, un tiré à part d’autrefois, de papier et d’agrafes, au lieu d’un PDF assorti d’un message souhaitant “bonne réception”, un mail qui aurait pu transmettre quelques nouvelles, expliquer où elle se trouve, ce qu’est ce Sarawak d’où elle écrit et qui, d’après mon atlas, est un État de Malaisie situé dans le Nord-Ouest de l’île de Bornéo, à deux pas de Brunei et de son riche sultan, à deux pas aussi des gamelans de Debussy et de Britten, me semble-t-il — mais la teneur de l’article est bien différente ; pas de musique, à part peut-être un long chant funèbre ; vingt feuillets denses parus dans le numéro de septembre de Representations , belle revue de l’université de Californie dans laquelle elle a déjà souvent écrit. L’article porte une brève dédicace sur la page de garde, sans commentaire, Pour toi très cher Franz, je t’embrasse fort, Sarah , et a été posté le 17 novembre, c’est-à-dire il y a deux semaines — il faut encore deux semaines à un courrier pour faire le trajet Malaisie-Autriche, peut-être a-t-elle radiné sur les timbres, elle aurait pu ajouter une carte postale, qu’est-ce que cela signifie, j’ai parcouru toutes les traces d’elle que j’ai dans mon appartement, ses articles, deux livres, quelques photographies, et même une version de sa thèse de doctorat, imprimée et reliée en Skivertex rouge, deux forts volumes de trois kilos chacun :
“Dans la vie il y a des blessures qui, comme une lèpre, rongent l’âme dans la solitude”, écrit l’Iranien Sadegh Hedayat au début de son roman La Chouette aveugle : ce petit homme à lunettes rondes le savait mieux que quiconque. C’est une de ces blessures qui l’amena à ouvrir le gaz en grand dans son appartement de la rue Championnet à Paris, un soir justement de grande solitude, un soir d’avril, très loin de l’Iran, très loin, avec pour seule compagnie quelques poèmes de Khayyam et une sombre bouteille de cognac, peut-être, ou un galet d’opium, ou peut-être rien, rien du tout, à part les textes qu’il gardait encore par-devers lui et qu’il a emportés dans le grand vide du gaz.
On ignore s’il laissa une lettre, ou un signe autre que son roman La Chouette aveugle , depuis longtemps achevé, et qui lui vaudra, deux ans après sa mort, l’admiration d’intellectuels français qui n’avaient jamais rien lu de l’Iran : l’éditeur José Corti publiera La Chouette aveugle peu après Le Rivage des Syrtes ; Julien Gracq connaîtra le succès quand le gaz de la rue Championnet venait de faire son effet, l’an 1951, et dira que le Rivage est le roman de “toutes les pourritures nobles”, comme celles qui venaient d’achever de ronger Hedayat dans l’éther du vin et du gaz. André Breton prendra parti pour les deux hommes et leurs livres, trop tard pour sauver Hedayat de ses blessures, s’il avait pu être sauvé, si le mal n’était pas, très certainement, incurable.
Le petit homme à épaisses lunettes rondes était dans l’exil comme en Iran, calme et discret, parlant bas. Son ironie et sa méchante tristesse lui valurent la censure, à moins que ce ne fût sa sympathie pour les fous et les ivrognes, peut-être même son admiration pour certains livres et certains poètes ; peut-être le censura-t-on parce qu’il tâtait un peu de l’opium et de la cocaïne, tout en se moquant des drogués ; parce qu’il buvait seul, ou avait la tare de ne plus rien attendre de Dieu, pas même certains soirs de grande solitude, quand le gaz appelle ; peut-être parce qu’il était misérable, ou parce qu’il croyait raisonnablement à l’importance de ses écrits, ou qu’il n’y croyait pas, toutes choses qui dérangent.
Toujours est-il que rue Championnet aucune plaque ne signale son passage, ni son départ ; en Iran aucun monument ne le rappelle, malgré le poids de l’histoire qui le rend incontournable, et le poids de sa mort, qui pèse encore sur ses compatriotes. Son œuvre vit aujourd’hui à Téhéran comme lui mourut, dans la misère et la clandestinité, sur les étals des marchés aux puces, ou dans des rééditions tronquées, élaguées de toute allusion pouvant précipiter le lecteur dans la drogue ou le suicide, pour la préservation de la jeunesse iranienne, atteinte de ces maladies de désespoir, le suicide et la drogue et qui se jette donc sur les livres de Hedayat avec délectation, quand elle y parvient, et ainsi célébré et mal lu, il rejoint les grands noms qui l’entourent au Père-Lachaise, à deux pas de Proust, aussi sobre dans l’éternité qu’il le fut dans la vie, aussi discret, sans fleurs tapageuses et recevant peu de visites, depuis ce jour d’avril 1951 où il choisit le gaz et la rue Championnet pour mettre un terme à toutes choses, rongé par une lèpre de l’âme, impérieuse et inguérissable. “Personne ne prend la décision de se suicider ; le suicide est en certains hommes, il est dans leur nature”, Hedayat écrit ces lignes à la fin des années 1920. Il les écrit avant de lire et de traduire Kafka, avant de présenter Khayyam. Son œuvre s’ouvre par la fin. Le premier recueil qu’il publie débute par
Читать дальше