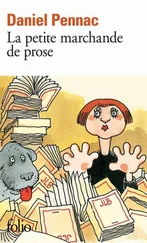Mona m’apporte un pyjama, une trousse de toilette et de quoi lire. Tous les lits d’adultes étant occupés, je partage une chambre avec deux enfants malades (une otite et une morsure de chien) qui torpillent mon projet de lecture. Ce vieillard au pif tumescent est une fameuse source de distraction. Ainsi, les adultes aussi peuvent tomber malades ? Au point de partager la chambre des enfants à l’hôpital ! En réponse à leurs questions je leur propose de résoudre le problème des robinets qui fuient dans mon crâne. Sachant que ces robinets produisent toutes les quatre heures vingt centilitres de sang, calculez la quantité globale écoulée en vingt-quatre heures. Étant donné par ailleurs que le corps humain contient en moyenne cinq litres à l’âge adulte, combien de temps faudra-t-il au patient pour se vider jusqu’à la dernière goutte ? Allez, au boulot, je ne veux pas entendre une mouche voler ! Comme souhaité, ils s’endorment pendant le calcul et je peux me mettre à ma lecture, où je retombe sur cet aveu de Hobbes qui me va comme un gant : « La peur aura été la seule passion de ma vie. »
Après un ultime méchage, l’interne du matin me renvoie dans mes foyers, aussi optimiste que s’il m’installait dans une vie toute neuve. Mais, à peine rentré chez moi, un écoulement sirupeux me laisse au fond de la gorge un goût métallique qui ne trompe pas. Quatre heures plus tard, retour aux urgences, quatrième méchage. (Qui dit qu’on ne s’habitue pas à la douleur ?) Cette fois, l’interne est sceptique : Je vous le fais par acquit de conscience, monsieur, mais vous ne saignez pas. Docteur, je saigne à l’intérieur , toutes les quatre heures. Monsieur, c’est une impression , vous faites une épistaxis, comme en font la plupart des enfants, vous n’êtes pas en avance pour votre âge mais ce n’est pas plus grave que ça ; le méchage a jugulé l’hémorragie, vous ne saignez plus.
Nouveau retour dans mes foyers. Où la sanglante « impression » se manifeste comme devant, avec la même régularité. Étienne m’envoie un de ses amis du Samu. Comme nous sommes entre deux vidanges l’ami confirme le diagnostic du spécialiste : Vous ne saignez pas, c’est bel et bien une impression, probablement due à un effet de panique, ne vous affolez pas, dormez, ça va passer. Je ne m’affole pas, je m’étiole. Je m’étiole et Mona s’alarme. Elle décide de retirer la mèche pour en avoir le cœur net. Elle veut calculer la quantité de sang perdue. Nouvelle hémorragie : je remplis un bol de famille. Toujours par la narine gauche. Quatre heures plus tard, deuxième bol. Nous retournons à l’hôpital flanquer ces bols sous les yeux du toubib et lui demander si ce sont des impressions. Inutile, nous tombons sur un autre médecin. Nouveau méchage au prétexte que le précédent a dû être mal fait. C’est plus délicat qu’il n’y paraît le méchage, mais ne vous inquiétez pas monsieur, l’épistaxis est une affection tout à fait bénigne.
Le lundi matin mon corps retourne au travail dans son impeccable costume de chef. Je m’isole toutes les quatre heures pour saigner tranquillement, comme on va pisser. Avec mon sang, je perds mes forces. Avec mes forces, je perds le moral. Une irrépressible tristesse succède à chaque hémorragie. On dirait que la mélancolie remplit l’espace laissé vacant par le sang perdu. Je me sens gagné par la mort. Elle prend, lentement mais sûrement, la place de la vie. J’aurais tant aimé passer encore une dizaine d’années avec Mona, voir grandir Bruno, consoler Lison en ses premiers chagrins d’amour. C’est sur ce point que se fixe mon spleen d’agonisant : les amours de Lison. Je ne veux pas que Lison souffre. Je ne veux pas qu’un salopard profite de sa grâce un peu maladroite, de sa fébrile attention au monde, de sa recherche si têtue d’une vérité dans le bonheur. Simultanément à cette angoisse, une certaine paix me gagne, je lâche la rampe, je me laisse aller dans le courant, emporté par mon propre sang, la mort, me dis-je, la mort est un paisible endormissement…
Le lendemain, plus la force de me rendre au bureau. Passe Tijo, que Mona a alerté et qui m’emmène aussitôt à Saint-Louis où officie un infirmier de sa connaissance, lui-même en cheville avec un ORL grand patron chirurgien de la face, lequel, sidéré par la quantité de sang perdue pendant ces deux jours, conclut à une erreur de diagnostic — c’est bien d’une épistaxis qu’il s’agit, mais d’une épistaxis postérieure qui nécessite de toute urgence une opération sous anesthésie générale. La main de Mona lâche la mienne à la frontière du bloc opératoire.
À mon réveil, ma tête est une citrouille criblée de flèches. Je suis prodigieusement énervé. Mon corps, apparemment immobile, ne tient pas en place. Je ne cesse de gigoter en moi-même, comme si j’étais habité par un autre, lequel, selon Mona, a copieusement déliré. Cet effet de possession est une réaction fréquente à la morphine, m’explique l’infirmière de service, à qui je demande donc de supprimer la morphine. Impossible, monsieur, vous aurez trop mal ! Si c’est le cas on y reviendra. Morphine éliminée la douleur remonte, ascension que chacun de mes nerfs suit avec le plus vif intérêt. Un saint Sébastien dont les archers ne viseraient que le visage. Ils tirent tous entre les deux yeux. Leur carquois vide, le supplice se révèle supportable pourvu que je reste immobile. Compte tenu de mon faible taux d’hémoglobine le chirurgien souhaite me garder une dizaine de jours, histoire de me retaper pour éviter la transfusion. Il me prie d’excuser l’Académie pour ces erreurs de diagnostics : Que voulez-vous, c’est très rare une épistaxis postérieure et la médecine n’est pas une science exacte. En matière de diagnostic, ajoute-t-il, il faut toujours garder sa place au doute, comme au théâtre celle du pompier. Hélas, les jeunes internes ne l’apprennent que sur le tas.
43 ans, 9 mois, 8 jours
Mardi 18 juillet 1967
Dix jours d’hospitalisation dont la moitié passée à roupiller et l’autre à écrire ce qui précède. Au début, les énormes moustaches de gaze qui passent par l’intérieur de mon nez et me sortent par les narines me font une tête de Turc à l’ancienne. On me gave de fer, je bouquine, je déambule mollement dans les couloirs, j’apprends le nom des médecins et des infirmières, je retrouve les rythmes et les coutumes du pensionnat, je renoue avec la gastronomie de cantine, je m’abandonne et me repose, délivré de toute impatience. Seul bémol, qui ajoute le désespoir à la maladie, la laideur rayée de mes pyjamas. (Mona m’affirme que le magasin n’offrait pas d’autre modèle.)
Mon voisin de chambre est un jeune pompier tombé sous les matraques de la police pendant les manifestations du début du mois. Il prétendait s’interposer entre les forces de l’ordre et un groupe de manifestants. Comme il n’était pas en uniforme, la loi lui a fait sauter les dents, démis la mâchoire, fracturé la cloison nasale, enfoncé une orbite, brisé quelques côtes, cassé la main et la cheville. Il pleure. Il a si peur. Il pleure de terreur. Je suis incapable de l’apaiser. La voix de canard émise par mes bandages nuit à la sagesse de mes consolations. Ses parents et sa fiancée, une gamine noyée de larmes, ne font pas mieux. Ce sont les copains de sa brigade qui le ramèneront à la vie. Chaque soir, une demi-douzaine de pompiers débarquent, travestis en Bretonnes, en Alsaciennes, en Savoyardes, en Provençales, en Algériennes, happening folklorique fêté par toutes les infirmières de l’étage : cornemuses, fifres, tambourins, youyous, danses locales, galettes au beurre, couscous, choucroute, Kronenbourg, thé à la menthe et vin d’Abîme, rigolade générale dont on craint d’abord qu’elle n’achève notre petit pompier (ses mâchoires et ses côtes mettent son rire au supplice) mais qui le ressuscite.
Читать дальше