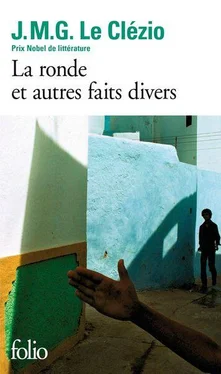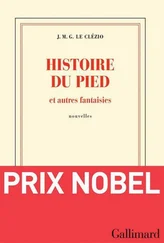Ensuite, vers le milieu du jour, le camion est revenu, et avec le contremaître il y avait l’homme barbu que Miloz avait connu, quand il vivait dans le sous-sol de la villa. C’est lui qui a compté l’argent, et qui l’a donné à chaque homme, par paquets de billets de cent francs. Miloz a reçu sa liasse, et quand il l’a prise, l’homme barbu lui a dit simplement, et c’était une affirmation, pas une question.
« Tu t’en vas aujourd’hui. »
Miloz a tourné la tête, il a regardé du côté des hommes de la carrière. Mais tous avaient disparu, ainsi que leurs baluchons. Et puis, de l’autre côté des baraquements et des roulottes, Miloz a entendu le bruit du moteur du compresseur, et le grelot aigu des marteaux-piqueurs. Il avait soif. Il a marché vers le robinet d’eau, près du portail, il a bu longuement. Puis il a pris la poignée de sa valise en carton bouilli, et il est sorti de l’enclos, sans se retourner.
Le soleil est bien à mi-chemin du ciel, il brûle fort dans tout le bleu, malgré le vent froid de l’hiver. Miloz marche de plus en plus vite, il redescend la route vers la mer, vers la grande ville pleine de bruit et de mouvement.
Il arrive à la nuit tombante, quand les lampadaires s’allument en faisant de grandes flaques de lumière sur l’asphalte, et que les feux rouges des voitures fuient sans cesse au bout des avenues. Il y a si longtemps qu’il n’a pas été libre que son cœur bat vite et lui fait mal, et qu’il peut à peine respirer. Le bruit et le mouvement des rues fait tourner la tête et l’écœure, alors il s’assoit sur un banc, devant la gare, et il regarde passer les autos. Un car de la police glisse lentement devant lui, et les policiers lui jettent un coup d’œil inquisiteur. Miloz a peur, il recommence à marcher avec sa vieille valise de carton qui cogne contre ses jambes. Il entre dans un bar éclairé par des barres de néon, et il s’assoit tout à fait au fond, le plus loin possible de la porte, à côté de deux hommes qui jouent aux cartes. Il commande de la bière et un sandwich, il mange et boit presque machinalement. Quand le bar ferme, il est à nouveau dans la rue, sans savoir où aller. Il voudrait aller à l’hôtel pour dormir, mais il a peur du regard des veilleurs de nuit des hôtels. Il s’éloigne du centre, le long des avenues sombres, jusqu’à ce qu’il trouve un chantier d’immeuble. C’est là qu’il s’installe pour dormir, couché dans la poussière de ciment, la tête appuyée sur sa vieille valise, enveloppé dans des bouts de carton qu’il a trouvés par terre. Il dort, la main posée contre son cœur, sur la poche de son tricot de corps où il a cache son argent.
Quand le jour vient, il sort du chantier avant que les ouvriers n’arrivent, et il continue à marcher dans la ville, au hasard, d’une rue à l’autre. Les vitrines des magasins brillent fort, les cafés, les restaurants, les devantures des cinémas pleins d’ivresse. Miloz n’ose entrer nulle part, seulement dans les boulangeries, pour acheter des baguettes de pain chaud qu’il mange dans les jardins publics, entouré de pigeons et de moineaux. Il n’ose plus aller dans les bars pour boire de la bière, parce que les gens regardent son visage hirsute, brûlé de soleil et de froid, et ses habits usés et pleins de poussière de ciment.
Mais lui les regarde, avidement presque, comme s’il cherchait à comprendre ce qui les rend si lointains, si indifférents, comme s’ils n’appartenaient pas au même monde. Il y a des jeunes filles si belles, avec des visages clairs et purs auréolés de cheveux blonds, de cheveux noirs, vêtues comme des amazones, balançant doucement leurs hanches, glissant sur le trottoir comme des fées. Mais elles ne le voient pas, elles passent devant lui sans le regarder, leurs beaux yeux cachés par des lunettes de soleil, ou bien fixés au loin, à travers lui. Il les épie dans les jardins publics, dans la rue, sur les reflets des vitrines. Alors il voit son propre visage apparaître, mangé de barbe, avec ses cheveux noirs emmêlés qui font comme un casque, et ses traits amaigris, ses yeux fiévreux, effrayants. Il doit se fuir lui-même, comme font les jeunes filles seules qui traversent la rue quand elles le voient arriver.
La nuit, dans le chantier abandonné, il écoute la rumeur de la ville, les bruits des postes de radio, de télévision, les grondements sourds des autos et les bruits de crécelle des motos. Une nuit, il est réveillé en sursaut. Il regarde dans le noir, sans respirer, et il voit des silhouettes d’hommes qui rôdent sur le chantier. Peut-être qu’ils le cherchent pour le tuer, et lui voler son argent ? Alors, en silence, il se glisse hors de sa couchette, il prend sa valise et il sort du chantier. Quand il est dans la rue, il se met à courir aussi vite qu’il peut, droit devant lui, sans se retourner. Puis il se cache dans un terrain vague, derrière un mur, là où il y a un dépotoir. C’est là qu’il passe la nuit, écoutant le bruit des rats qui galopent dans le terrain vague, dans l’air froid bleui par la lumière électrique.
Alors, quand le jour se lève, il traverse la ville, et il marche vers l’est, le plus loin qu’il peut. Quand il arrive près de la frontière, il remonte vers le nord, et il cherche, jusqu’à ce qu’il retrouve la route par laquelle il est venu, la première fois. Jour après jour, il marche vers la haute montagne, mangeant le pain qu’il a acheté dans les boulangeries de la ville, buvant l’eau des fontaines. Déjà, le ciel est plus bleu, et l’odeur des forêts de mélèzes lui rend ses forces. Il marche sur les sentiers de cailloux aigus, à travers la garrigue et les chênes verts. Quand il n’y a plus de maisons, seulement de temps à autre les murs écroulés d’une ancienne ferme, ou des restanques abandonnées, Miloz n’a plus peur. Il monte vers le haut de la montagne, peinant sous le soleil éblouissant de l’hiver, comme s’il remontait vers le commencement du temps, là où il n’y a plus de haine, ni de désespoir.
Le silence est grand, le froid brûle la peau du visage et des mains, fait pleurer les yeux. Alors, à un moment, entre les rocs escarpés, contre le ciel pur, Miloz voit la Roche Longue, pareille au bord d’une fenêtre d’où on peut apercevoir l’éternité. C’est là qu’il va, escaladant la pente qui s’éboule, presque sans respirer, écorchant ses mains et ses genoux, traînant sa valise qui s’abîme sur les pierres aiguës. La fatigue pèse sur lui, l’air manque, et chaque fois qu’il sent qu’il va tomber, il dit à haute voix, comme le passeur : « Marche ! Marche ! » Quand il est au sommet, c’est le soir, et il voit le paysage de l’autre côté, les vallonnements, les villages qui fument dans l’ombre. Tout à fait en bas, dans la faille sombre de la terre, monte la brume cotonneuse le long du fleuve Roïa, celui qu’il a traversé il y a un an, le fleuve presque sans eau de l’oubli. Malgré le vent glacé qui vient des cimes enneigées, il se couche sur le bord de la falaise, et les yeux agrandis par la fatigue, il regarde au loin, comme si son regard pouvait éveiller quelque part, malgré le temps, malgré le silence, les yeux de Lena.
Ô voleur, voleur,
quelle vie est la tienne ?
Dis-moi, comment tout a commencé ?
Je ne sais pas, je ne sais plus, il y a si longtemps, je n’ai plus souvenir du temps maintenant, c’est la vie que je mène. Je suis né au Portugal, à Ericeira, c’était en ce temps-là un petit village de pêcheurs pas loin de Lisbonne, tout blanc au-dessus de la mer. Ensuite mon père a dû partir pour des raisons politiques, et avec ma mère et ma tante on s’est installés en France, et je n’ai jamais revu mon grand-père. C’était juste après la guerre, je crois qu’il est mort à cette époque-là. Mais je me souviens bien de lui, c’était un pêcheur, il me racontait des histoires, mais maintenant je ne parle presque plus le portugais. Après cela, j’ai travaillé comme apprenti maçon avec mon père, et puis il est mort, et ma mère a dû travailler aussi, et moi je suis entré dans une entreprise, une affaire de rénovation de vieilles maisons, ça marchait bien. En ce temps-là, j’étais comme tout le monde, j’avais un travail, j’étais marié, j’avais des amis, je ne pensais pas au lendemain, je ne pensais pas à la maladie, ni aux accidents, je travaillais beaucoup et l’argent était rare, mais je ne savais pas que j’avais de la chance.
Читать дальше