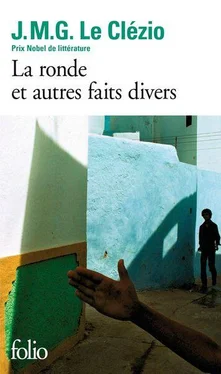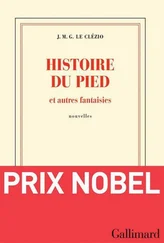Il pose sa valise à côté de lui, il s’assoit sur ses talons, à l’écart du guide. Ils ne se disent rien. Mais pour la première fois, Miloz sent qu’il y a une communication avec l’autre homme. Même s’ils ne se regardent pas, cela se sait, parce que c’est dans la façon qu’ils ont tous les deux d’être assis à croupetons et de regarder le paysage magnifique qui s’étend devant eux.
La lumière apparaît peu à peu sur les montagnes, éclairant d’abord les sommets, et le roc d’Ormea, déchiqueté, surgit au-dessus des vallées sombres. Miloz distingue le chemin qu’ils vont suivre, en France, d’abord depuis le haut de la crête rocheuse, puis vers le sud, contournant le pic rocheux, vers le fond des vallées, à travers la forêt de chênes verts et de pins. Tout à fait au sud, de l’autre côté du roc d’Ormea et des collines vert sombre, il voit la brume blanche qu’il connaît bien, et qui signifie qu’il y a la mer. C’est tout cela qu’il regarde, accroupi sur ses talons non loin du guide, et tout ce qu’il voit entre en lui comme des mots, comme des pensées. Il sait qu’il n’oubliera pas cela, pour pouvoir le dire plus tard à Lena, pour qu’elle vienne, elle aussi. Ce sont des signes aussi de la fin de la misère, de la fin des désirs inassouvis. La fatigue, le manque de sommeil le font délirer un peu et il entend que les autres hommes arrivent, s’asseyent autour de lui pour regarder à leur tour. Il perçoit le bruit de leurs voix, de leur souffle, tandis que le même mot est murmuré sur toutes les lèvres :
« Francia… Francia… »
Le guide reste immobile encore un long moment, en équilibre sur ses talons, comme s’il accordait aux hommes le droit de regarder la terre promise. Puis, quand le soleil apparaît derrière les hautes montagnes, de l’autre côté du fleuve Roïa, il se lève, il dit encore : « Marche ! » Et il se met à descendre rapidement la pente, vers le fond du vallon. Il marche sans se retourner, sans attendre. Même Miloz a du mal à le suivre, il titube sur les cailloux qui s’éboulent, ébloui par la lumière. Enfin ils marchent sur le sentier, autour du pic rocheux qui paraît blanc au soleil. Le vent froid se met à souffler dans la vallée, transperce les habits usés des hommes. Au bas de la pente, le guide les attend près d’une source qui jaillit au milieu des chênes, et dont l’eau cascade le long du sentier. Les uns après les autres, les hommes déposent leur fardeau et boivent longuement l’eau glacée, vivante. Les arbres sont épais, il y a des oiseaux qui chantent. Plus loin, le guide fait détaler un lièvre, qu’il essaie de tuer en vain à coup de pierre. Les hommes, eux, sont trop hébétés pour tenter quoi que ce soit, malgré la faim qui ronge leur ventre.
Plus loin, le sentier s’élargit, il est empierré. Ils traversent lentement le Plan-du-Lion, vers le village de Castellar. Dans les fermes, les premiers chiens français aboient, et les hommes se baissent un peu, pour disparaître derrière les buissons. Mais personne ne bouge dans les fermes. Peut-être qu’ils dorment encore, malgré la belle lumière du matin. Et maintenant, devant eux, tout à coup, le village est tout proche, perché en haut de son piton rocheux. Quand le guide arrive près de la chapelle, il s’arrête un instant, puis repart plus vite. Miloz descend la pente derrière lui. Les broussailles s’écartent. Sur l’aire goudronnée du parking, devant le village, il y a une camionnette bleue bâchée, à l’avant de la camionnette, Miloz aperçoit le gros Tartamella qui fume une cigarette en écoutant la radio.
35
17
La vie est longue, et lourde, elle pèse chaque jour, chaque nuit, sur l’ombre de la cave où dorment les hommes. Depuis combien de temps sont-ils là ? Ils ne savent plus. Miloz pense qu’il y a un mois, peut-être deux, ou trois. Peut-être que ce ne sont pas des mois, mais des années ? Quelquefois, l’homme barbu vient, ouvre la porte de la cave, appelle les noms. Il les prononce n’importe comment, en les écorchant, mais chacun s’y reconnaît, et se précipite vers l’escalier, sort au niveau du sol, ébloui par le soleil, titube. L’homme barbu ne dit rien d’autre. Il emmène les hommes qu’il a choisis dans la camionnette bleue bâchée, ou bien c’est Tartamella encore, avec son visage gras et suant qui attend derrière le volant. Où vont-ils ? La camionnette roule longtemps, sur la route sinueuse, traverse des villes, des avenues immenses où toutes les voitures rutilent à la lueur du soleil. Longe des parcs, des jardins pleins de palmiers, longe la mer d’un bleu irréel. Penchés vers l’ouverture de la bâche, les hommes se poussent pour regarder à tour de rôle, la bouche serrée, les yeux avides. Ils voient la vie du dehors, la vie belle et rapide, les reflets, les éclats, les gens qui marchent librement dans la rue, les jolies filles arrêtées devant les vitrines, les enfants qui courent le long des trottoirs.
Chaque jour, Miloz pense à Lena, il y pense si fort que cela lui fait mal. Il voulait écrire, les premiers temps, mais Tartamella ne veut pas. Il dit que la police ouvre les lettres, qu’elle fait des recherches pour surprendre les immigrés clandestins. Il dit qu’on le mettra en prison, ainsi que tous les autres, et qu’on les renverra chez eux. Parfois, Miloz voudrait s’échapper. Quand la camionnette bâchée ralentit, à un feu rouge, ou bien s’arrête parce que Tartamella va acheter des cigarettes, Miloz écarte la bâche et regarde au-dehors de toutes ses forces. Tous ses muscles tremblent du désir de bondir, de courir dans la rue, en pleine lumière, de disparaître au milieu de la foule. Mais il n’a pas d’argent, pas de papiers. Tartamella a pris toutes ses économies et sa carte d’identité, pour les garder en lieu sûr, a-t-il dit, mais Miloz sait bien que c’est pour le retenir prisonnier, pour l’empêcher de s’en aller. La camionnette conduit son chargement d’hommes jusqu’au lieu du travail, une carrière de ciment au fond d’un vallon obscur, un chantier au bord de la mer, où l’on construit un grand immeuble de béton, ou bien devant une bâtisse de banlieue, un hangar, des murs de brique, où il faut peindre, poncer, passer du crépi, clouer des bois de coffrage, fixer des poutrelles de fer avec des boulons.
Alors le ciel est bleu et froid au-dessus d’eux, mais ils se sentent libres à nouveau comme lorsqu’ils ont franchi la haute montagne pour redescendre vers la vallée brumeuse, à l’aube, la première fois. Miloz pense à cela. Il rêve chaque nuit, avant de s’endormir, au moment où il arrivera au sommet de la montagne, tenant dans sa main la main douce de Lena, et ils regarderont ensemble l’étendue des vallées, les pics rocheux, les bois de pins au-dessous d’eux, et la tache de brume qui indique là où commence la mer. Il rêve à cela, il parle à Lena, à l’intérieur de lui-même, couché sur le matelas moisi au fond de la cave. La fatigue l’empêche de rêver plus longtemps, et il ne sait pas ce qui se passe ensuite, quand il redescend vers la vallée en tenant la main de Lena. Peut-être que c’est l’image de Tartamella qui l’empêche de rêver, et il sombre dans un sommeil lourd, sans entendre les bruits des respirations des autres hommes, ni le vacarme des moteurs qui passent à toute vitesse sur la chaussée de l’avenue.
Il y a combien de temps ? Trois mois, quatre, cinq peut-être ? Miloz sait que le temps a passé à cause de l’hiver qui a fini. Maintenant le soleil brûle sur les chantiers. Les hommes ont abandonné leurs vêtements chauds, sauf le Tunisien qui garde jour et nuit son bonnet de laine noire et son gros chandail. D’autres hommes sont venus. Miloz s’en est aperçu au chantier de construction. Il les a vus, sombres, groupés sous un auvent qui sert à entreposer les compresseurs et les marteaux-piqueurs. Deux jours après, il a traversé le chantier au moment de la pause du déjeuner et il s’est approché d’eux. Ce sont des gens du Maghreb, vêtus encore plus pauvrement qu’eux, et leurs visages sont inquiets, marqués par la fatigue. Miloz s’est approché d’eux, il a essayé de leur parler, en français, puis en italien. Il leur a dit plusieurs fois :
Читать дальше