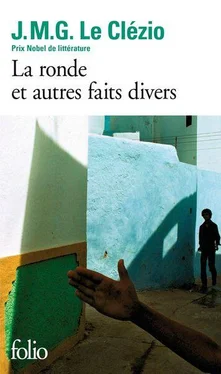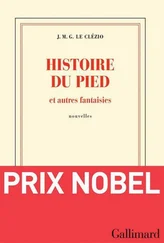« Vous êtes venus avec Tartamella ? »
Mais ils n’ont rien répondu. Peut-être qu’ils ne comprennent pas. Ils ont détourné leur regard, leur visage sombre a pris une expression encore plus inquiète, hostile. Miloz est retourné vers l’autre bout du chantier. Le contremaître a immédiatement donné le signal du travail, sans leur laisser le temps de manger. Le lendemain, quand l’homme barbu a fait l’appel de ceux qui iraient au chantier, Miloz n’a pas entendu son nom. Pendant trois jours il est resté enfermé dans le sous-sol, sans sortir, et le quatrième jour, on l’a conduit à un autre endroit, dans une montagne pelée où l’on creusait une carrière. La pluie avait transformé le cratère en lac de boue, et tout le jour il a étalé à la pelle les montagnes de boue que crachait la motopompe. Puis, quand le soleil est revenu, on l’a mis au pied de la falaise, avec d’autres hommes, un marteau-piqueur à la main, et ils creusaient tout le jour la pierre blanche éblouissante. La nuit ils dormaient dans une roulotte de tôle posée sur des pierres, à l’entrée de la carrière. La carrière était fermée par une clôture de fil de fer barbelé, dont le portail était condamné la nuit par un cadenas. Il y avait aussi un grand chien-loup enchaîné, qui courait attaché à la clôture par un mousqueton passé dans un fil de fer.
Ici, l’on ne voyait plus Tartamella, ni l’homme barbu du sous-sol de la villa. Les hommes qui travaillaient dans la carrière étaient tous étrangers, des Maghrébins à la peau brûlée par le froid et le soleil, vêtus d’indescriptibles haillons, ils étaient sombres et muets, et chaque fois que Miloz avait voulu engager la conversation avec eux, ils avaient détourné la tête sans répondre. Peut-être qu’eux ne comprenaient pas, ou bien qu’ils étaient devenus muets à force de vivre dans la carrière. Les seuls qui venaient de l’extérieur étaient les conducteurs de camions-bennes, et les hommes qui apportaient les gamelles de nourriture aux prisonniers, et qui fermaient le portail et accrochaient la chaîne du chien au fil de fer le long de la clôture. Mais ceux-là étaient aussi sombres et taciturnes que les ouvriers prisonniers de la carrière. Peut-être qu’ils étaient prisonniers eux-mêmes, dans leurs camions, et qu’ils ne pouvaient échapper au rôle qui leur était assigné. Quelquefois, le soir, un des hommes écoutait la radio, sur un vieux poste à transistors en plastique blanc, qui crachotait et envoyait par vagues une étrange musique nasillarde dont personne ne savait ce qu’elle signifiait.
Couché sur le sac de couchage encrassé, la tête appuyée contre la paroi de la roulotte, Miloz écoutait la musique grésillante en pensant à Lena, à la montagne, au village, à ses parents et à ses amis. Mais c’était si loin à présent que c’était devenu une sorte de rêve, irréel et vague, où les êtres et les choses pouvaient se modifier à chaque instant. Seuls les yeux de Lena brillaient d’un éclat fixe, sombres, profonds. Ils le regardaient de l’autre côté de l’espace, l’appelant. Miloz pensait au jour où il pourrait enfin partir, il pensait au long voyage de retour, à l’argent qu’il apporterait pour le mariage. Mais la fatigue l’écrasait avant la fin de son rêve, et il s’endormait avant même d’avoir entendu la chanson nasillarde du poste de radio.
Les jours sont passés ainsi, prisonniers du trou blanc de la carrière calcaire, dans le fracas des marteaux-piqueurs et du concasseur qui transformait la pierre en gravillons pour les jardins des villas et pour le revêtement des routes. Miloz ne sait plus depuis combien de temps il vit là, dans la roulotte aux parois de tôle qui sent la sueur, le tabac et l’urine, sans parler, sans penser, s’arrêtant de creuser la pierre pour manger le ragoût tiède qu’apportent les chauffeurs des camions, et le soir pour dormir écrasé de fatigue. Ce n’est que lorsque le froid revient, après la chaleur brûlante des mois de l’été, et quand les orages éclatent de l’autre côté des montagnes, qu’il compte qu’une année entière s’est écoulée. Il en ressent alors une angoisse très grande, comme s’il découvrait tout à coup qu’il a peu à peu été entouré d’abîmes, une angoisse qui l’oppresse jour et nuit, qui l’empêche de dormir. Cela est venu si brusquement qu’il n’a pas compris au début ce qui serrait sa gorge et son cœur, et rendait ses jambes faibles, et il a cru qu’il était tombé malade. Mais, un soir, couché sur le sac de couchage dans l’obscurité lourde de la roulotte, écoutant au-dehors le bruit du vent sur la pierre, le bruit de la chaîne du chien-loup courant le long de la clôture de barbelés, écoutant au-dedans le bruit régulier des respirations d’hommes endormis, et le crépitement léger d’une cigarette qui s’embrasait par moments dans l’ombre, à l’autre bout de la roulotte, il comprend : il a peur de mourir là, maintenant, demain, un jour, bientôt, de mourir prisonnier de cette carrière, sans être revenu jusqu’à Lena, sans l’avoir revue. L’angoisse de la mort est si grande alors qu’il ne peut plus la contenir. Il serre les dents si fort que ses tempes et les muscles de son cou ont mal, et il sent les larmes qui, malgré lui, coulent de ses yeux, mouillent ses joues et ses lèvres. Il crie, d’un cri contenu, un grognement de porc, ou de chien malade, c’est cela qu’il pense malgré lui, et ses poings serrés frappent le sol de la roulotte, les parois de tôle qui résonnent. Les hommes se sont réveillés, mais ils ne disent rien, assis sur leurs sacs de couchage dans le noir, même celui qui fumait a cessé de tirer sur la cigarette. Ils écoutent sans bouger, sans parler, respirant doucement, ils attendent. Les coups de poing cognent sur les parois de tôle, renversent une bouteille, ou une gamelle, frappent le sol, de plus en plus fort, de plus en plus vite, puis ils s’espacent, ils se fatiguent, et tout d’un coup on n’entend plus que la respiration haletante, brouillée de sanglots, et la voix enragée du grand chien qui court le long de la clôture. Puis le silence revient peu à peu, à l’intérieur de la roulotte de tôle. Les hommes se sont à nouveau étendus sur leurs sacs de couchage, et leurs yeux grands ouverts scrutent le noir impénétrable.
C’est cette nuit-là que Miloz a décidé de s’enfuir. Il n’en a pas parlé aux autres, mais sans qu’il sache comment, les hommes ont compris, et ils ont voulu venir avec lui. Le matin, quand le contremaître est arrivé dans le premier camion, les hommes ne se sont pas levés. Ils sont restés assis par terre, dans la lumière du soleil levant, et ils avaient mis sur eux tous leurs vêtements, et leurs sacs étaient posés à côté d’eux. Miloz avait sa valise en carton bouilli, déchirée sur le couvercle, et lui était debout, parce que c’est lui qui devait parler. Le contremaître a tout vu du premier coup d’œil, et il n’est pas descendu du camion. Il a même laissé le moteur tourner, pour pouvoir faire marche arrière si les choses devenaient menaçantes. Quand Miloz s’est approché pour demander l’argent qu’on leur devait, il n’a pas répondu tout de suite, comme s’il réfléchissait. Puis il a parlé, à voix un peu étouffée, pour n’être entendu que de Miloz. Il a parlé du contrat, qui était pour deux ans, et il a promis que tout le monde serait payé, et que lui, Miloz, pourrait prendre un camion, qu’il deviendrait contremaître, et qu’il retournerait habiter en ville. Les hommes restaient immobiles, assis sur les tas de cailloux, avec leurs baluchons posés à côté d’eux comme s’ils attendaient le train.
Quand le contremaître a compris qu’ils ne bougeraient plus, il a enclenché la marche arrière, et il a reculé brutalement, en laissant le portail grand ouvert. Miloz a entendu le bruit du moteur décroître dans la vallée, puis tout est redevenu silencieux. Le ciel était tendu, d’un bleu intense, et le vent froid soufflait. Mais les hommes sont restés assis dehors, sans bouger, sauf de temps en temps pour aller boire ou uriner. Ils ne parlaient pas, et Miloz regardait avec curiosité, haine et admiration leurs visages sombres et impassibles. Ce n’était pas de lui que le contremaître avait eu peur, mais d’eux, de leur force sans espoir. Toute la matinée, ils sont restés assis sur les pierres, regardant le portail grand ouvert que les rafales de vent faisaient battre en grinçant. Le chien-loup était comme eux, il dormait les yeux ouverts, au pied de la clôture.
Читать дальше