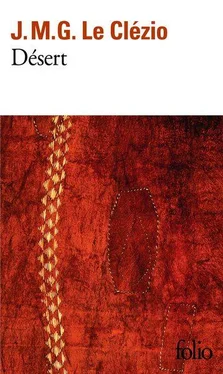« Oh ! »
Elle lui montre du doigt un point noir immobile au centre de l’espace. Le Hartani regarde un instant dans la direction du point, et il fait avec la main le signe de l’oiseau, index replié, les trois derniers doigts écartés comme les plumes de l’oiseau. Le point glisse lentement au centre du ciel, il tourne un peu sur lui-même, il descend, il s’approche. Maintenant, Lalla distingue bien son corps, sa tête, ses ailes aux rémiges écartées. C’est un épervier qui cherche sa proie, et qui glisse sur les courants du vent, silencieusement, comme une ombre.
Lalla le regarde longtemps, le cœur battant. Elle n’a jamais rien vu d’aussi beau que cet oiseau qui trace ses cercles lents dans le ciel, très haut au-dessus de la terre rouge, seul et silencieux dans le vent, dans la lumière du soleil, et qui bascule par moments vers le désert, comme s’il allait tomber. Le cœur de Lalla bat plus fort, parce que le silence de l’oiseau fauve entre en elle, fait naître la peur. Son regard est fixé sur l’épervier, elle ne peut pas l’en détacher. Le terrible silence du centre du ciel, le froid de l’air libre, surtout la lumière qui brûle, tout cela l’étourdit, creuse un vertige. Elle appuie sa main sur le bras du Hartani, pour ne pas tomber en avant vers le vide. Lui aussi regarde l’épervier. Mais c’est comme si l’oiseau était son frère, et que rien ne les séparait. Ils ont le même regard, le même courage, ils partagent le silence interminable du ciel, du vent et du désert.
Quand Lalla s’aperçoit que le Hartani et l’épervier sont semblables, elle frissonne, mais son vertige cesse. Le ciel devant elle est immense, la terre est une buée grise et ocre qui flotte à l’horizon. Puisque le Hartani connaît tout cela, Lalla n’a plus peur d’entrer dans le silence. Elle ferme les yeux, elle se laisse glisser dans l’air, au milieu du ciel, accrochée au bras du jeune berger. Lentement, ensemble, ils tracent de grands cercles au-dessus de la terre, si loin qu’on n’entend plus aucun bruit, rien que le froissement léger du vent dans les rémiges, si haut qu’on ne voit presque plus les rochers, les buissons d’épines, les maisons de planches et de papier goudronné.
Puis, quand ils ont longtemps volé ensemble, et qu’ils sont tout ivres de vent, de lumière et de bleu de ciel, ils reviennent vers la bouche de la grotte, en haut de la falaise rouge ; ils se posent légèrement, sans faire rouler une pierre, sans faire bouger un grain de sable. Ça, ce sont les choses que sait faire le Hartani, comme cela, sans parler, sans penser, rien qu’avec son regard.
Il connaît toutes sortes d’endroits où on peut voir les lumières, parce qu’il n’y a pas seulement une lumière, mais beaucoup de lumières différentes. Au début, quand il conduisait Lalla à travers les rochers, dans les creux, vers les vieilles crevasses asséchées, ou bien en haut d’un roc rouge, elle croyait que c’était pour aller chasser les lézards ou pour piller les nids des oiseaux, comme font les autres garçons. Mais le Hartani lui montrait alors, en tendant la main, les yeux brillants de plaisir, et au bout de son geste, il n’y avait rien que le ciel, immense, éclatant de blancheur, ou bien la danse des rayons de soleil le long des cassures de pierre, ou encore ces espèces de lunes que fait le soleil à travers le feuillage des arbustes. Quelquefois aussi il montrait les moucherons suspendus dans l’air, pareils à des bulles entre deux touffes d’herbe, comme s’il y avait eu une immense toile d’araignée. Ces choses étaient plus belles quand il les regardait, plus neuves, comme si personne ne les avait regardées avant lui, comme au commencement du monde.
Lalla aime suivre le Hartani. Elle marche derrière lui, le long du sentier qu’il ouvre. Ce n’est pas exactement un sentier, parce qu’il n’y a pas de traces, et pourtant, quand le Hartani s’avance, on voit que c’est bien là qu’est le passage, et pas ailleurs. Peut-être que ce sont des sentiers pour les chèvres et pour les renards, pas pour les hommes. Mais lui, le Hartani, il est comme l’un d’eux, il sait des choses que les hommes ne savent pas, il les voit avec tout son corps, pas seulement avec ses yeux.
C’est comme pour les odeurs. Quelquefois le Hartani marche très loin sur la plaine de pierres, dans la direction de l’est. Le soleil brûle sur les épaules et sur le visage de Lalla, et elle a du mal à suivre le berger. Lui ne s’occupe pas d’elle alors. Il cherche quelque chose, presque sans s’arrêter, un peu penché vers le sol, bondissant de roche en roche. Puis tout d’un coup il s’arrête, et il met son visage contre la terre, à plat ventre comme s’il était en train de boire. Lalla s’approche doucement, tandis que le Hartani se relève un peu. Ses yeux de métal brillent de plaisir, comme s’il avait trouvé la chose la plus précieuse du monde. Entre les cailloux, dans la terre poudreuse, il y a une touffe verte et grise, un tout petit arbuste aux feuilles maigres comme il y en a tant ici, mais quand Lalla approche son visage à son tour, elle sent le parfum, faible d’abord, puis de plus en plus profond, le parfum des plus belles fleurs, l’odeur de la menthe et de l’herbe chiba, l’odeur des citrons aussi, l’odeur de la mer et du vent, des prairies en été. Il y a tout cela, et bien davantage, dans cette plante minuscule, sale et fragile, qui pousse à l’abri des cailloux au milieu du grand plateau aride ; et seul le Hartani le sait.
C’est lui qui montre à Lalla toutes les belles odeurs, parce qu’il connaît leurs cachettes. Les odeurs sont comme les cailloux et les animaux, elles ont chacune sa cachette. Mais il faut savoir les chercher, comme les chiens, à travers le vent, en flairant les pistes minuscules, puis en bondissant, sans hésiter, jusqu’à la cachette.
Le Hartani a montré à Lalla comment il faut faire. Autrefois, elle ne savait pas. Autrefois, elle pouvait passer à côté d’un buisson, ou d’une racine, ou d’un rayon de miel, sans rien percevoir. L’air est si plein de senteurs ! Elles bougent tout le temps, comme des souffles, elles montent, elles descendent, elles se croisent, se mélangent, se séparent. Au-dessus des traces d’un lièvre flotte l’étrange odeur de la peur, et un peu plus loin, le Hartani fait signe à Lalla d’approcher. Sur la terre rouge, d’abord, il n’y a rien, mais peu à peu, la jeune fille distingue quelque chose d’âcre, de dur, l’odeur de l’urine et de la sueur, et d’un seul coup elle reconnaît l’odeur : c’est celle d’un chien sauvage, affamé, au poil hérissé, qui courait à travers le plateau à la poursuite du lièvre.
Lalla aime passer les jours avec le Hartani. Elle est la seule à qui il montre toutes ces choses. Les autres, il s’en méfie, parce qu’ils n’ont pas le temps d’attendre, pour chercher les odeurs, ou pour voir voler les oiseaux du désert. Il n’a pas peur des gens. Ce serait plutôt lui qui ferait peur aux gens. Ils disent qu’il est « mejnoun », possédé des démons, qu’il est magicien, qu’il a le mauvais œil. Lui, le Hartani, est celui qui n’a pas de père ni de mère, celui qui est venu de nulle part, celui qu’un guerrier du désert a déposé un jour, près du puits, sans dire un mot. Il est celui qui n’a pas de nom. Quelquefois Lalla voudrait bien savoir qui il est, elle voudrait bien lui demander :
« D’où viens-tu’ ? »
Mais le Hartani ne connaît pas le langage des hommes, il ne répond pas aux questions. Le fils aîné d’Aamma dit que le Hartani ne sait pas parler parce qu’il est sourd. C’est en tout cas ce que le maître d’école lui a dit un jour ; cela s’appelle des sourds-muets. Mais Lalla sait bien que ce n’est pas vrai, parce que le Hartani entend mieux que personne. Il sait entendre des bruits si fins, si légers, que même en mettant l’oreille contre la terre on ne les entend pas. Il sait entendre un lièvre qui bondit de l’autre côté du plateau de pierres, ou bien quand un homme approche sur le sentier, à l’autre bout de la vallée. Il est capable de trouver l’endroit où chante le criquet, ou bien le nid des perdrix dans les hautes herbes. Mais le Hartani ne veut pas entendre le langage des hommes, parce qu’il vient d’un pays où il n’y a pas d’hommes, seulement le sable des dunes et le ciel.
Читать дальше