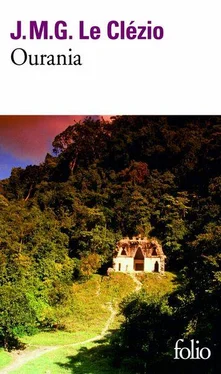« Je me rappelle, c'est l'heure douce. L'air est sec, et les nuages au-dessus des volcans font une couleur vive et violente. Mais c'est l'heure violette. C'est la première fois que je vois cette couleur, cela remplit les yeux et entre dans nos corps. C'est pour cette couleur que Hoatu m'a conduit jusqu'ici. Je la regarde sans oser bouger, et Hoatu passe sa main sur mes cheveux, sur ma joue. “Tu as la barbe douce, tu es vraiment un pipichu ! ” (Elle dit poussin en langage d'elmen, et de n'importe qui d'autre, cela m'aurait fâché.) Je me penche et j'appuie ma tête contre sa hanche et elle continue à me caresser avec le dessus de ses doigts, très doucement. Je ressens sa chaleur, elle se mélange à la chaleur des pierres noires, à la lumière violette dans le ciel. Tout à coup je ne tremble plus. Nous restons serrés l'un contre l'autre, jusqu'à la nuit.
« À un moment, je m'approche de son visage, les yeux fermés, guidé par la chaleur de son souffle. Dans l'obscurité, je vois avec mes mains, son corps, ses seins, son ventre, et elle guide mon sexe et elle m'enseigne à faire l'amour, lentement, elle s'est couchée sur l'herbe sèche et les cailloux, et je suis à genoux devant elle, lentement, la tête en arrière pour voir la nuit, dans la lueur de la lune qui arrive au bord des volcans, puis plus vite, respirant, buvant son souffle, la bouche pleine de ses cheveux et les yeux contre ses yeux clairs en cherchant jusqu'au fond d'elle.
« Quand nous avons fini de faire l'amour, nous sommes descendus vers Campos. La lumière de la lune cachait les étoiles. Au loin, la Vallée s'était éclairée, et cela ressemblait au ciel avec les constellations. Je voyais les lumières jaunes le long de la voie ferrée, les rubans rouges des voitures sur les routes, le grand globe laiteux qui flottait au-dessus des immeubles des banques et des assurances. Hoatu marchait vite malgré l'obscurité, et j'avais du mal à la suivre, je titubais dans les rochers. A Campos, tout était endormi. Seule brillait la lampe de Jadi, au travail dans la tour d'observation.
« Avant de retourner chez elle, Hoatu a mis sa main sur mes lèvres. Elle m'a dit : “Tu dois partir, Raphaël. Tu dois chercher l'aventure.”
« Je ne suis plus retourné avec elle dans la montagne. Depuis ce jour, Hoatu n'est jamais seule, elle travaille dans les champs, ou bien elle s'occupe des enfants. Quelquefois, je la vois passer avec Christian. Elle me sourit, mais elle ne m'adresse pas la parole.
« Au début, cela m'a fait mal, comme une trahison. Je ne pouvais pas comprendre. Quand j'apercevais Hoatu, même au loin, mon cœur battait vite. Je n'en ai parlé à personne, tu es le premier à qui je dis la vérité. Hoatu m'a montré l'herbe de la jalousie. C'est cela que j'avais dans le cœur, dans la gorge.
« Quand j'ai eu seize ans, j'ai quitté Campos, pour connaître le monde, et j'ai guéri de l'herbe qui m'étouf-fait. Il n'est resté que l'amour de Hoatu.
« C'est alors que je t'ai rencontré, ami Daniel. »
Moi aussi j'ai repris mon cahier de notes, sur lequel j'ai prévu d'écrire le compte rendu de ma route hypothétique à travers le Tepalcatepec. Mais au lieu de ces choses sérieuses, j'ai marqué :
quel chemin as-tu suivi depuis que tu t'es enfuie de cette Vallée égoïste et endurcie, cette ville de pouvoir et d'argent sur laquelle régnent les rois de la fraise et les propriétaires des usines de congélation ? Tous ces descendants des hacendados devenus politiciens, docteurs, notaires, notables, hommes de loi ou de religion. Ce sont eux qui te dévoraient, chaque jour, chaque nuit, ils mangeaient ta pauvreté, ils rongeaient ton cœur, ils buvaient ton sang, ton souffle. C'est ce qu'ils font depuis des siècles, aux filles des montagnes, aux enfants des banlieues de la mégapole, sans se lasser, sans se repentir. Ils n'en ont jamais assez, il leur faut toujours du sang neuf, de la chair fraîche.
Et moi j'ai été pareil à eux, même si je ne l'ai fait qu'en rêve. Je me joignais à eux, non pas en riant ou en braillant des chansons à boire, mais en me glissant par la pensée au plus près de toi, dans le secret de ta vie. Pas même dans une chambre d'hôtel, mais au jardin Atlas, dans l'alcôve crasseuse aux murs peints en vert, à l'abri d'un rideau mille fois tiré, accroché au mur par un fil de fer entortillé autour de deux clous rouilles, le rideau que les planteurs de pois chiches et d'oignons ont écarté à chaque fois et qui s'est imprégné de leur odeur. Toi tu attendais assise sur le lit, tu fumais, tu avais bu. Sur tes lèvres j'ai senti l'odeur de l'alcool mêlée à l'odeur de ta peau, ce parfum de savonnette Dial que tu utilises, et qui me trouble comme l'odeur d'un bébé.
Ton corps, dont je rêve maintenant qu'il est trop tard, maintenant que tu as disparu. Ton corps aux formes indécises, empâtées encore par l'enfance, mais déjà usé à force d'avoir été vu, touché, connu. Ta peau, la couleur de ta peau, le grain très lisse et doux sur tes épaules, sur tes cuisses, ton ventre tendre un peu gonflé au-dessous du nombril, et le bouton du nombril un peu saillant, comme chez les enfants pauvres, attirant, pareil à un œil au centre de ton corps, et les marques sur ton ventre, les cicatrices, les plis, mais rien qui révèle l'histoire de ta vie, la violence de ton père, les incursions, les violations, les maladies aussi, l'avortement fait à la hâte par la vieille curandera que tu appelles ta grand-mère, la racine très amère qui a vidé ton ventre, qui a creusé un trou dans ton corps et tu as manqué mourir. Tes mains, non pas des mains déjeune fille longues et élégantes, mais tes mains de femme, endurcies par le travail, usées par la main de mortier qui broie le maïs sur la pierre de lave, tes paumes qui claquent chaque matin la pâte pour former les tortillas bleues. Et ton corps courbé sur l'âtre, ton dos large et sombre tel que sur les tableaux de Diego Rivera, fendu dans toute la longueur par l'épine dorsale, un trait sombre qui part de l'implantation de tes cheveux sur la nuque et descend jusqu'aux reins, et de chaque côté des fesses, les poinçons, et la marque, le nuage rouge qui dit que tu es indienne, que tu le resteras, et après toi tes enfants et tes petits-enfants si Dieu t'en donne la chance. C'est cette marque que tu avais voulu cacher, en te faisant faire ce tatouage du lapin célèbre, dont s'étaient moqués Saramago et Garci Lazaro.
Je crois que je n'ai jamais haï personne autant que cet Iban surnommé le Terrible (un surnom bien littéraire, dont je soupçonne le notaire Trigo d'être l'auteur). Maquereau, geôlier, tortionnaire, dont l'empire s'étend sur toute la Zone. Je le hais, même si je ne l'ai jamais vu autrement que sur la photo qu'Ariana m'a donnée, prise par Garci au jardin Atlas. Iban, son chapeau de cow-boy rejeté en arrière, sa figure épaisse de paysan enrichi, ses cheveux bouclés collés sur son front par la sueur, ses petits yeux et son gros nez, son menton, son sourire sûr de lui et dominateur.
Ce que je vois de lui surtout, c'est sa main, une main large, sombre, aux doigts boudinés, l'index portant une bague en onyx, cette main qui s'appuie sur le bras de Lili et la maintient à sa merci. Son bras gauche posé en travers du ventre de Lili, sous ses seins, portant au poignet une montre que j'imagine en or, dont le cadran reflète la lumière au point que je ne puis distinguer l'heure. Il la tient, elle ne peut pas s'échapper.
Elle s'est déjetée un peu en arrière, assise sur le bord de la chaise en plastique. Son corps est pareil à une offrande, à un animal de sacrifice. Son ventre, ses cuisses, la ridicule jupe en plastique argentée, si courte qu'elle laisse voir la pointe de sa culotte. Son torse serré dans un boléro, sa poitrine douce. Elle a les deux mains jointes sur le côté, appuyées sur le rebord d'une table, et pour ne pas glisser elle a calé ses pieds sur la barre basse de la chaise en les bloquant par les talons de ses sandales à lanières.
Читать дальше