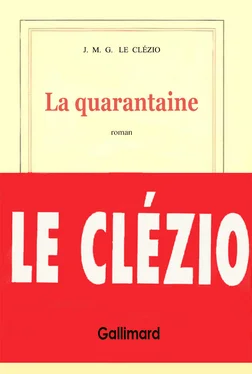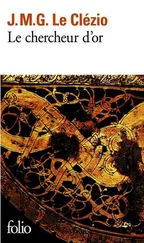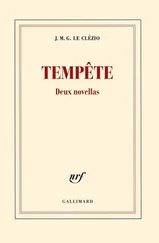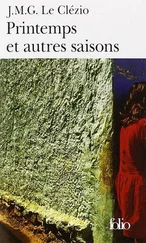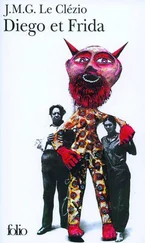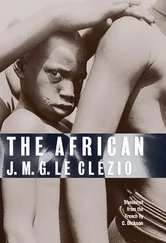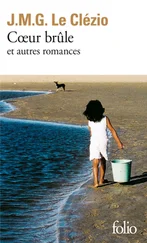Du 29 mai, après-mid i
Le mauvais temps, les difficultés ont retardé la reconnaissance. Côte sud-ouest (baie du cimetière).
L’exposition aux vents et aux rafales réduit la végétation proche de la mer aux rampantes, aux batatrans, aux chiendents. Aux approches du volcan: filices et graminées.
Colonies de moreae: Ficus rubra (herbe la fouche) et Cassythia filiformis, liane sans fin (bonne description puisque j’en ai suivi une de près de douze pieds, rampant entre les tombes). Andropogon schœnanthus plus commun le long de la plage, ou dans les affleurements coralliens. Aussi: Andropogon nardus, le fameux nord indien, forte odeur de gingembre.
Dans les crevasses, assez nombreux spécimens d’Adiantum (caudatum, hispidulum). La première variété plus nombreuse, reconnaissable par ses feuilles plus larges, couvertes d’un duvet urticant. L’absence d’arbres l’oblige à ramper dans les fissures du sol.
À l’abri du talus et de la baie, beaux pandanus (vacoas) dont un P. vandermeeschii, qui atteint à Bourbon 20 pieds de haut, ici sept seulement. La variété utilis, assez fréquente sur la côte nord-ouest, comme j’ai pu le constater en débarquant. Peut être cultivée par les immigrants, pour la fabrication de sacs et de sandales.
Maintenant, je n’y prête plus vraiment attention. Une semaine, deux, peut-être davantage. Il n’y a pas un mois. Cela suffit pour s’habituer à l’insupportable. Je vais toujours en haut du volcan, le soir plutôt, pour me nourrir de la rumeur douce du village des coolies, pour respirer l’odeur des fumées. J’ai abandonné déjà le projet de reconstruire la chambre du phare. À quoi bon? Il est en effet plus utile de réparer la digue. Ceux qui le font doivent savoir que la chaloupe des services de santé viendra un jour s’y amarrer.
Je viens voir le village de Palissades pour me souvenir. Tout ce que Jacques me racontait, autrefois, dans l’hiver de Rueil-Malmaison. La nuit qui tombe sur la maison d’Anna, à Médine. Les mêmes bruits, les mêmes odeurs. Le soleil oblique sur les cannes, les cris des laboureurs qui rentrent, qui poussent des sortes d’aboiements, «aouha!», les femmes avec leurs houes en équilibre sur la tête, les éclats de voix, les rires des enfants. Les hautes cheminées des sucreries dans la brume, comme des châteaux barbares. Au crépuscule, le fracas de la mer jaune contre la côte noire, là où se casse la ligne des récifs. Je ne savais pas que c’était au fond de moi, si vrai, si fort. Comme si je l’avais vraiment connu, une douleur, le souvenir d’un rêve, qui me fait du bien et du mal. Ainsi, c’est de cela que je suis fait: l’étendue vert-de-gris des cannes où sont ployés les coolies, les pyramides de pierres que les femmes ont construites une à une, les doigts écorchés par la lave et les yeux brûlés par le soleil. L’odeur du vesou, l’odeur âcre et sucrée qui pénètre tout, qui imprègne le corps des femmes, leurs cheveux, qui se mêle à la sueur. Palissades est le recommencement. C’est pour cela que Jacques et moi nous avons frissonné, le premier matin, quand le sifflet du sirdar a troué la nuit.
Le matin, après le thé noir versé de la marmite dans le quart de fer-blanc cabossé, sans attendre le riz réchauffé que préparent Suzanne et Sarah Metcalfe, je rejoins John qui herborise le long du rivage. Lui ne se sent pas prisonnier. Depuis le jour de notre débarquement, il récolte les feuilles, les fleurs, les graines, qu’il met à sécher avec soin au soleil sur des claies, après les avoir enduites de formol à l’aide d’un petit pinceau. Il cherche avec obstination la présence de l’herbe à indigo. Il est persuadé que l’endroit serait idéal pour commencer une plantation, qui permettrait une amélioration des conditions de vie des immigrants en quarantaine.
Je marche le long de la plage, en sautant d’un rocher à l’autre. L’intérieur est envahi de broussailles et de chiendent. À certains endroits les herbes sont si hautes qu’on y disparaît jusqu’à la taille. Tout le long du rivage, la plage est recouverte de cette sorte de rampante grasse à larges feuilles, à petites fleurs rouges, que le vieux Mari appelle batatran, et John ipomée. C’est une plante qui se casse en produisant un lait transparent, légèrement collant Là où elle pousse, rien d’autre n’a le droit de vivre. Je retrouve John à la pointe nord, exactement en face du rocher du Diamant. C’est le nom que j’ai donné à cette pyramide de lave qui émerge de l’Océan, mais John m’a dit que, sur la carte de l’Amirauté, le nom véritable était Pigeon House Rock, le Pigeonnier. En fait de pigeons, il y a surtout des mouettes et des goélands qui entourent le rocher d’un tourbillon permanent et le blanchissent de guano. Le bruit des ailes des oiseaux et les cris gutturaux qu’ils poussent recouvrent le grondement de la mer sur les récifs. Dans la lumière du matin, les embruns étincellent. J’imagine l’éruption du volcan qui a rejeté cet énorme caillou au milieu de la mer, il y a des millions d’années, quand Maurice est sortie des profondeurs de l’Océan.
Je laisse John Metcalfe à la recherche de l’improbable indigotier sauvage auquel il voudrait donner son nom, et je regarde le Diamant, à l’abri du vent dans un creux de rocher. La mer jaillit en fusées verticales, allume des arcs-en-ciel. Je reste des heures, sans bouger, simplement à regarder la mer, à écouter les coups des vagues, à goûter au sel jeté par les rafales de vent. Ici, il me semble qu’il n’y a plus rien de tragique. On peut oublier les sifflets lugubres du sirdar qui commande aux hommes d’aller manger, ou qui rythme les chutes des blocs de lave sur le chantier de la digue. On peut même oublier les malades enfermés dans le dispensaire, la fièvre qui sèche leurs yeux et leurs lèvres, et, en face, la silhouette noire de Gabriel, qui attend.
Malgré les nuages, le soleil brûle au centre du ciel. John Metcalfe est retourné à la Quarantaine, avec sa provision de feuilles et de racines. Aidé de Sarah, il va passer le reste du jour à trier, cataloguer. Il se plaint de maux de tête et de courbatures. Jacques pense qu’il est impaludé depuis la première nuit à Palissades. Nous avons échappé aux moustiques en dormant devant la porte, dans les rafales de vent.
En revenant vers le Diamant, à la fin de l’après-midi, j’ai vu pour la première fois celle que j’ai appelée ensuite Suryavati, force du soleil. Est-ce vraiment son nom? Ou est-ce le nom que je lui ai trouvé, à cause de la reine du Cachemire, à qui fut racontée l’histoire de Urvashi et Pururavas, dans le livre de Somadeva, traduit par Trelawney, que je lisais à Londres, l’été qui a précédé notre départ? Elle avançait le long du rivage, un peu penchée en avant, comme si elle cherchait quelque chose, et de là où j’étais, sur l’embarcadère, en face de l’îlot Gabriel, j’avais l’impression qu’elle marchait sur l’eau. Je voyais sa silhouette mince, sa longue robe verte traversée par la lumière. Elle avançait lentement, avec précaution. J’ai compris qu’elle marchait sur l’arc des récifs qui unit Plate à Gabriel à marée basse. Elle tâtait du bout du pied, comme en équilibre au sommet d’un mur invisible. Devant elle, il y avait la profondeur sombre du lagon, et de l’autre côté, la mer ouverte qui déferlait, jetant des nuages d’embruns dans le ciel.
Sans doute m’avait-elle vu. Mais elle n’avait pas tourné la tête. Je me suis assis dans le sable, à demi caché par les touffes de batatran. Je la regardais continuer le long du récif, au milieu de l’eau, j’avais l’impression qu’elle allait vers la haute mer. Il n’y avait personne, le vent avait chassé les oiseaux de l’autre côté de l’île, à l’abri de la pointe. C’était comme si nous étions les derniers habitants.
Читать дальше