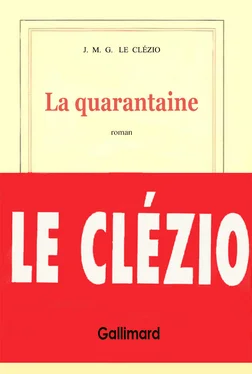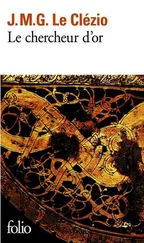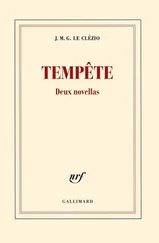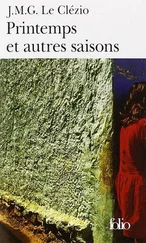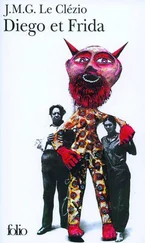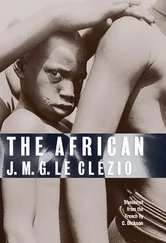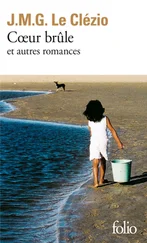Je n’oublierai jamais nos premiers pas sur Plate, le long de la baie des Palissades, vers le campement des coolies. La nuit avait commencé à tomber, avancée par les nuages qui captaient les derniers rayons du soleil. La baie des Palissades fait face à l’ouest, et je pouvais voir le ciel embrasé à travers les fissures des nuages, et la mer couleur de lave, étincelante et tumultueuse. «Un paysage de fin du monde», avait murmuré Jacques.
Les immigrants avaient atteint le village et s’étaient installés dans les cases. Le sirdar vint à notre rencontre. Il était accompagné d’un viel Indien nommé Mari. Le sirdar affectait de ne pas parler l’anglais (c’est du moins ce que dit Julius Véran en aparté) et par le truchement de Mari nous expliqua qu’il était trop tard pour nous installer dans le quartier européen de la Quarantaine, de l’autre côté de l’île. Il nous indiqua la hutte où nous devrions passer la nuit, une simple cabane de planches en bordure du campement. Le village coolie est composé de douze cases communes, séparées par une rue de sable, distantes à peu près de trois mètres l’une de l’autre. Les couples mariés et les femmes seules occupent les premières cases, et les hommes célibataires le bout du village.
Au-delà, vers l’autre extrémité de la baie, commencent les habitations des parias.
Nous étions épuisés. Jacques et Suzanne s’étaient couchés sur le sol, la tête appuyée sur leurs sacs mouillés d’eau de mer, sans même prendre la peine de faire sécher leur contenu. Le vieux Mari apporta de la nourriture. La plupart des passagers refusèrent de manger le riz séché arrosé de bouillon de poisson. Pour ma part, je mangeai avec appétit. Malgré la tempête qui continuait à souffler, l’air dans notre hutte était étouffant, lourd et humide comme dans la cale d’un navire. Le vieux Mari avait laissé en partant une lampe à huile qui trouait l’obscurité, éclairant fantastiquement les visages des occupants de la hutte. Quand nous sommes entrés dans la hutte, un homme couché sur sa natte s’était relevé à demi, appuyé sur ses coudes. La lampe tempête avait éclairé son visage maigre, ses yeux brillants. Peut-être qu’il avait parlé d’une voix rauque et douce, dans sa langue, pour me poser une question. Puis il s’est recouché.
Toute la nuit, nous nous sommes relayés pour surveiller les sacs. Jacques avait peur qu’on ne lui vole ses instruments. Il fallut bien accompagner Suzanne jusqu’aux latrines, en haut du camp, une longue cabane de planches abritant de simples trous creusés dans la terre, dans une odeur pestilentielle, à laquelle nous décidâmes de préférer les champs voisins.
Au milieu de la nuit, le vent cessa et il se mit à faire si chaud que nous n’arrivions plus à dormir. L’odeur qui se dégageait du sol et des murs, une odeur de suie et de sueur, rendait Jacques malade. Sans faire de bruit (car déjà pesait sur nous l’autorité du sirdar) nous emportâmes les sacs jusqu’à la porte, pour coucher dans le courant d’air. Par moments, des rafales de pluie nous mouillaient, mais c’était délicieux. De plus, le vent chassait les moustiques qui avaient commencé à nous manger au fond de la cabane. C’est là que nous dormîmes, enlacés tous les trois sous un grand châle de Suzanne qui faisait office de drap, en entendant les sifflements du vent dans les broussailles, le grondement continu des vagues sur la plage de basalte.
Avant de m’endormir, à la lueur vague de la lampe posée près de la porte, je vis la silhouette de Jacques, appuyé contre son sac, le visage tourné vers le dehors, comme s’il cherchait à voir le ciel. J’entendis les mots qu’il disait à Suzanne, comme on parle à une enfant pour l’endormir, des mots absurdes: «Demain, tu verras, on viendra nous chercher, le bateau nous mènera à Maurice, nous serons à Anna pour la nuit.» Peut-être qu’il rêvait tout haut. Suzanne n’a pas répondu.
JOURNAL DU BOTANISTE
Du 28 mai au matin
Sorti de bonne heure afin d’éviter la chaleur. Sol aride et caillouteux autour de la Quarantaine, diverses variétés de chiendent, toutes endémiques. Graminées: quelques exemples de Panicum maximum (fataque) et Stenotaphrum complanatum (gros chiendent), toutes deux bonnes herbes à fourrage.
Chardons (argémone) et une épineuse dont j’ai eu des exemples à Mahé: Malvastum (la mauve) que les Noirs appellent herbe balié (herbe à balai). Sida rhombifolia, autre variété d’herbe à balai, celle-ci sans épines.
Pour la plus grande part, ce côté de l’île semble le domaine de Zoysia pungens, tige résistante, feuilles à bords coupants. Sol pauvre, sable volcanique et calcaire.
Vers la pointe la plus au nord, recueilli un exemple de citronnelle, Andropogon schœnanthus. Parfum très puissant. Sachant le bien qu’on en tirerait, j’ai recueilli un brin muni de ses radicelles.
Sur Plate, le ciel, la mer, le volcan et les coulées de lave, l’eau du lagon et la silhouette de Gabriel, tout est magnifique. L’île n’est qu’un seul piton noir émergeant de la lueur de l’Océan, un simple rocher battu par les vagues et usé par le vent, un radeau naufragé devant la ligne verte de Maurice. Pourtant, aucun endroit ne m’a semblé aussi vaste, aussi mystérieux. Comme si les limites n’étaient pas celles du rivage, mais, pour nous qui étions pareils à des prisonniers, au-delà de l’horizon, rejoignant le monde du rêve.
Dès le lendemain matin, nous avons marché à travers l’île jusqu’aux quartiers réservés aux passagers européens, les bâtiments de la Quarantaine pompeusement appelés hôpital, maison du superintendant, dépôt, etc. En tout une demi-douzaine de maisons construites en blocs de lave cimentés. À notre arrivée, nous avons trouvé un logement non moins précaire que dans le village des coolies, à Palissades: pas de meubles, éclairage à la bougie ou à la lampe punkah, latrines rudimentaires envahies par les broussailles. La seule eau disponible provenait d’une citerne crevassée habitée par les blattes et les larves de moustiques. Du moins bénéficions-nous ici de l’exposition au vent, et de la solitude de la côte est, ce qui, après l’étouffement de la nuit à Palissades, nous paraissait, à Jacques et à moi, un luxe extraordinaire. Nous étions six dans le logement principal; outre Jacques, Suzanne et moi, il y avait le couple Metcalfe, qui devait enseigner au collège anabaptiste de Beau-Bassin, un ancien inspecteur des Postes nommé Bartoli, et l’inénarrable Julius Véran. Deux hommes avaient été débarqués avant nous et emmenés directement au bâtiment de l’infirmerie situé près de la jetée, face à l’îlot Gabriel. Il s’agissait d’un passager, M. Tournois, et d’un homme d’équipage nommé Nicolas, tous deux embarqués illégalement à Zanzibar, et si gravement malades que les autorités sanitaires de Port-Louis avaient refusé au commandant Boileau la libre pratique. Jacques, qui a vu de près le marin Nicolas, m’a confié qu’il présentait tous les symptômes de la variole confluente.
Julius Véran est le type même du mauvais compagnon de voyage, celui qu’on préférerait éviter. Je l’ai croisé tous les jours sur le pont, à bord de l ’Ava, depuis notre départ de Marseille. C’est un homme d’une cinquantaine d’années, un peu bellâtre, avec une épaisse moustache, des cheveux noirs coupés court, l’air d’un sous-officier de la garde, ou d’un maquignon. Sa mauvaise réputation s’est répandue sur le bateau et l’a rendu caricatural. Joueur, coureur de jupons, hâbleur et escroc, il semble qu’il ait été pressé de quitter la France à la suite de mauvaises affaires. Il se dit négociant, se rendant à Port-Louis pour y monter un import de vins français. Jacques a détesté tout de suite ses grands airs, sa politesse excessive avec les dames, sa façon de baiser la main de Suzanne. Il l’a surnommé M. Véran de Véreux. Le fait qu’il se soit lié avec Bartoli — l’homme que l’on soupçonne d’être l’espion des Postes qui a rapporté notre escale de Zanzibar aux autorités britanniques — n’a pas contribué à le rendre sympathique.
Читать дальше