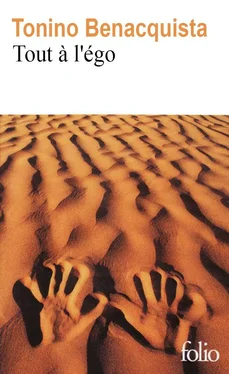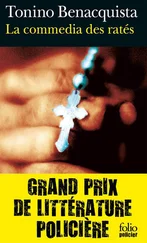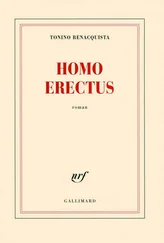J’ai voulu m’endormir pour chasser le regard de l’homme. Ses yeux obsédants de tristesse ne me laisseraient plus en paix pour le reste de mes jours. Au plus profond de la nuit, je me suis senti proche de lui. Si proche que j’ai cru l’entendre pleurer.
En ouvrant les yeux, de retour dans cette chambre infâme, j’ai compris qu’on pleurait vraiment, avec de vraies larmes, à quelques mètres de moi. J’ai tapé contre la cloison pour que ça cesse mais ça n’a servi à rien.
Pleurnicheries, jérémiades…
J’ai trouvé cette douleur incongrue, exagérée, et même ridicule au regard de toutes celles qui saignent le monde. De toute façon, ça ne me regardait pas et rien que je puisse faire ne pourrait l’atténuer. Rien.
Et puis, une seconde plus tard, j’ai pensé exactement l’inverse. J’ai pensé qu’il n’y avait pas de peine perdue, que le plus petit geste insignifiant pouvait à tout moment faire basculer les destins et rendre l’espoir. J’ai toqué à la porte voisine, personne ne m’a répondu. Une table s’est mise à brinquebaler, j’ai ouvert.
Il ne devait pas avoir plus de vingt-cinq ans. Debout sur la table, il fléchissait les jambes de façon grotesque pour ne pas heurter le plafond avec sa tête. La manière dont il se débattait pour nouer la cordelette autour de son cou sans cesser de geindre faisait peine à voir.
— Vous comptez vous suspendre à l’ampoule ? Un grand garçon comme vous ?
Honteux d’avoir été surpris, il s’est mis à chialer de plus belle.
— Quelle que soit votre douleur, vous la regretterez après vous être brisé le coccyx.
Deux minutes plus tard, il était assis dans son lit et moi sur une chaise, face à lui. J’ai pensé que le plus gros du travail était fait. Il s’est mis à parler dans un français impeccable malgré une pointe d’accent hispanisant.
— J’ai eu une journée épouvantable, il a dit.
— Ah oui… ?
— Ma vie est foutue. Mon père me harcèle pour que je rentre au pays, et il n’en est pas question. Il a beau être mourant, il est encore très riche et très puissant. Il serait capable de tout pour que je revienne. Il m’a envoyé ici pour faire mes études et maintenant je n’imagine plus vivre ailleurs. J’ai rencontré une jeune fille. Il ne veut pas en entendre parler, il dit que j’ai des responsabilités, que je ferai un mariage princier avec une femme du pays. J’ai envie de mourir !
— Je suis sûr que si vous lui parlez, il finira par comprendre. Ce n’est sûrement pas un mauvais homme. Vous ne pouvez pas lui faire ça, à la veille de sa mort.
— Comprendre, lui ? Mais vous ne vous doutez pas du monstre qu’il est ! C’est un despote ! Un vrai !
— Vous n’y allez pas un peu fort ?
— Pas du tout ! Il a envoyé des sbires à ma recherche, ce pour quoi je me retrouve dans ce petit hôtel minable ! Ils vont finir par m’avoir.
— Écoutez, vous êtes en état de choc, c’est normal de faire un peu de paranoïa, mais demain matin vous y verrez plus clair.
— Demain matin ie serai entre leurs mains, et dans moins d’une semaine je suis le chef d’État d’un pays à feu et à sang.
— Il n’est pas si puissant que ça, votre père. C’est un industriel ?
— C’est un despote, je me tue à vous le dire ! Il s’est élu président à vie de son pays où il fait régner la terreur, et il veut que je prenne sa succession.
— Où ?
— C’est une petite île au sud de la Caraïbe, vous ne connaissez sûrement pas, le San Lorenzo.
Dès qu’il a dit ça, j’ai eu envie de retourner dans ma piaule pour pleurer sous un couvre-lit jusqu’au petit matin.
— Vous avez choisi ce bled par hasard ou c’est vraiment pour me porter le coup de grâce ?
— Vous voulez que je vous montre mes papiers ? Mon visa ? Mon blason ?
J’ai essayé de rassembler mes esprits, ce qui m’a pris un temps fou et une énergie insoupçonnable à cette heure de ta nuit.
— C’est quoi votre nom ?
— Ernesto.
— Ernesto, vous allez sans doute trouver ca absurde, mais j’ai peut-être une solution.
— Ça m’étonnerait, ma vie est foutue.
— Vous avez entendu parler de José Famennes ?
— Jamais.
— Et de l’ambassadeur du San Lorenzo en France ?
— Lui, je le connais, il m’a fait inscrire à l’E. N. A. sans passer le concours.
— Parfait. Il s’envole dans moins d’une heure pour le San Lorenzo et vous le suivrez. Vous allez devenir un héros national. Mais je préfère vous expliquer tout ça dans le taxi, le temps nous est compté.
*
Le gosse, plus futé qu’il n’en avait l’air, a tout de suite compris le plan que j’avais en tête. Se précipiter au chevet de son père et lui demander la grâce de José Famennes contre la promesse de prendre sa succession à la tête du pays. En quarante-huit heures, il réinstaure la démocratie et le droit de vote ; un mois plus tard, il est élu à l’unanimité et épouse sa petite Française qui ne demandera pas mieux que de passer son temps à choisir la couleur des nappes dans les dîners officiels. Pour tout ça, il fallait que le taxi arrive avant le départ de l’ambassadeur. À moitié réveillé, le chauffeur de taxi ne se doutait pas du caractère historique de sa course.
— Vous me ferez l’honneur d’accepter mon invitation au San Lorenzo, Alain ?
J’allais le remercier avec enthousiasme quand le chauffeur, dans un geste rituel de petit matin, a allumé la radio. Le ciel était clair, déjà, et j’ai senti que la journée serait radieuse pour la terre entière.
« Nous venons d’apprendre que José Famennes vient d’être exécuté dans sa prison du San Lorenzo où il était détenu depuis trois ans. L’ambassadeur était sur le point de… »
J’ai demandé au chauffeur de couper la radio et de ralentir.
Je ne connaîtrai sans doute jamais de héros comme José Famennes. Le seul qui ne m’aurait pas refusé une interview. Que voulez-vous, en ce bas monde, certaines rencontres ne se font jamais.
LE 17 JUILLET 1994 ENTRE 22 ET 23 HEURES
Vous savez, vous, ce que vous faisiez le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures ? Non ? Moi non plus. Personne ne le sait.
— Il m’a fallu des années pour remonter jusqu’à toi, c’est dire si j’ai de la patience à revendre. Je n’en suis plus à une nuit près et je ne sortirai de ce bureau qu’avec tes aveux signés !
Pas la peine de hausser le ton, inspecteur. Cela fait partie de vos méthodes et de vos privilèges, je sais, mais ça m’empêche de réfléchir. Si vous aboyez, comment voulez-vous que je fouille dans mes souvenirs ? Seul le coupable sait ce qu’il faisait le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures. L’innocent l’a oublié depuis longtemps. Surtout si on lui pose la question.
— On y mettra le temps qu’il faudra mais tu parleras.
Si le soir du 17 juillet 1994 j’avais tué un type, je m’en souviendrais. Ces choses-là marquent. Le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures, je n’ai tué personne. De nos jours, l’erreur judiciaire a quelque chose de désuet. De honteux, presque. L’innocent que je suis pensait que la police avait fait des progrès, depuis le temps. Comme la médecine. À l’heure où l’on guérit deux cancers sur trois, on est en droit d’espérer que la police est capable de dépister deux innocents sur trois suspects. Le problème, c’est que pour l’instant votre seul suspect, c’est moi. Et je ne sais pas ce que je faisais le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures.
— J’ai des collègues tout frais derrière la porte, tu sais. Prêts à prendre la relève.
J’ai oublié 1994. Y a-t-il eu un été, cette année-là ? Je ne me souviens d’aucune touffeur nocturne. Ni du bonheur de l’eau glacée, ni des jupes courtes des femmes On ne œut pas me mettre en prison parce que je ne me souviens pas de cet été-là. Quel genre de type étais-je ? Un drôle de mec qui attendait l’avenir, en stand-by de sa propre existence, un passager qui s’ennuie durant le transit. Je n’ai rien pu faire d’extravagant ce jour-là entre 22 et 23 heures : je suis plutôt du matin. Le soir je ne suis bon à rien, je somnole. Personne ne peut compter sur moi, j’oublie tout. Comment voulez-vous que je sois assez vif pour assassiner quelqu’un ? Monsieur l’inspecteur, vous m’imaginez vous dire : le 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures, je somnolais . Je somnolais un soir d’été frileux d’une année inutile. Vous seriez déçu. J’y mets pourtant toute la bonne
Читать дальше