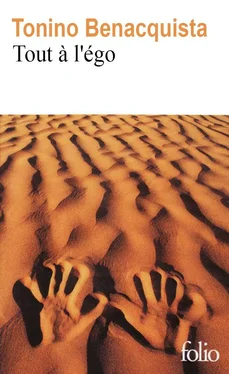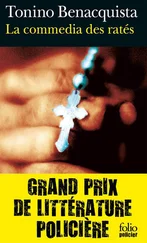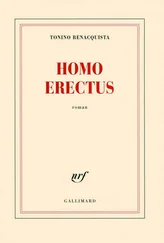— Il est là, avec sa pétition ! Tout est de sa faute ! Il ment, il est fourbe, ne le laissez pas s’échapper !
Baptiste, les yeux fous, a hurlé en me voyant, des verres ont commencé à voler, une bousculade générale a renversé les tables et un cataclysme a ravagé la salle. Une lame de fond d’une violence inouïe a submergé hommes et femmes, l’ivresse, la rage, la peur, et moi, seul, rampant sous les banquettes en essayant de survivre. Les gardes du corps de Ford ont sorti des revolvers et formé une sorte de carapace autour de lui, le climat de violence a redoublé d’un coup, et je ne sais pas ce qui m’a permis de tenir jusqu’à cette sortie de secours, sans doute l’image imprécise d’un demi-millier d’individus cherchant à me lyncher en place publique. Marlène, pourquoi m’as-tu trahi ? Nous aurions pu vivre quelque chose d’exceptionnel, toi et moi. Avec le temps, tu serais devenue moins frivole, nous aurions eu de merveilleux enfants, José, l’aîné, et Harrison, le petit. Nous aurions remplacé la vodka par la camomille, nous aurions construit un petit havre de paix, loin de Paris et de sa folie, loin du monde en marche. Marlène, tu étais sans doute mon destin, il n’a pas jugé bon de te le faire savoir. À bout de souffle, j’ai retrouvé l’air du dehors et me suis mis à courir comme un fou dans la nuit en me risquant çà et là dans des ruelles inconnues, puis j’ai grimpé dans un taxi qui devait avoir l’habitude de ce genre de situation.
— Où on va ?
Je lui ai donné l’adresse de 99.1, c’était sans doute le seul endroit au monde où j’avais une chance de sauver ma peau. J’ai même demandé au chauffeur de chercher la fréquence de la radio, histoire de prendre la température. J’ai entendu la voix de Bernard qui terminait l’édition de minuit.
« Pour des raisons encore inconnues, la discothèque le Wyatt a été mise à sac par plusieurs centaines de manifestants qui cet après-midi faisaient le siège de l’ambassade du San Lorenzo. Harrison Ford, en tournage à Paris, venait de se réfugier dans la discothèque après une vive altercation avec les manifestants. »
Quand je suis entré dans le studio, Bernard venait de lancer un disque de Charlie Mingus pour calmer l’ambiance. Je me suis précipité à mon bureau en renversant tout sur mon passage.
— Je suis innocent, Bernard, il faut que tu me croies…
— C’est à cause de toi, ce bordel au Wyatt ?
— Je suis innocent, je te dis. J’ai besoin d’une zone franche où l’on respectera mon immunité de journaliste.
— … ?
— Je n’ai rien à voir avec les crimes dont on m’accuse. Préviens le consulat, l’ambassade, la cour internationale de justice, je veux un passeport diplomatique et un droit d’asile dans un pays qui refuse l’extradition, Bernard.
— Bergeron t’a foutu à la porte, il n’a pas digéré que tu le mènes en bateau avec cette histoire d’interview bidon d’Harrison Ford.
— Harrison Ford… Qu’est-ce que vous avez avec ce mec ? C’est jamais qu’un acteur, un gars qui sait dire trois mots devant une caméra, comme toi et moi si on nous le demandait. Il sait tenir un flingue ? Moi aussi, je l’ai fait, et pas plus tard que cet après-midi. Il a déjà risqué sa vie pour de bon ? Non ? Eh bien moi, si.
Il m’a écouté, une lueur d’inquiétude dans l’œil, jusqu’à ce que le téléscripteur crépite. Derrière la vitre, je l’ai vu pâlir, et s’acheminer vers le micro pour couper la chique à Mingus. Il avait beau lire, on avait l’impression qu’il cherchait ses mots.
« Une dépêche de l’A. F. P. nous informe qu’un groupe d’individus armés a pénétré dans la discothèque le Wyatt. Il s’agirait, je cite, des membres d’un club de tir du boulevard de Grenelle. Les gardes du corps d’Harrison Ford, déjà échaudés par l’intervention des manifestants du comité de soutien de José Famennes, ont ouvert le feu afin de protéger l’acteur. Harrison Ford s’est déclaré victime du harcèlement d’un journaliste prêt à tout pour lui soutirer une interview qu’il n’a jamais accordée. Il semblerait qu’après une explication entre les divers opposants un terrain d’accord ait été trouvé. Les clients de la discothèque, les gardes du corps, les manifestants et les membres du club de tir se dirigeraient en ce moment même vers les locaux de… d’une radio… 99.1… afin de… »
Il y a eu comme un blanc terrible à l’antenne et dans nos esprits. J’ai imaginé Bergeron, l’oreille collée à son tuner, et me suis raccroché le plus longtemps possible à cette vision, comme une espèce de paravent mental qui m’en cachait une autre, bien plus terrible. Dans un état proche du mien, Bernard a réuni un reste d’énergie pour conclure :
« L’A. F. P. nous précise par ailleurs, selon une dépêche provenant du San Lorenzo, que José Famennes va être exécuté demain matin. »
C’est à ce moment précis qu’un brouhaha nous est parvenu, quelque chose de sourd au début, puis une cacophonie montante, de plus en plus précise, de plus en plus haineuse. Quand l’escalier s’est mis à trembler, Bernard a foncé pour fermer la porte blindée de la station. De quoi les retarder d’à peine cinq minutes. Je me suis précipité vers l’escalier de service pour aboutir dans une courette vide, puis dans une rue adjacente. Au loin, j’ai vu la meute s’engouffrer entièrement dans le bâtiment, Baptiste en tête. Une silhouette à ses côtés invectivait la foule en anglais et m’a remémoré de façon troublante une scène de Star Wars. J’ai couru une bonne heure dans les rues sans savoir où aller. Mon appartement ne devait plus être que décombres, mes amis avaient ordre de tirer à vue, et j’ai imaginé Paris tout entier mobilisé dans une chasse à l’homme. J’ai erré jusqu’à trois heures du matin, avec la peur au ventre et les larmes aux yeux, j’ai eu envie de m’isoler entre quatre murs pour ne plus jamais en sortir en attendant la fin de la guerre. Dans un coin pourri, j’ai repéré cet hôtel repoussant de laideur.
*
Je m’assois sur le lit sale. Dans un silence total, je parcours des yeux le tracé du papier peint arraché, les graffitis gravés dans le plâtre. Je me passe un peu d’eau sur le visage, au milieu des cafards qui rampent autour de la bonde moisie du lavabo. Tout à coup, j’entends du bruit derrière la porte, ce sont eux, ils m’ont retrouvé, ils vont me faire la peau, je l’ai toujours su, je l’ai déjà accepté. La peur me vrille à nouveau les entrailles, je laisse échapper une petite plainte d’enfant et me reprends tout de suite. Cette peur me fait honte. Le bruit n’est pas fracassant, pourtant. Un son étrange, un choc feutré. Il s’estompe lentement. Je soupire un grand coup, soulagé. Je m’allonge. Les yeux clos, je laisse une foule d’images vagabonder dans ma tête, sans chercher à les maîtriser. Je suis loin, dans un pays inconnu, là où la chaleur et la misère envahissent les rues et les êtres.
Je vois.
Je vois un homme. Les tempes grises, les yeux résignés, assis par terre, les genoux ramenés vers lui, près d’une cuvette en émail ébréché. Il est maigre à faire peur. Ses gestes sont trop lents. Une barbe folle lui a mangé tout le visage. Aussi longtemps qu’il vivra, ses yeux ne riront plus jamais. Des bottes martèlent le couloir, il dresse l’oreille. Elles passent très exactement vingt et une fois par jour, il pourrait presque en déduire l’heure qu’il est. Les bottes font entre quarante et quarante-cinq pas à chaque passage. Au second passage de la journée, on entend le tintement des clés qui ouvrent entre une et trois serrures, chaque fois différentes. Cette fois encore, les bottes s’éloignent, il respire une bouffée d’air. Il attend, en silence, que quelqu’un vienne ouvrir cette porte, une bonne fois pour toutes. Certains soirs, il prierait Dieu pour que ça arrive enfin. Il attend depuis si longtemps qu’il a presque oublié ce qu’il faisait là. Il n’avait pas mis le palais royal à feu et à sang, il n’avait pas formé un bataillon de soldats rebelles. Il avait juste dit non quand tous les autres le pensaient si fort. Le courage n’avait rien à y voir, il le fallait, c’est tout. Et il s’était retrouvé là. Des milliers de gens, peut-être des millions, finiraient bien par le savoir, par-delà les océans. Il ne comptait déjà plus sur eux.
Читать дальше