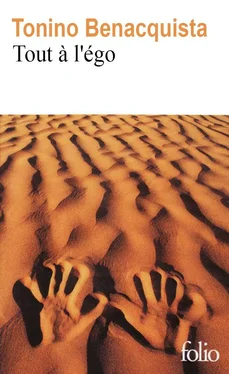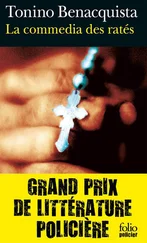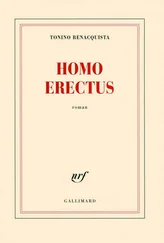— À chaud, c’est difficile.
— Le Grand Huit ? Les clowns ? La robe de mariée… ? Qu’est-ce que ça peut vouloir dire, professeur ?
— Quand puis-je venir chercher la plaque ?
— Pas avant mercredi.
— Je vous donnerai l’adresse d’un confrère, j’ai une liste longue comme ça.
*
— Tu n’étais pas obligée de m’accompagner, Minou.
— Oh toi, je te connais. Tu vas trouver un tas d’excuses pour ne pas y aller, tu serais même capable d’oublier, ça s’appelle un « acte manqué ».
— Elle veut me voir trois fois par semaine, au moins au début. Tu tournes à droite, là, et on y est.
— Les premiers temps je t’accompagnerai à chaque séance, pour une fois que tu trouves quelqu’un qui te convient.
— Comme tu veux, Minou.
Elle s’arrête au bas de l’immeuble, juste devant la plaque du Professeur Guyancourt qui brille en lettres d’or. Elle m’embrasse sur le front.
— Vas-y, je t’attends, ne crains rien.
Je sors et lui fais un petit signe de la main avant de passer la porte cochère.
— Et sois à la hauteur, hein !
Je grimpe quatre à quatre les marches qui mènent au troisième, Élisabeth m’a entendu arriver et m’ouvre les bras. Nous basculons à terre tous les deux, nous nous battons pour arracher nos vêtements, nos corps roulent jusqu’à la baie vitrée du balcon, je la relève et lui plaque le dos contre la vitre, je ne peux pas résister à l’envie de la prendre là, debout, face au ciel de Paris.
— Et ta femme, elle ne se doute de rien ?
Je retiens un dernier instant toute la fureur de mes sens pour jeter un œil en bas de l’immeuble. Catherine est là, une cigarette au bec, appuyée contre le capot.
— À vue de nez, je dirais non, ma belle.
Il a entendu ce gosse chialer, au loin, dans les cellules du quartier E. Pendant tout le temps qu’a duré la plainte, longue et lancinante, mêlée de ressacs de colère, José Famennes s’est souvenu de ses toutes premières minutes dans ce trou, quand il avait encore lui aussi la force de pleurer. Les pleurs n’étaient en fait que le signe d’un léger mieux, comme un retour en surface après s’être vu noyé, incapable de remonter en apnée dans le tourbillon des murailles. Les pleurs, c’était une longue plage d’où l’on dérive avec langueur, accroché à la chaîne du bat-flanc, jusqu’à se retrouver, sans s’en rendre compte, au beau milieu de l’océan. Et puis le gosse a fini par se taire, comme tous les autres.
José Famennes n’aurait pu s’endormir avant.
En ce bas monde, certaines rencontres ne se font jamais. Un priapique ne rencontre pas de nymphomane, un anonyme ne rencontre jamais les sosies dont tout le monde lui parle, un athée ne rencontre pas Dieu dans une guerre de tranchées, un paranoïaque ne rencontre pas la cohorte d’espions qui le traquent, et un bureaucrate mal noté n’aura jamais la chance de rencontrer son patron sortant d’un hôtel borgne.
Mettez ça de côté un instant et imaginez que je fais des reportages pour une petite radio parisienne qui n’a même pas de nom, tout le monde l’appelle 99.1, même nos rares auditeurs. Imaginez-moi, Alain Le Guirrec, en train de quadriller la ville à la recherche d’un sujet décent, ou d’une simple interview, et vous serez en deçà de la vérité. La vérité, c’est que je passe mon temps à faire causer des semi-vedettes aussi vides que leur agenda, et des gens pas plus doués que tout le monde qui n’ont pas plus de choses à dire. Si je devais résumer l’année en cours, je dirais que mes plus gros coups sont une interview de la dernière recrue du Crazy Horse Saloon, celle d’un poète hongrois qui refusait une question sur deux, et celle d’un crétin de gymnaste dont il vaut mieux taire le nom. Maintenant revenons-en à cette histoire de rencontres impossibles et vous comprendrez qu’un minable journaliste dans mon genre ne peut compter que sur un miracle pour décrocher son quart d’heure de grâce. Vous me croirez si je vous dis qu’il a suffi d’un simple coup de fil, au bon endroit et au bon moment, pour que l’attachée de presse de l’acteur Harrison Ford m’accorde, contre toute attente, quinze minutes de son temps, sur le plateau du film qu’il tourne à Paris ? Harrison Ford soi-même ? Trouver une explication à un phénomène aussi invraisemblable n’a rien de facile et n’incite pas à la gloriole. La dame avait dû mal entendre mon nom ou confondre ma radio avec une autre, mais le rendez-vous était pris et rien ne pouvait plus m’empêcher de faire cette interview, celle pour qui se damnerait la moitié des journalistes de la place, celle qu’attendait la totalité du public. À 99.1, ç’a été une petite révolution. M. Bergeron, le patron, m’a regardé pour la première fois comme un vrai professionnel, un garçon brillant et plein d’avenir qui jamais ne devait oublier qu’il m’avait donné ma chance. Toute la nuit durant, j’ai révisé la filmographie de la star, revu quelques passages choisis parmi ses plus belles prestations, et mis au point des questions qui me semblaient bien plus originales que ce qu’on avait fait jusqu’à présent. Sans aucun doute, Harrison Ford se souviendrait longtemps de notre entrevue, et qui sait, lors d’un de ses prochains passages à Paris, il me demanderait, en personne, et pas un autre. Roger, mon fidèle technicien, devait passer me chercher à 13 h 00 pour être trente minutes plus tard sur le tournage, boulevard de Grenelle, avec une heure d’avance sur le rendez-vous pour éviter les imprévus. À 12 h 55 on a sonné à ma porte, je suis allé ouvrir en saluant la conscience professionnelle de mon collègue.
En fait de Roger, j’ai eu la visite de quatre types dont trois m’étaient parfaitement inconnus.
— Salut Alain. Je te présente Didier, Jean-Pierre et Miguel, on peut entrer ?
Celui qui parlait s’appelait Baptiste, je l’avais interviewé à l’époque où il essayait de lancer un mensuel sur l’actualité parisienne passée au vitriol. Son intervention à 99.1 lui avait servi à lancer un appel à la souscription mais, malgré toute sa bonne volonté, cette belle aventure avait capoté très vite et, en le voyant débouler, j’ai cru qu’il voulait remettre ça.
— Je suis pressé, Baptiste. On va passer me chercher pour une affaire urgente.
— Il ne peut pas y avoir plus urgent que notre affaire à nous. Tu es journaliste, tu vas comprendre. On fait partie du comité de soutien de José Famennes.
Il a attendu que le journaliste en moi réagisse à ce simple nom qu’il lâchait comme une bombe. Il se trouve que le journaliste en moi n’a pas moufté. Et je ne sais pas si c’était l’agacement d’avoir des importuns chez moi ou l’importance du grand rendez-vous à venir, mais j’ai écouté d’une oreille distraite la triste histoire d’un prisonnier politique retenu dans une geôle sud-américaine, dont la condamnation à mort ne devait plus tarder.
— C’est une question d’heures. On a organisé une manif cet après-midi devant l’ambassade du San Lorenzo, on a des appuis, on ne peut pas le laisser crever comme ça. On fait circuler une pétition.
Il m’a tendu un fascicule couvert de noms et d’adresses. Ça a réveillé des trucs oubliés, enfouis au plus profond de mes jeunes années. Quelque chose de grave a traversé la pièce.
— Deux cent quarante-trois signatures, que des gens motivés et mobilisés. On a un ex-ministre, vingt-huit députés, des écrivains en pagaille, vingt-six journalistes, et plein d’autres, tous triés sur le volet. Avec ça, il nous reste une chance, mais on n’a plus beaucoup de temps pour la communiquer à l’ambassadeur. Après, il sera peut-être trop tard. Il faut que tu en parles à ta radio, il faut mobiliser du monde !
Читать дальше