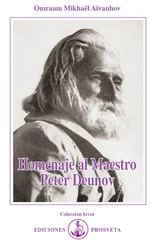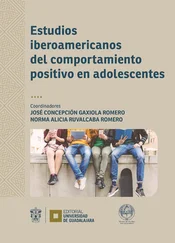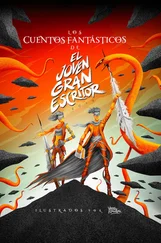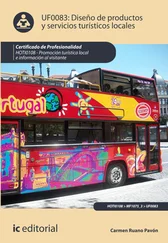8. LA LIGOTTE (ÉTOBON), LA LIGUETTE (LA BRUYÈRE)
La Ligotte (Étobon, 1828, A2, 934-939) est basé sur le type lexical de Montbéliard ligote s. f. «lisière étroite de terrain» (FEW, 22/2: 38a, qui indique que le mot est vraisemblablement à classer sous LIGARE, où l’on trouve en effet La Bresse ligate «bandelette», FEW, 5: 323a), Châtenois-les-Forges [liˈɡat] «champ long et étroit», Doubs id., [liˈɡɔt] (ALFC, 163: p 12, 14, 15; Dondaine, 2002: 339). Dans La Bergerie et la Liguette (La Bruyère 1825, B3, 393-399), Liguette présente la forme française adaptée du suffixe diminutif. Ces deux microtoponymes fournissent les premiers jalons indirects chronologiques pour ce type lexical.
9. LES LIGUAISSES (SAINT-SAUVEUR)
Les Liguaisses (Saint-Sauveur s. d., B4, 354-368) représente Haute-Saône (Éhuns, Fougerolles, Melisey, Plancher-Bas) [liˈɡɛs] s. f. «champ long et étroit» (ALFC, 163: p 37, 28, 22, 16; Dondaine, 2002: 339), Brotte-lès-Luxeuil «petit champ» (aussi «bordure; rive d’un champ»; Humbert, 1939: 50 et FEW, 22/2: 38a, qui indique que le mot est vraisemblablement à classer sous LIGARE, FEW, 5: 323a), Fougerolles ligès «petite surface toute en longueur» (Grandjean, 1979: 106). On constate que le microtoponyme de Saint-Sauveur s’inscrit dans l’aire très réduite qu’occupe ce type lexical auquel il fournit un premier jalon chronologique assez vague (XIX esiècle).
10. PRÉ DU CANON (RONCHAMP)
Le second terme de Pré du Canon , nom d’un terroir de Ronchamp (cadastre de 1833, E3, 1016-1018), est l’appellatif franc-comtois (Noroy-le-Bourg) [  ] s. m. «montant en argent de la location des herbes de pré» (ALFC, 1212*: p 40; Dondaine, 2002: 285). Le FEW (2: 216b, CANON) n’a relevé le sens de «fermage (payé en espèces)» que dans des parlers dialectaux lorrains et en français régional de Lorraine (1807). Georgel (1958: 268) enregistre un Pré du Canon à Xonrupt (Vosges).
] s. m. «montant en argent de la location des herbes de pré» (ALFC, 1212*: p 40; Dondaine, 2002: 285). Le FEW (2: 216b, CANON) n’a relevé le sens de «fermage (payé en espèces)» que dans des parlers dialectaux lorrains et en français régional de Lorraine (1807). Georgel (1958: 268) enregistre un Pré du Canon à Xonrupt (Vosges).
11. SUR LA RIBE (CHAMPAGNEY) ET CONGÉNÈRES
Le substantif féminin ribe «cylindre plat, en pierre, servant à broyer le chanvre, les noix, les pommes, etc. (par opp. à la meule à grains)» est attesté en 1672 dans le français régional du pays de Montbéliard (Thom, 1983: 268) et au XVIII esiècle dans celui de la Haute-Saône (Ternuay 1711 «moulin ribe et battant» et 1786, Caritey, 1989: 189; 1785, doc. concernant Villersexel, Boffy, 1995: 18, 29). En 1744, dans un document concernant Clairegoutte, le mot a le sens métonymique ( pars pro toto ) de «moulin utilisant une ribe » (Thom, 1983: 268); à Servance, Mougin (1957: 75) définit ribe par «moulin qui sert à broyer le chanvre».
C’est peut-être dans une telle valeur métonymique que ce mot s’est fixé en micro-toponymie dans Sur la Ribe (Champagney 1833, D1, 173-175); Derrière la Ribe (La Longine 1827, B1, 242-247; situé à proximité du Moulin de la Scie ); Le Clos de la Ribe (Fougerolles 1827, E8, 1403-1437); Etang de la Ribe (Amont-et-Effreney 1825, D1, 173-175; La Bruyère 1825, B3, 415-416); Prés de la Ribe (Oppenans 1819, A5, 1152-1154); P[ont] de la Ribe (même commune ; IGN 1:2500 , 3421 E ) 33.
Dans les parlers dialectaux ou en français, l’aire de ribe (type emprunté à l’alémanique) se limite à l’extrême sud des Vosges, à l’Alsace romane (où mfr. ribe est attesté dès le XV esiècle [Rosemont = cantons de Belfort et de Giromagny]), à l’est de la Franche-Comté (notamment Miélin et Plancher-les-Mines) et aux cantons suisses du Jura et de Neuchâtel. Voir FEW, 16: 703a, RÎBAN; Tappolet, 1917: 130; Bloch, 1917: 26; ALFC, 2: XCI; Dondaine, 2002: 457; Pierrehumbert, 1926: 527 [déjà mfr. rég. Neuchâtel 1539]; Thom, 1983: 268). Anonyme (s. d.) ne fait apparaître qu’un seul cognat en France: la Ribe (lieu-dit, Hagnéville, Vosges). Sur les ribes des Vosges saônoises (ribes à filasse ou ribes des huileries), voir Curtit (1994-1997, 1: 18, 37-41, 111; 2: 34-35, 121).
12. CHAMPS DE LA RIDE (RADDON-ET-CHAPENDU), PRÉS DE LA RIDE (FOUGEROLLES)
Champs de la Ride (Raddon-et-Chapendu 1823, A2, 186-193) et Prés de la Ride (ferme, Fougerolles 1827, A4, 2529-2546) s’expliquent par Fougerolles rid s. f. «ribe [fr. rég.], meule à broyer» (Grandjean, 1979: 131). Le FEW n’atteste cette variante secondaire (inexpliquée) de ribe (ci-dessus §11) que dans l’extrême sud du département des Vosges (cf. Bloch, 1917: 26), mais elle a aussi été entendue par Daniel Curtit, auprès des anciens, comme «forme patoisante» (par opposition à frm. rég. ribe ), dans le canton de Faucogney (Curtit, 1994-1997, 1: 111 = 2: 121; communication personnelle).
13. SECHERON DU PRÉ LE SIR (MELINCOURT) ET CONGÉNÈRES
Secheron du Pré le Sir (Melincourt, 1829, C6, 1295), les Seichurons (Dampvalley-Saint-Pancras 1829, B4, 971-981) et Aux Seichurons (Vellechevreux-et-Courbenans 1823, C1, 136-138) se rattachent, comme Les Secherons (Cenans 1811, B3, 1000-1025) dans l’arrondissement de Vesoul, au type de mfr. frm. sécheron s. m. «pré situé dans un lieu sec», attesté du XVI esiècle au Littré et considéré par les Larousse (1875-1949) comme un régionalisme de l’«Est de la France» (FEW, 11: 587a, SICCUS). Au plan dialectal le FEW ( loc. cit. ) atteste ce type notamment en Bourgogne et en Lorraine (cf. aussi ALB, 340; ALCB, 321; ALFC, 246*, respectivement p 88 et 72, en Haute-Marne; Dondaine, 2002: 493). Il existe de nombreux parallèles dans la microtoponymie des quatre départements bourguignons (Taverdet 1993: 1960-1961). Dans le microtoponyme de Melincourt, le sens de départ est *«partie naturellement sèche d’un pré». Pour une variante suffixale, voir ci-dessous §14.
14. LE SÉCHURUN (MIGNAVILLERS) ET CONGÉNÈRES
Le Séchurun (Mignavillers, 1823, G8, 1517-1521), Au séche run [ sic ] (Oricourt 1822, A2, 87-92), Les Sécheruns et Pré des Secheruns (tous les deux Vacheresse [aujourd’hui Moffans-et-Vacheresse], respectivement A 232-237 et B 20-32) et Les Secheruns (Visoncourt 1832, 1298-1325) témoignent d’un type que le FEW (11: 587a, SICCUS) n’atteste que par Châtenois-les-Forges (Territoire-de-Belfort) satchirun s. m. «pré (ou partie de pré) naturellement sec» (=Vautherin 1896-1901, [IV]: 127). Taverdet (1993: 1960) enregistre un Soicherun à Sainte-Marie-la-Blanche (Côte-d’Or). Pour une variante suffixale, voir ci-dessus §13.
15. LA TALLE (ÉTOBON) ET CONGÉNÈRES
Vautherin (1896-1901, [IV]: 168) a voulu interpréter la Thâle , lieu-dit de Bavillers (Territoire-de-Belfort) 34comme une «form[e] francisée de l’all. thal [‘vallée’]». Le même type se trouve non loin, dans le Territoire-de-Belfort, avec la Thale , «l’une des parties du vill[age] d’Auxelles-Haut» 35, et dans l’extrême-sud-est de la Haute-Saône: la Talle , lieu-dit d’Étobon ( IGN 1:25 000 , 3621 OT ) 36, La tale ancienne , les Talles et au dessus des Talles , lieux-dits de Mignavillers (1823, G8, respectivement 1442, 1500-1516, 1522-1529), auxquels s’ajoute diminutif La Tallotte , lieu-dit de Chavanne (s. d., A4, 1079-1094; IGN 1:25 000 , 3521 O : la Talotte ). À date ancienne, nous avons rencontré: à Chagey ou à Luze, en 1423 (orig.), les microtoponymes mfr. Tale d’Eri-court et en la Talle Beleney 37; à Mignavillers, en 1619, frm. la Talle Briot , la Grand Talle ( des Prelz en Ban ), nom d’un pré, et le diminutif la Tallotte ( des Prelz en Ban ), nom d’un «petit prel» 38.
Читать дальше
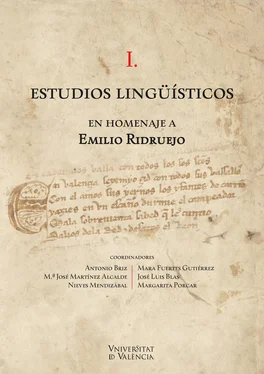
 ] s. m. «montant en argent de la location des herbes de pré» (ALFC, 1212*: p 40; Dondaine, 2002: 285). Le FEW (2: 216b, CANON) n’a relevé le sens de «fermage (payé en espèces)» que dans des parlers dialectaux lorrains et en français régional de Lorraine (1807). Georgel (1958: 268) enregistre un Pré du Canon à Xonrupt (Vosges).
] s. m. «montant en argent de la location des herbes de pré» (ALFC, 1212*: p 40; Dondaine, 2002: 285). Le FEW (2: 216b, CANON) n’a relevé le sens de «fermage (payé en espèces)» que dans des parlers dialectaux lorrains et en français régional de Lorraine (1807). Georgel (1958: 268) enregistre un Pré du Canon à Xonrupt (Vosges).